jeudi, 13 juin 2013
Capillomanie, capillophilie I - Delerm
Janvier 2011.
Ich habe eine Ânerie gemacht.
Nicht kleine, große.
Aber eine Ânerie pré-moutonnière.
(Source : Direct Matin, mardi 26 février 2013)
Janvier 2013
Strong hair did that...
Extrait de La sieste assassinée, Fabrice Delerm, 2005, Folio :
On est là, tout engoncé dans le fauteuil, tout vaporeux, flottant dans la soyeuse blouse vague que le coiffeur vous a fait enfiler. Au début, il a eu ce geste du doigt glissant autour de votre cou pour placer la petite serviette protectrice - et dès lors on s'est laissé faire, anesthésié par tant d'autorité et tant de prévenances, par tant d'effluves de violette et de fougère répandus au hasard de la pièce.
Quand le coiffeur vous parle dans le dos, ce n'est pas très poli de le suivre des yeux dans la glace, et puis ça l'agace un peu - il ne dit rien, mais vous saisit la tête entre ses mains, à hauteur des tempes, et rectifie la position avec une douceur très implacable. Puis le ballet du peigne et des ciseaux reprend, et la conversation aussi, après un petit blanc. Alors c'est assez étrange : on se regarde dans la glace bien en face tout en bavardant. On ne peut pas dire qu'on se voie vraiment, ni qu'on s'admire - ce serait bien gênant d'opposer une telle suffisance à cet artisanat butinant qui se déploie autour de vos oreilles. On se regarde en s'oubliant. On devient la conversation, bien anodine le plus souvent, du type moralisateur à consensus très large, sur l'évolution défensive du football, par exemple - qu'est-ce que vous voulez, c'est l'argent qui commande.
Mais la minute qui compte, c'est tout à la fin. Les gestes se sont alentis, le coiffeur vous a délivré du tablier de nylon, qu'il a secoué d'un seul coup, dompteur fouetteur infaillible. Avec une brosse douce, il vous a débarrassé des poils superflus. Et l'instant redouté arrive. Le coiffeur s'est rapproché de la tablette, et saisit un miroir qu'il arrête dans trois positions rapides, saccadées : sur votre nuque, trois quarts arrière gauche, droite. C'est là qu'on mesure soudain l'étendue du désastre... Oui, même si c'est un peu près ce qu'on avait demandé, même si l'on avait très envie d'être coiffé plus court , chaque fois on avait oublié combien la coupe fraîche donne un air godiche. Et cette catastrophe est à entériner avec un tout petit oui oui, un assentiment douloureux qu'il faut hypocritement décliner dans un battement de paupières approbateur, une oscillation du chef, parfois un "c'est parfait" qui vous met au supplice. Il faut payer pour ça.
 Se procurer l'ouvrage :
Se procurer l'ouvrage :
La sieste assassinée
Philippe Delerm
2005
Folio
112 pages
http://www.amazon.fr/La-Sieste-assassin%C3%A9e-Philippe-D...
07:02 Publié dans Ecrits, littérature contemporaine, Votre dévouée | Lien permanent | Commentaires (1)
vendredi, 07 juin 2013
Considérations sur l'art du roman - Romain Debluë

L'imprimerie, gravure d'après Jan van der Straet
Extrait de "Quand le furet s'endort", de Pierre Boutang, Romain Debluë, 2013
Étonnera nombreux, sans doute, interdits à l’imagination conceptuelle, l’hypothèse certes de prime abord saugrenue qu’un furet, tortueux petit animal que la langue latine d’un furittus fait petit voleur, puisse tenir en échec à la fois Kant et Hegel ; l’un en sa dichotomie entre fin et moyen radicalement appliquée à autrui, l’autre pas moins en sa dialectique du Maître et de l’Esclave. Le roman, en nos jours postérieurs, ayant déchu à n’être plus que son ombre, entendue poétique donc spectrale et en Enfer plusieurs fois descendue sans que jamais nul Orphée ne l’y puisse aller quérir, le roman n’a plus à présent vocation qu’à être miroir aux alouettes pour les quelques volucres de basse-cour qui emploient encore leur plume à s’y mirer littéraires et ne font que s’y abolir, – perpétuellement. S’il n’est plus aujourd’hui espace d’intelligence et de pensée, point ne faut-il pour autant amnésier qu’il naguère sut l’être et qu’avant que le Nouveau Roman sacre très haut l’exigence diabolique de laideur et de vacuité formofactice, il n’était pas miracle de pouvoir lire un roman pensant.
[...]
> Pour le texte intégral : http://amicusveritatis.over-blog.com/article-quand-le-fur...
07:03 Publié dans Beaux-Arts, Ecrits, Gravure, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 30 mai 2013
La gloire de Rubens - Philippe Muray, Rubens, Rembrandt

Philippe Muray (1945-2006)
Extrait de La gloire de Rubens, 1991, Philippe Muray, Grasset :
[...]
Rubens m'appelle depuis toujours. Son tumulte est si loin du bruit de ce qui a l'air de se passer ! Tellement à côté de la plaque ! De toutes les plaques tournantes et chatoyantes de l'éternel retour du Rien contemporain ! [...] Je croyais parler d'autre chose, mais c'était mon désir de lui, en rêve, qui me faisait vivre. C'était lui qui gonflait mes phrases, les prolongeait, les poussait ; lui dont j'entendais siffler les voiles et les cordages, et rouler la houle sous mes pieds ; lui dont la forêt se balançait partout où j'allais ; lui qui bouillonnait dans tout ce que j'aimais ; lui dont le ciel filait en accéléré avec ses femmes nuages plus grandes que nature bien au-dessus de mes pages.

L'union de la terre et de l'eau, Rubens
J'avais à peine vu deux ou trois de ses tableaux, que je savais déjà que je n'en aurais plus jamais fini d'aimer les autres. Que les moindres hésitations de cette main infaillible me transporteraient. Que ses plus pâles croquis feraient de moi ce qu'ils voudraient. Que quelque chose de plus vaste, de plus hors de proportions que le reste, avait été laissé, là, par un dieu, pour moi, pour augmenter et confirmer le bonheur d'exister. "Ma confiance en lui fut immédiate", écrit Nietzsche de Schopenhauer dans la troisième des Considérations inactuelles : je pourrais faire la même observation à propos de Rubens, mais aussi de Balzac et de quelques autres, bien rares, dont l'oeuvre se déroule comme une victoire paisible et sans fin, comme un triomphe confirmé sur la maladie mentale la plus répandue, comme un baume sur la disgrâce la moins guérissable, comme un défi à tout ce qui sous les noms d'angoisse, honte, désir de punition, sentiment de cette incurable tournant en réquisitoire enragé, appels à la Loi, indignation, dénonciation perpétuelle, calomnies, ragots, obsession de procès ou procès réels, frémit, en secret ou non, dans les sociétés. Voilà : je viens d'énumérer ce que n'est pas Rubens, ou du moins l'essentiel de ce que ses traces effacent. La Culpabilité est l'ardeur du monde. Son foyer de toujours. La source de ses acharnements, même somnambuliques. En un sens, c'est vrai, nous sommes maintenant archi-morts ; ou tellement falsifiés que nous n'aurions plus aucun moyen de distinguer la moindre vérité, s'il en passait une. Tellement irradiés d'images, aussi, qu'on s'attendrait à voir comme une lumière d'un autre monde traversant nos silhouettes conditionnées, transperçant ce qui reste de nos systèmes sanguins ou nerveux mis à nu. "Te voilà comme une carcasse abandonnées par les corbeaux... on voit le jour à travers !" clame Josépha devant le baron Hulot qu'elle a contribué à ruiner et à dévaster. Plût au ciel que ce soit encore le jour qui filtre à travers nos carcasses à nous ! Si une lueur traverse jamais les fantômes que nous sommes devenus, ce ne pourra être que celle de nos écrans de télé aveugles en train de nous regarder.

Samson et Dalila, Rubens
Mais, en un autre sens, nous sommes encore vivants, tout de même, puisque nous durons et que nous désirons et que nous nous reproduisons (ou que, du moins, nous faisons comme si tout cela continuait). Nous sommes là, encore, et nous tenons à ce que ça se sache, à ce que ça se dise, à ce que ce soit pris au sérieux et même au tragique, et il serait impossible d'y arriver si nous n'avions pas la Culpabilité comme alliée. La Culpabilité qui mène la danse, partout, en nous et jusqu'au bout. L'oeuvre de Rubens dévoile du fond des âges cette réalité. Elle n'en parle pas, elle fait mieux, elle la rend audible et perceptible par la beauté qu'elle déchaîne pour montrer qu'on peut vivre autrement qu'en faute ou en dette. Comment ? Par quel miracle d'arrogance, de luxe, de voracité sensuelle qui se moque du reste ? Par quelle ignorance des stéréotypes acceptés ? C'est toute la question. [...]
La fidélité la plus encrassée conduit la planète comme jamais. Nous nous imaginons tous je ne sais quels devoirs afin d'immobiliser les autres sous la même coupe triste que nous. [...]
[...] "L'Humanité ne sera sauvée que par l'amour des cuisses. Tout le reste n'est que haine et ennui", déclarait Céline (dont le style giclant, tout de spasmes et d'écume, est le seul aujourd'hui, à la hauteur du feu rubénien), avant de se tromper dramatiquement de sauvetage en oubliant l'amour des cuisses. Oui, nous savons bien qu'il n'est pas de plaisir qui ne retombe un jour en morosité, reproches, scènes, cris ; oui, nous savons que les voluptés les plus extasiantes finissent en plaintes, couinements, grincements de dents, exigences et sifflements de serpents. Les commencements sont plus beaux que les conclusions, mais pourquoi privilégier celles-ci plutôt que ceux-là ? [...]
J'ai toujours rêvé d'illustrer mes livres avec ses tableaux. [...]

La chute des anges rebelles, Rubens
[...] Amnésique après un bombardement, sans précédent, l'artiste ou l'écrivain de maintenant ressemble à ces individus que l'on retrouve parfois, sur les quais des gares, sans papiers, sans mémoire, et qui ne savent plus d'où ils viennent, qui ne connaissent plus leur nom, ni leur adresse, ni leur famille, ou qui préfèrent peut-être les avoir oubliés.
[...] Tout artiste hors du commun est reçu par la communauté en quelque sorte malgré elle ; mais la puissance de cette œuvre-ci, plus cruellement encore que n'importe quelle autre, nous renvoie à notre petitesse. A nos infirmités. A notre absence de facilité. A nos effondrements sentimentaux. A nos crédulités. Personne, par exemple, ne pardonnera jamais à Rubens d'avoir été l'artiste le plus follement cultivé de l'histoire de la peinture, et de ne pas avoir pris la précaution raisonnable de le cacher.

L'éducation de Marie de Médicis, Rubens
[...] Le Louvre ! La Galerie Médicis ! C'est du fond des murs que la Richesse vous regarde. "Le dieu est là", comme ont écrit un jour les Goncourt. J'y vais, je m'y précipite comme à la Tapisserie de la Licorne de la peinture, comme au spectacle de la victoire en vingt batailles contre l'insane Sentiment de la Nature. Et tout, autour, tremble en s'effaçant, les rues, les voitures, les monuments, les affiches de pub, les immeubles, le fleuve et ses ciels, et, bien sûr, la Pyramide ! L'entrée du mausolée, géométriquement dédiée aux prétentions à la Transparence de notre fin de siècle culpabilisé d'avoir tant joui de tant de tyrannies. Tout s'efface comme par enchantement parce que plus rien, depuis longtemps déjà, ne tenait debout.
[...]
Rubens encourageant ? Ca dépend pour qui.
Sa différence fondamentale avec Rembrandt, c'est que ce dernier vous prend avec une admirable sauvagerie fraternelle par la gorge, par les tripes, par les désagréments de l'existence quotidienne, par les chagrins, par la folie, par toutes les larmes de sang qui ne demandent qu'à ruisseler sur nos entrailles ouvertes. La spiritualité d'un boeuf pendu n'a pas d'équivalent chez Rubens, regrettablement peu sensible à notre origine de mammifères, comme à la vanité planant sur les destinées humaines. Comparez les personnages qu'ils mettent en scène : ceux de Rembrandt dérivent dans le sillon d'une mélancolie prodigieuse, ils souffrent de tout, ils sont comme nous, ils sont nous, la lumière les mange, l'ombre les divise, l'espace et le temps les recrachent dans le no man's land des causes perdues [...].

Le philosophe en méditation, Rembrandt
Rembrandt éclaire d'un jour tremblant et sublime de méditation notre pèlerinage de raclés d'avance. C'est le poète épique définitif de la Faillite, le champion du Grand Jeu de l'Echec sans remède, le roi du Damier des Paumés, le peintre du Tournoi maudit. L'ascète aux autoportraits délivrés en avalanche comme autant de permis d'inhumer. D'où sa victoire universelle. [...]
Le plaisir n'est pas la vie, ou alors depuis le temps, ça se saurait. La douleur ne passe jamais de mode, elle, et c'est directement au ventre, Rembrandt, qu'il nous parle, là où sont grandes ouvertes nos oreilles d'affamés d'amour. A l'intérieur. En plein tragique. Il nous visite tard, la nuit, comme un fantôme de bronze poudreux. S'il nous fait craquer, s'il est si génialement déchiré, c'est qu'il n'arrête pas de peindre, dans sa pénombre d'or fondant, le deuil de tout ce que nous n'avons pas eu. La communication ne se fait jamais vraiment à fond que sur des échecs. Plus que sur des crimes, moins spectaculairement mais plus sûrement, toute société est fondée et fermée sur des ratages commis en commun. Rien ne fait plus groupe que le fiasco en soi. Rien ne fédère davantage que le retour bredouille. Les seuls succès véritablement appréciés par la communauté sont ceux qu'elle accorde de façon posthume. Que votre objet vous échappe toujours, jusqu'au dernier moment, et c'est gagné pour la postérité ! Tout, avec le temps, peut devenir magie aux yeux de la société, à condition qu'elle se soit livrée, avant, à quelque torture. Rattraper le coup, réparer des injustices : nous ne nourrissons pas de plus grande passion ; encore faut-il que, de ces injustices, nous ayons été d'abord les agents vigilants.
[...]

Vieille femme en train de lire, Rembrandt
[...] Je suis persuadé que le bonheur de Rubens, c'est-à-dire sa non culpabilité phénoménale, commence là, dans l'incapacité de son système nerveux à se désavouer, dans son impossibilité à préférer son père plutôt que lui-même. Tout ce qu'il veut, au fond, tout ce qu'il cherche, il le dit, il le répète à ses intimes : ce n'est même pas tellement la gloire, même pas la puissance, ni la découverte d'une vérité des abîmes, c'est mourir un peu plus instruit. Pour cela il faut peindre, bien sûr, énormément. Ne jamais s'arrêter. Ne pas se laisser accabler. L'Empire de la Dette lui est inconnu, la discorde le visite rarement, le conflit l'effleure, sans doute, comme tout le monde, pour finalement le laisser intact. Il est difficile d'imaginer quelqu'un d'aussi peu divisé. Mais enfin où sont ses manques ? Ses clivages ? Quel est l'impossible que poursuit son désir ? Où sont ses déconvenues, ses dépressions, son désespoir ?
Mystère, mystère complet.
Est-ce qu'on pourrait imaginer, seulement imaginer, sans rire, quelque chose qui s'appellerait, par exemple, la Complainte du pauvre Rubens ?
[...]
J'ai conscience, parlant de Rubens, de sortir de l'histoire sainte. Le grain de sable qui fait hurler la mécanique avant de la casser, c'est lui. Il est bien trop comblant pour être honnête. On en a plein les mains, les oreilles, le cerveau. Le romantisme humain (pléonasme) a besoin, pour se sentir repu, de rester un peu plus que ça sur sa faim. Le nécessaire, déjà, lui flanque des indigestions, mais que dire alors du superflu, qui le met à l'agonie ! Rubens, c'est une grève du zèle de la peinture comme on n'en a jamais vu, le comble de l'archi-comble, toutes les mesures dépassées. Chaque récit dont il s'empare, chaque sujet qu'il traite, on sent qu'il le laissera sur le flanc après. La tâche du commentateur est mâchée d'avance, ce n'est même plus drôle. Non seulement il sait ce qu'il peint, mais en plus il fait savoir qu'il le sait, c'est décourageant.
Vous lui demandez, pour la cathédrale de Tournai, une Libération des âmes du Purgatoire ? Il vous déchaîne un geyser de fesses et de seins féminins jaillis en diagonale vers le Tout-Puissant.

Libération des âmes du Purgatoire, Rubens
Vous voulez Angélique endormie convoitée par un ermite ? Ah il ne se fera pas prier, il va vous la mettre, la merveilleuse, sous le nez, en gros plan, c'est un discours calme et définitif sur la convoitise, depuis le bout groseille des seins jusqu'à l'insistance ultime sur l'extrémité de voile transparent pincé entre deux cuisses huilées de rose chaud et sur le point de s'ouvrir. Et ce nombril moulé par la chemise trempée de sueur de la Sainte Marie-Madeleine en extase au Musée de Lille, longue pâmoison verte entre deux anges vigoureux !

Angélique et l'Ermite, Rubens
Et cet autre tableau fou du Palazzo Pitti, à Florence, l'une de ses dernières toiles, l'une de ses projections les plus voluptueusement déchaînées, aussi : Vénus cherche à retenir Mars ou les Conséquences de la guerre. Ce sont ses "horreurs de la guerre" à lui, mais voyez la différence avec le Trois mai de Goya : Rubens est pour la paix, bien sûr, comme tout le monde, qui n'est l'est pas ? Mais il l'est d'autant plus à fond que c'est un thème convenu et qu'il adore les thèmes convenus qui lui permettent de peindre des nus.

Allégorie de guerre, Rubens
Le Trois mai, Goya
Et ces Assomptions, où la Vierge est un point d'exclamation théologique perpendiculaire aux cercles remuants des êtres restés à terre ! Tout son discours royal, d'ailleurs, est fait d'apostrophes et d'exclamations. Il peint des voix, les siennes, les autres, chacun de ses personnages est la pointe sensible d'une déclaration, un fragment de conversation. Ses tableaux s'entendent, c'est rare. Tous ces déplacements font du bruit, ces corps qui bougent sont perceptibles. Audibles. Toutes ces bouches ouvertes soupirent, chuchotent, appellent, rient. Demandent et répondent. L'esprit classique naissant, le "bon sens naturel", la raison ("mais la raison accompagnée de toute la pompe et de tous les ornements dont notre langue est capable", corrigera Racine un peu plus tard), s'engouffrent dans sa peinture pour en ressortir maquillés, tourbillonnés, gonflés, travestis, allégorisés, déshabillés, et surtout parlants. Parlants à tout bout de champ. Le dialogue c'est l'empoignade de la Raison avec elle-même. Versailles est encore loin, les sociétés européennes commencent seulement à apprendre à s'expliquer, la syntaxe s'explore elle-même, des salons sont en cours de constitution, et Rubens, très en avance sur ces pionniers du raffinement, est peut-être le seul peintre qu'on se surprend à recevoir comme un concert, un festival de périodes oratoires enflammées, développées, affrontées.
[...] A Paulhan qui voulait qu'il donne des articles à la NRF, Céline répondait en 1933 : "j'écris très lentement et seulement dans d'énormes cadres et dans le cours d'années. Ces infirmités diverses me condamnent aux monuments que vous savez. Rubens, lui aussi, est condamné aux monuments, aux énormes cadres, lumineuse punition ! Je confesse, dit-il un jour, "d'être, par un instinct naturel, plus propre à faire des ouvrages bien grands que des petites curiosités." Oui, il y a des gens comme ça, il n'est pas le seul : "Ne me parlez de rien de petit !" lance Bernin à Colbert. Et Delacroix : "La proportion entre pour beaucoup dans le plus ou moins de puissance d'un tableau. Et Dostoïevski, plus tard, avouera ne pouvoir s'exciter sur un roman que lorsqu'il a mis en place et noué ensemble les matières d'au moins deux ou trois gros livres.
[...]
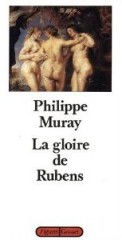 Se procurer l'ouvrage :
Se procurer l'ouvrage :
La gloire de Rubens
Philippe Muray
1991
Grasset
284 pages
07:00 Publié dans Beaux-Arts, Ecrits, littérature contemporaine, Peinture, Réflexions, philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la gloire de rubens, rubens, rembrandt, philippe muray
mercredi, 29 mai 2013
La dissonance cognitive - Philippe Muray

Philippe Muray (1945-2006)
Extrait de On ferme, Philippe Muray, Les Belles Lettres, troisième tirage, p.556 :
De quoi est-ce que Bérénice parlait maintenant ? Hein ? De la "dissonance cognitive" ? Elle en était devenue, ces derniers temps, une adepte des plus farouches. C'était une théorie formidable qu'elle mettait en pratique, à l'occasion, dans certains de ses séminaires. Pourquoi est-ce qu'elle lui parlait de ça ? Le monde continuait à se déformer. « On n'engage vraiment quelqu'un, de nos jours, mais alors ce qui s'appelle engager, c'est-à-dire esclavagiser, qu'en lui racontant qu'il est libre de ne pas faire ce qu'on a décidé qu'il fera. Tu comprends ? On insiste : c'est à lui de voir ! À lui de choisir ! De se décider ! Déclaration de pleine liberté ! » Le monde ne se déformait plus du tout. Il avait cessé d'exister. La "dissonance cognitive". Il ne comprenait rien à ce qu'elle disait. Il n'arrivait pas à se concentrer. Il racontait n'importe quoi.
 Se procurer l'ouvrage :
Se procurer l'ouvrage :
On ferme
Philippe Muray
2011
Les belles lettres
677 pages
http://www.amazon.fr/ferme-Philippe-Muray/dp/2251444270/r...
07:00 Publié dans Ecrits, Les mots français, littérature contemporaine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe muray, on ferme, les belles lettres, dissonance cognitive
samedi, 25 mai 2013
The-blue-pipe - XII - L'encens du poëte esseulé - Cocteau
Remerciements à Adrien Vannier
pour avoir complété mes lectures.
¤ ¤ ¤
[...] Ce que l’opium a apporté à Cocteau, c’est "une sieste extrême" ; l’opium, c’est "la femme fatale, les pagodes, les lanternes". C’est ce qui repose et inspire, une muse qui endort et éveille dans un autre monde, en dehors des hommes, mais dans une solitude qui n’a rien de solitaire… Une solitude en synergie avec la nature, et un soi-même qui échappe à la conscience. Une rupture avec lui-même, un long sommeil, après des années de drame. Une "femme fatale" qui fait tout oublier à l’amant, sinon elle, qui devient tout, qui se fait monde. [...]
"Il est difficile de vivre sans l'opium après l'avoir connu, car il est difficile, après avoir connu l'opium, de prendre la terre au sérieux".
Les gestes du fumeur, le rituel sophistiqué qu’exige l’opium sont en eux-mêmes un acte de création, une recréation du monde, égoïstes, désespérés. Quand l’opium s’est évanoui, comme l’écrit Cocteau, tout est trop léger- ou trop lourd. Le monde, qui s’était abandonné à l’artiste fumeur, tente de se réimposer. [...]
¤ ¤ ¤

Jean Cocteau (1889-1963)
"La sagesse est d'être fou lorsque les circonstances en valent la peine. "
"Tout ce qu'on fait dans la vie, même l'amour, on le fait dans le train express qui roule vers la mort."
"Plus on est avide, plus il est indispensable de reculer coûte que coûte les bornes du merveilleux."
" Le cinéma, c'est l'écriture moderne dont l'encre est la lumière."
Extrait de http://tpe-opium.e-monsite.com/:
En décembre 1928, Jean Cocteau entre à la clinique de Saint-Cloud où il doit subir une cure de désintoxication de l'opium. [...] Jean Cocteau, opiomane, écrit et dessine. Pour lui, il s'agit d'une même activité, du même acte créateur: "Ecrire pour moi, c'est dessiner, nouer les lignes de telle sorte qu'elles fassent écriture, ou les dénouer de telle sorte que l'écriture devienne dessin." [...] Ce journal de solitude s'éclaire de remarques sur le cinéma, sur la poésie, sur l'art. Le thème lancinant, qui revient au détour de chaque page, c'est celui de l'opium. Ainsi Jean Cocteau retrouve-t-il la grande tradition des poètes visionnaires, de Baudelaire et surtout de Rimbaud.
"Plus on est avide, plus il est indispensable de reculer coûte que coûte les bornes du merveilleux." Plus qu'à un témoignage personnel, c'est à une méditation sur la création, sur la poésie, sur le style, sur notre rapport même à l'existence que nous convie Jean Cocteau. Méditation poétique visant à cerner des notions subtiles. "Il faut laisser une trace de ce voyage que la mémoire oublie, il faut, lorsque c'est impossible, écrire, dessiner sans répondre aux invitations romanesques de la douleur, ne pas profiter de la souffrance comme d'une musique, se faire attacher le porte-plume au pied si nécessaire, aider les médecins que la paresse ne renseigne pas." Il pense que le rôle du poète n'est pas de prouver mais d'affirmer sans fournir aucune des preuves encombrantes qu'il possède et d'où résulte son affirmation. Le poète ne demande aucune admiration ; il veut être cru. [...] D'une remarquable pudeur sur les souffrances de la cure, Opium est le livre émouvant d'un homme reclus, qui évoque librement ses admirations ou ses affections, qu'elles aient pour nom Raymond Radiguet, Marcel Proust ou Chaplin. [...]
Interview du critique littéraire Paul Stho
Suite à quel événement a-t-il succombé à la prise de cette drogue?
Si l'on en croit les études psychologiques, faites par certains médecins, les consommateurs d'opium sont principalement des personnes ayant une vie difficile, où la souffrance était un sentiment permanent de leur quotidien. En étudiant de plus près la vie de Jean Cocteau, nous nous sommes aperçus que les années en compagnie de Raymond Radiguet, son meilleur ami, sont d'une fécondité exceptionnelle et, lorsque le jeune poète romancier meurt en 1923, Cocteau est anéanti. C'est à la suite de ce deuil qu'il commencera à fumer de l'opium, pratique qu'il n'abandonnera plus tout sa vie durant, sinon pendant l'Occupation.
Nous avons appris récement la découverte de plusieurs lettres écrites par Jean Cocteau, que nous ont-elles apportées?
La plupart des lettres retrouvées sont des lettres destinées à la mère de Jean Cocteau. Il les a écrites quand il se trouvait dans le sud de la France. Il y écrit surtout ce qu'il ressent après les morts de ses différents amis, comme celle de Radiguet. On comprendra que Radiguet était comme une drogue pour Cocteau, et l'on comprend ainsi pourquoi il tombera dans l'opium car pour lui c'était comme pour combler un manque. Cocteau le dira lui-même dans ses lettres: "La mort de Raymond m'a tué", "la mort de Raymond m'a laissé seul, comme un fou, au milieu des débris d'une maison de cristal", "j'essaye de vivre ou plutot d'apprendre à vivre à la mort que je porte en moi. C'est atroce."
Quelle a été l'influence de l'opium sur le livre Opium de Jean Cocteau ?
Cocteau écrit son livre lors de sa deuxième cure de désintoxication. Cependant, il n'arrête pas sa consommation. Il peut écrire pendant des moments de "manque", où il perd complètement ses moyens, tremble, transpire... tout comme sous l'emprise de la drogue. Dans ces moments-ci, il expliquera l'effet que produit l'opium : il se sent euphorique et critiquera la médecine. Pour lui, la médecine ne devrait pas perfectionner la désintoxication, mais devrait plutôt essayer de rendre l'opium inoffensif. [...]
> Quizz par ici : http://tpe-opium.e-monsite.com/pages/quizz/quizz.html
07:00 Publié dans Ecrits, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pipe, tabac, fumer, opium, cocteau, paul stho
vendredi, 24 mai 2013
The-blue-pipe - XI - L'opium ou la cuisse - Jimmy Kempfer

Extrait de "Sexe, opium et morphine dans la littérature et l'histoire", Jimmy Kempfer : http://www.pistes.fr/swaps/52_165.htm
De l'Antiquité aux fumeries de l'époque coloniale, opiacés ont souvent rimé avec sexualité. Florilège.
"Jouir" serait, selon certains chercheurs, la signification de Hül-Gil, la désignation du pavot la plus ancienne que l’on connaisse, provenant d’une tablette sumérienne vieille de 5000 ans1. Depuis des temps immémoriaux, la consommation de substances psychoactives, notamment l’opium, est associée à la sexualité. Dans l’antique Rome, on préparait le Cocetum, un breuvage à base de pavot, pour détendre et préparer les jeunes Romaines à l’union conjugale. D’anciens traités médicaux arabes et indiens sont entièrement consacrés aux "pilules de la joie" 2, souvent à base d’opium, censées permettre aux riches levantins d’honorer leurs harems sans faiblir. A la cour des grands Moghols, bien des dignitaires sont opiophages car astreints à honorer d’innombrables concubines.
Les grimoires du XVe au XVIIIe siècle contiennent de nombreuses recettes, dans lesquelles on trouve souvent l’opium, pour "dénouer l’aiguillette" 3 ou "réactiver le feu qui couve sous la cendre". Les recettes aphrodisiaques de Cosme Ruggieri, le parfumeur de Catherine de Médicis, sont généralement opiacées.
Nicolas Venette, connu comme le fondateur de la sexologie, publie un des best-sellers du XVIIIe siècle : Tableau de l’amour conjugal ou histoire complète de la génération de l’homme. Il y décrit minutieusement les effets exhilarants de l’opium qu’il a complaisamment essayé sur lui-même et qu’il recommande selon de savants dosages et mélanges pour "parfaire les fonctions qui complaisent à Venus". Parallèlement, le laudanum4 est recommandé pour diminuer l’impétuosité de la nature afin de combattre "le fléau de l’onanisme". Les médecins avaient bien sûr remarqué "l’atrophie des facultés génésiques", effet secondaire fréquemment lié à la consommation régulière et à l’abus des opiacés. Selon la logique de l’époque, la masturbation était bien plus nocive que la dépendance à l’opium5.
Nous voyons là une même substance paradoxalement recommandée tantôt comme stimulant des rapports sexuels, tantôt pour favoriser la continence, la différence des effets étant souvent liée au dosage. Mais le contexte et la subjectivité sont à considérer également. Par ailleurs, l’opium étant le principal produit psychoactif connu, il était employé pour traiter d’innombrables troubles et pathologies.
Dans Valentine (1832), George Sand décrit de façon exemplaire l’emploi paradoxal de l’opium en fonction du contexte et de la motivation. Une femme mariée à un homme qu’elle n’aime pas se sert une double ration d’opium, avant la nuit de noces, pour avoir les sens totalement anesthésiés, ne ressentir aucune sensation et être "absente" durant l’acte. Mais lorsque, la formalité accomplie, le mari s’est retiré, son amant se glisse chez elle. Elle se réveille alors et "l’entoure de ses bras dans un ravissement opiacé".
Durant le XIXe siècle, de nombreux ouvrages médicaux recommandent invariablement l’opium, mélangé avec d’autres plantes telles la valériane mais également des solanacées6, pour traiter les "érotomanies" comme la nymphomanie, la "fureur utérine" et même la "satyriasis"7.
Les premières morphinomanes mondaines "qui entrent dans la morphine par la porte de la volupté" (par opposition aux personnes devenues morphinomanes suite à des affections douloureuses que la drogue soulageait) parlent de "ravissements extatiques" pour qualifier les effets d’une piqûre. Peu à peu naît une terminologie où la morphinomanie est associée à la recherche de voluptés et de jouissances immorales8. Les illustrations et descriptions sont puissamment suggestives pour une société qui considère la vue d’un mollet comme hautement érotique. Dans l’imaginaire "fin de siècle", la morphine est souvent associée aux visions d’une injection furtive, jupe relevée, dans la chair nue du gras de la cuisse, au dessus de la jarretière.
Peu à peu, la morphinomanie va être liée à la "déviance" sexuelle, surtout féminine. Le terrain est fertile pour susciter fascination et phantasmes et... faire vendre du papier. Des écrivains écrivent de pseudo-reportages riches en descriptions explicites. Quelques "spécialistes" évoquent l’utilisation de la morphine par des amants possessifs qui intoxiqueraient leur maîtresse pour "calmer ses ardeurs génésiques et s’en réserver l’exclusivité"8.
Le sujet est porteur, et les ouvrages décrivant "les langueurs, les débauches et la perversité dans lesquelles s’abîmeraient les demi-mondaines"9 sont nombreux. Les livres censés "porter l’effroi chez les gens du monde qui auraient envie de toucher jamais à la morphine"9 semblent susciter attrait et fascination, et contribuent à façonner pour des générations des représentations des drogues intimement associées au vice, à la prostitution et à une sexualité débridée fantasmée. Les innombrables éditions illustrées de belles alanguies dans les vapeurs d’opium des Paradis Artificiels de Baudelaire en témoigneront. Si le bourgeois éprouve "une peur exquise" devant la fascination de la "fureur utérine" que la morphine pourrait provoquer chez la femme, il admet par contre tout à fait que les filles de joie se droguent pour supporter leur métier.
Le mouvement de la "décadence fin de siècle" renforcera encore fortement l’association entre drogue et débauche. Les journaux à sensation rivalisent dans la surenchère. La passion de la morphine exacerberait les plus bas instincts, les narcotiques détraqueraient gravement l’orientation sexuelle et seraient la cause de la perversion pathologique de nombreux "invertis" et autres homosexuel(le)s. Quelques eugénistes voient là un avantage qui limiterait la reproduction des dégénérés. Pour d’autres, la morphine menace directement la natalité. La diatribe de Lefevre est édifiante : "La morphinomanie abolit les fonctions génitales, et c’est à l’impuissance absolue que courent les morphinomanes s’ils ne guérissent de bonne volonté ou contraints par d’énergiques conseillers"8. Précisons que la morphine était pure, facile d’accès, d’un prix raisonnable. Si la consommation moyenne se situait souvent aux alentours de un à deux grammes par jour, les quantités consommées par certains pouvaient dépasser les dix grammes par jour. A ce stade, il est évident que la libido est sérieusement neutralisée.
A partir du début du XXe siècle, des livres comme La divine Diane Kline, Lélie fumeuse d’opium, et les oeuvres de Claude Farrère, Maurice Magre ou Aldelswarth Fersen, souvent richement et explicitement illustrés, contribuent fortement à alimenter les imaginations. Bien des maisons de tolérance chic installent des fumeries d’opium. Les petites alliées et Fumée d’opium, de Claude Farrère, La tendre camarade, de Maurice Magre, restituent avec force détails comment activité sexuelle et opium sont intimement associés dans les bordels des ports de la métropole et les fumeries huppées des colonies. Les hommes y passent de longues heures en compagnie de Congaï très prévenantes qui, entre caresses et massages, préparent des pipes d’opium. A Java, les fumeries se situaient toujours à côté des "bordels" afin de pourvoir à l’essentiel et à l’agréable, selon le bon plaisir et la fantaisie des fumeurs. La littérature de ce pays comporte d’ailleurs un édifiant et très populaire poème mystique autour de l’opium créateur et aphrodisiaque : Suluk Batoloco.
Dans Le pur et l’impur, Colette, qui se rend parfois dans les fumeries parisiennes, décrit magistralement l’ambiance de frôlements, de soupirs, de halètements et de petits cris émanant des alcôves où se lovent les couples.
Durant les années 1920, La Garçonne de Victor Marguerite donne le ton. Cette héroïne des années folles est indépendante et n’a pas peur d’affirmer ostensiblement qu’elle fume de l’opium (et prise de la "coco") avant de faire l’amour. Parallèlement, toute une littérature coloniale présente l’usage de l’opium d’une façon insidieusement attractive : un "vice oriental" acceptable tant que cela se passe "aux colonies". Les descriptions des effets, généralement totalement fantasmés, y sont empreints d’une constante "érotisation" du ressenti. Les protagonistes subissent leur attirance pour la drogue qui les fait sombrer avec une bienveillante indulgence dans la luxure et les excès. Dans l’imaginaire de nos arrière grands-parents, l’opium étaient souvent intimement associé à la prostitution, la débauche et donc à la sexualité.
Yves Salgues, journaliste d’après-guerre auteur de L’héroïne, une vie (Ed. JC Lattes, 1987), s’adonna à l’opium durant l’occupation avant de tâter, puis de préférer l’héroïne. Voici comment il décrit certains effets de l’opium après ses premières pipes : "Une immense volupté d’être, une extase physique de chaque cellule... Le sexe raide, l’idée ne vous viendrait pas de saisir votre verge pour une masturbation... Vous vous laissez flotter, la pine à l’équerre, scrupuleusement attentif à ce qui se passe à l’intérieur."
Pour Albert de Pouvourville, "le potentiel de conscience sensorielle est décuplé. L’opium incite à la langueur, à savourer un état de tension érotique durant des heures, en dehors de tout acte sexuel, les seules limites sont celles d’une imagination, qui par définition, sont abolies par l’action de la drogue"10.
[…]
> Pour la suite : http://www.pistes.fr/swaps/52_165.htm
1 Merlin Mark David, On the trail of the ancient opium poppy, Associated University Presses, Londres, 1984.
2 Rätsch Christian, Encyklopädie der psychoaktiven pflanzen, Botanik, ethnopharmakologie und anwendung, AT Verlag, Aarau, 1997.
3 Lorsqu’un homme était incapable de pénétrer sa femme, il était fréquent d’attribuer cette impuissance à un maléfice : "l’aiguillette nouée". Le remède consistait souvent en des pénitences accompagnées de potions ayant des propriétés déshinibantes et contenant généralement opium, plants de chanvre femelle, sarriette et autres "herbes aux satyres".
4 Teinture alcoolique d’opium aromatisée au safran, très utilisée jusqu’au début du XXe siècle pour soulager la douleur et toutes sortes de troubles physiques ou moraux.
5 Duché Didier Jacques, Histoire de l’onanisme, PUF, 1994.
6 Plantes contenant de l’atropine telles le datura, la belladone, la jusquiame.
7 Quetel Claude, Morel Pierre, Les fous et leurs médecines de la Renaissance au XXe siècle, Hachette Littérature, 1979.
8 Yvorel Jean-Jacques, Les poisons de l’esprit (Drogues et drogués au XIXe siècle).
9 de Liedekerke Arnould, La belle époque de l’opium, aux éditions de la Différence, Le Sphinx, 1984.
10 Te Duc Nguyen (Albert de Pouvourville alias Matgioi), Le livre de l’opium, Ed. Guy Tredaniel, 1979.
07:00 Publié dans Ecrits, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pipe, tabac, fumer, opium, sexe, jimmy kempfer
mercredi, 22 mai 2013
The-blue-pipe - IX - and she is soon to be mine - Phlippe Sollers
 Philippe Sollers
Philippe Sollers
Extrait d'une conversation entre Philippe Sollers e Jacques-Alain Miller, 2005 :
Jacques-Alain Miller : Vous devenez voyant, ou bien ça devient plus apparent. La sociomanie...
Philippe Sollers : Vous savez d'où vient ce mot, de voyant, et là vous appelez Rimbaud. C’est raconté par Baudelaire dans les Paradis artificiels, c’est-à-dire les soirées dans les soirées. Il décrit les soirées, les parties de prise de drogue, c’est-à-dire de haschisch à l’époque. Théophile Gautier, Baudelaire, Balzac qui refuse l’expérience. Le type qui restait sobre, et qui jouait un peu de piano pour faciliter les évolutions hallucinatoires, qui était donc en somme chargé de la sécurité des participants, s’appelait "le voyant", c’est-à-dire celui qui voyait juste, et non pas celui qui avait un transport de voyance. Parce que dans ce moment-là, la voyance, en effet, défile, à plein flots. C’est très intéressant à relire les Baudelaire là-dessus.
[...]
> Pour la suite : http://www.pileface.com/sollers/article.php3?id_article=1...

Antoine Gallimard
Source : http://www.estrepublicain.fr/actualite/2011/09/17/chaque-...
Extrait de Bibliobs, Philippe Sollers, 2011 :
Sans la littérature et l'art, nous ne connaîtrions qu'un petit monde étriqué, celui de la finance, des philosophes ou des idéologues, c'est-à-dire, aujourd'hui, le nôtre. Où est passé l'infini ? On ne sait pas, et ce n'est pas la télévision qui vous le dira. D'où la surprise renouvelée en ouvrant l'immense Thomas De Quincey (1785-1859), qui, avec Shakespeare, Poe, Coleridge et Melville, est la gloire de l'anglais, désormais aplati en langue de communication universelle. "Confessions d'un mangeur d'opium anglais" est la première brèche à travers ce qui s'annonçait déjà comme fermeture de l'être humain par rapport à lui-même. Disons les choses : la vie intérieure vous est interdite, vous êtes là pour rumnier les clichés sociaux qu'on vous sert. La sinistre mondialisation du Spectacle bouche toutes les issues. Baudelaire et d'autres vous ont averti, en vain. Pourtant, quelque chose persiste à vous appeler personnellement vers une expérience.
De Quincey souffre beaucoup. Un jour, pour calmer ses douleurs insupportables, il achète du laudanum dans une pharmacie de Londres. Et, là, coup de théâtre : "Dans l'espace d'une heure, ô ciel ! Quelle révolution ! Quelle surrection de l'esprit intérieur du tréfonds de ses abîmes ! Quelle apocalypse du monde que je portais en moi !".
L'opium a mauvaise réputation : il serait religieux pour endormir les masses, il détournerait du travail en répandant la torpeur. De Quincey, avec une précision médicale, apporte ici un témoignage essentiel et très dérangeant. Contrairement à l'alcool, qui dépouille un homme de sa maîtrise de soi, "il communique sérénité et équilibre à toutes les facultés, actives ou passives". Telle est la révélation : "Le mangeur d'opium ressent que la partie divine de sa nature est souveraine : ses sentiments moraux connaissent une sérénité sans nuages, et, au-dessus de tout, brille avec majesté la grande lumière de l'intelligence." L'opium n'abrutit pas, au contraire, il est "éloquent". Si c'est une religion, il s'agit d'une Eglise dont le sujet concerné est le seul membre, et elle est fondée sur "un abîme de divine volupté". "Ô juste, puissant et subtil opium !". Il bouleverse toutes les coordonnées habituelles, destitue tous les pouvoirs, se balade dans toutes les dimensions, vous offre le paradis mais aussi l'enfer. Si vous en sortez vivant, comme De Quincey, on pourra dire que vous savez vraiment ce qu'est la santé et l'intelligence. Rien à voir avec la vertu ni avec la morale, l'opium ouvre sur une vérité qui est à la fois délice et horreur.
Dans le paradis, le monde et vous même devenez un opéra fabuleux, et la musique se met à vivre intensément pour elle-même. Voyez De Quincey écoutant avec passion une cantatrice italienne, "la Grassini". L'opium multiplie l'harmonie, le chant, les vocalises. Vous entendez bien au-delà de ce qui s'entend. Surtout, sa magie vous prouve à quel point vous n'avez, le plus souvent, qu'une perception misérable de l'espace et du temps. L'espace est illimité, le temps sans mesure. Vitesse, intuition, métamorphoses, mais aussi grand calme. "L'ocean, avec sa respiration éternelle, mais aussi par son grand calme, personnifiait mon esprit et l'influence qui le gouvernait alors." Attention, le tempête s'approche, et tout se renverse dans "la véhémente chimie des rêves". L'espace devient une succession de prisons à la Piranèse, et "la tyrannie de la face humaine" envahit le rêveur : "L'Ocean m'apparut pavé d'innombrables têtes tournées vers le ciel, des visages furieux, désespérés, se mirent à danser à la surface, par milliers, par myriades, par générations, par siècles."
L'aventurier a dépassé les limites humaines, c'est comme si des foules lui faisaient sentir leur détresse, comme si elles se vengeaient sur lui des massacres dont elles sont l'objet. L'espace s'enfle et se déchire, le temps déborde de partout, le mangeur d'opium a l'impression d'avoir vécu cent ans ou mille ans en une nuit, le moindre incident de son enfance est là, sous ses yeux, comme dans la vision panoramique de certains noyés ou mourants. Normal : le cerveau humain est un palimpseste immense et naturel, un manuscrit sans cesse recouvert de nouvelles écritures, mais qui reste en attente d'un déchiffrage nouveau. [...]
> Pour la suite : http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20110420.OBS1640/voy...
07:00 Publié dans Ecrits, littérature contemporaine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pipe, tabac, fumer, sollers, miller, opium, gallimard, antoine gallimard, pléiade, de quincey







