jeudi, 30 mai 2013
La gloire de Rubens - Philippe Muray, Rubens, Rembrandt

Philippe Muray (1945-2006)
Extrait de La gloire de Rubens, 1991, Philippe Muray, Grasset :
[...]
Rubens m'appelle depuis toujours. Son tumulte est si loin du bruit de ce qui a l'air de se passer ! Tellement à côté de la plaque ! De toutes les plaques tournantes et chatoyantes de l'éternel retour du Rien contemporain ! [...] Je croyais parler d'autre chose, mais c'était mon désir de lui, en rêve, qui me faisait vivre. C'était lui qui gonflait mes phrases, les prolongeait, les poussait ; lui dont j'entendais siffler les voiles et les cordages, et rouler la houle sous mes pieds ; lui dont la forêt se balançait partout où j'allais ; lui qui bouillonnait dans tout ce que j'aimais ; lui dont le ciel filait en accéléré avec ses femmes nuages plus grandes que nature bien au-dessus de mes pages.

L'union de la terre et de l'eau, Rubens
J'avais à peine vu deux ou trois de ses tableaux, que je savais déjà que je n'en aurais plus jamais fini d'aimer les autres. Que les moindres hésitations de cette main infaillible me transporteraient. Que ses plus pâles croquis feraient de moi ce qu'ils voudraient. Que quelque chose de plus vaste, de plus hors de proportions que le reste, avait été laissé, là, par un dieu, pour moi, pour augmenter et confirmer le bonheur d'exister. "Ma confiance en lui fut immédiate", écrit Nietzsche de Schopenhauer dans la troisième des Considérations inactuelles : je pourrais faire la même observation à propos de Rubens, mais aussi de Balzac et de quelques autres, bien rares, dont l'oeuvre se déroule comme une victoire paisible et sans fin, comme un triomphe confirmé sur la maladie mentale la plus répandue, comme un baume sur la disgrâce la moins guérissable, comme un défi à tout ce qui sous les noms d'angoisse, honte, désir de punition, sentiment de cette incurable tournant en réquisitoire enragé, appels à la Loi, indignation, dénonciation perpétuelle, calomnies, ragots, obsession de procès ou procès réels, frémit, en secret ou non, dans les sociétés. Voilà : je viens d'énumérer ce que n'est pas Rubens, ou du moins l'essentiel de ce que ses traces effacent. La Culpabilité est l'ardeur du monde. Son foyer de toujours. La source de ses acharnements, même somnambuliques. En un sens, c'est vrai, nous sommes maintenant archi-morts ; ou tellement falsifiés que nous n'aurions plus aucun moyen de distinguer la moindre vérité, s'il en passait une. Tellement irradiés d'images, aussi, qu'on s'attendrait à voir comme une lumière d'un autre monde traversant nos silhouettes conditionnées, transperçant ce qui reste de nos systèmes sanguins ou nerveux mis à nu. "Te voilà comme une carcasse abandonnées par les corbeaux... on voit le jour à travers !" clame Josépha devant le baron Hulot qu'elle a contribué à ruiner et à dévaster. Plût au ciel que ce soit encore le jour qui filtre à travers nos carcasses à nous ! Si une lueur traverse jamais les fantômes que nous sommes devenus, ce ne pourra être que celle de nos écrans de télé aveugles en train de nous regarder.

Samson et Dalila, Rubens
Mais, en un autre sens, nous sommes encore vivants, tout de même, puisque nous durons et que nous désirons et que nous nous reproduisons (ou que, du moins, nous faisons comme si tout cela continuait). Nous sommes là, encore, et nous tenons à ce que ça se sache, à ce que ça se dise, à ce que ce soit pris au sérieux et même au tragique, et il serait impossible d'y arriver si nous n'avions pas la Culpabilité comme alliée. La Culpabilité qui mène la danse, partout, en nous et jusqu'au bout. L'oeuvre de Rubens dévoile du fond des âges cette réalité. Elle n'en parle pas, elle fait mieux, elle la rend audible et perceptible par la beauté qu'elle déchaîne pour montrer qu'on peut vivre autrement qu'en faute ou en dette. Comment ? Par quel miracle d'arrogance, de luxe, de voracité sensuelle qui se moque du reste ? Par quelle ignorance des stéréotypes acceptés ? C'est toute la question. [...]
La fidélité la plus encrassée conduit la planète comme jamais. Nous nous imaginons tous je ne sais quels devoirs afin d'immobiliser les autres sous la même coupe triste que nous. [...]
[...] "L'Humanité ne sera sauvée que par l'amour des cuisses. Tout le reste n'est que haine et ennui", déclarait Céline (dont le style giclant, tout de spasmes et d'écume, est le seul aujourd'hui, à la hauteur du feu rubénien), avant de se tromper dramatiquement de sauvetage en oubliant l'amour des cuisses. Oui, nous savons bien qu'il n'est pas de plaisir qui ne retombe un jour en morosité, reproches, scènes, cris ; oui, nous savons que les voluptés les plus extasiantes finissent en plaintes, couinements, grincements de dents, exigences et sifflements de serpents. Les commencements sont plus beaux que les conclusions, mais pourquoi privilégier celles-ci plutôt que ceux-là ? [...]
J'ai toujours rêvé d'illustrer mes livres avec ses tableaux. [...]

La chute des anges rebelles, Rubens
[...] Amnésique après un bombardement, sans précédent, l'artiste ou l'écrivain de maintenant ressemble à ces individus que l'on retrouve parfois, sur les quais des gares, sans papiers, sans mémoire, et qui ne savent plus d'où ils viennent, qui ne connaissent plus leur nom, ni leur adresse, ni leur famille, ou qui préfèrent peut-être les avoir oubliés.
[...] Tout artiste hors du commun est reçu par la communauté en quelque sorte malgré elle ; mais la puissance de cette œuvre-ci, plus cruellement encore que n'importe quelle autre, nous renvoie à notre petitesse. A nos infirmités. A notre absence de facilité. A nos effondrements sentimentaux. A nos crédulités. Personne, par exemple, ne pardonnera jamais à Rubens d'avoir été l'artiste le plus follement cultivé de l'histoire de la peinture, et de ne pas avoir pris la précaution raisonnable de le cacher.

L'éducation de Marie de Médicis, Rubens
[...] Le Louvre ! La Galerie Médicis ! C'est du fond des murs que la Richesse vous regarde. "Le dieu est là", comme ont écrit un jour les Goncourt. J'y vais, je m'y précipite comme à la Tapisserie de la Licorne de la peinture, comme au spectacle de la victoire en vingt batailles contre l'insane Sentiment de la Nature. Et tout, autour, tremble en s'effaçant, les rues, les voitures, les monuments, les affiches de pub, les immeubles, le fleuve et ses ciels, et, bien sûr, la Pyramide ! L'entrée du mausolée, géométriquement dédiée aux prétentions à la Transparence de notre fin de siècle culpabilisé d'avoir tant joui de tant de tyrannies. Tout s'efface comme par enchantement parce que plus rien, depuis longtemps déjà, ne tenait debout.
[...]
Rubens encourageant ? Ca dépend pour qui.
Sa différence fondamentale avec Rembrandt, c'est que ce dernier vous prend avec une admirable sauvagerie fraternelle par la gorge, par les tripes, par les désagréments de l'existence quotidienne, par les chagrins, par la folie, par toutes les larmes de sang qui ne demandent qu'à ruisseler sur nos entrailles ouvertes. La spiritualité d'un boeuf pendu n'a pas d'équivalent chez Rubens, regrettablement peu sensible à notre origine de mammifères, comme à la vanité planant sur les destinées humaines. Comparez les personnages qu'ils mettent en scène : ceux de Rembrandt dérivent dans le sillon d'une mélancolie prodigieuse, ils souffrent de tout, ils sont comme nous, ils sont nous, la lumière les mange, l'ombre les divise, l'espace et le temps les recrachent dans le no man's land des causes perdues [...].

Le philosophe en méditation, Rembrandt
Rembrandt éclaire d'un jour tremblant et sublime de méditation notre pèlerinage de raclés d'avance. C'est le poète épique définitif de la Faillite, le champion du Grand Jeu de l'Echec sans remède, le roi du Damier des Paumés, le peintre du Tournoi maudit. L'ascète aux autoportraits délivrés en avalanche comme autant de permis d'inhumer. D'où sa victoire universelle. [...]
Le plaisir n'est pas la vie, ou alors depuis le temps, ça se saurait. La douleur ne passe jamais de mode, elle, et c'est directement au ventre, Rembrandt, qu'il nous parle, là où sont grandes ouvertes nos oreilles d'affamés d'amour. A l'intérieur. En plein tragique. Il nous visite tard, la nuit, comme un fantôme de bronze poudreux. S'il nous fait craquer, s'il est si génialement déchiré, c'est qu'il n'arrête pas de peindre, dans sa pénombre d'or fondant, le deuil de tout ce que nous n'avons pas eu. La communication ne se fait jamais vraiment à fond que sur des échecs. Plus que sur des crimes, moins spectaculairement mais plus sûrement, toute société est fondée et fermée sur des ratages commis en commun. Rien ne fait plus groupe que le fiasco en soi. Rien ne fédère davantage que le retour bredouille. Les seuls succès véritablement appréciés par la communauté sont ceux qu'elle accorde de façon posthume. Que votre objet vous échappe toujours, jusqu'au dernier moment, et c'est gagné pour la postérité ! Tout, avec le temps, peut devenir magie aux yeux de la société, à condition qu'elle se soit livrée, avant, à quelque torture. Rattraper le coup, réparer des injustices : nous ne nourrissons pas de plus grande passion ; encore faut-il que, de ces injustices, nous ayons été d'abord les agents vigilants.
[...]

Vieille femme en train de lire, Rembrandt
[...] Je suis persuadé que le bonheur de Rubens, c'est-à-dire sa non culpabilité phénoménale, commence là, dans l'incapacité de son système nerveux à se désavouer, dans son impossibilité à préférer son père plutôt que lui-même. Tout ce qu'il veut, au fond, tout ce qu'il cherche, il le dit, il le répète à ses intimes : ce n'est même pas tellement la gloire, même pas la puissance, ni la découverte d'une vérité des abîmes, c'est mourir un peu plus instruit. Pour cela il faut peindre, bien sûr, énormément. Ne jamais s'arrêter. Ne pas se laisser accabler. L'Empire de la Dette lui est inconnu, la discorde le visite rarement, le conflit l'effleure, sans doute, comme tout le monde, pour finalement le laisser intact. Il est difficile d'imaginer quelqu'un d'aussi peu divisé. Mais enfin où sont ses manques ? Ses clivages ? Quel est l'impossible que poursuit son désir ? Où sont ses déconvenues, ses dépressions, son désespoir ?
Mystère, mystère complet.
Est-ce qu'on pourrait imaginer, seulement imaginer, sans rire, quelque chose qui s'appellerait, par exemple, la Complainte du pauvre Rubens ?
[...]
J'ai conscience, parlant de Rubens, de sortir de l'histoire sainte. Le grain de sable qui fait hurler la mécanique avant de la casser, c'est lui. Il est bien trop comblant pour être honnête. On en a plein les mains, les oreilles, le cerveau. Le romantisme humain (pléonasme) a besoin, pour se sentir repu, de rester un peu plus que ça sur sa faim. Le nécessaire, déjà, lui flanque des indigestions, mais que dire alors du superflu, qui le met à l'agonie ! Rubens, c'est une grève du zèle de la peinture comme on n'en a jamais vu, le comble de l'archi-comble, toutes les mesures dépassées. Chaque récit dont il s'empare, chaque sujet qu'il traite, on sent qu'il le laissera sur le flanc après. La tâche du commentateur est mâchée d'avance, ce n'est même plus drôle. Non seulement il sait ce qu'il peint, mais en plus il fait savoir qu'il le sait, c'est décourageant.
Vous lui demandez, pour la cathédrale de Tournai, une Libération des âmes du Purgatoire ? Il vous déchaîne un geyser de fesses et de seins féminins jaillis en diagonale vers le Tout-Puissant.

Libération des âmes du Purgatoire, Rubens
Vous voulez Angélique endormie convoitée par un ermite ? Ah il ne se fera pas prier, il va vous la mettre, la merveilleuse, sous le nez, en gros plan, c'est un discours calme et définitif sur la convoitise, depuis le bout groseille des seins jusqu'à l'insistance ultime sur l'extrémité de voile transparent pincé entre deux cuisses huilées de rose chaud et sur le point de s'ouvrir. Et ce nombril moulé par la chemise trempée de sueur de la Sainte Marie-Madeleine en extase au Musée de Lille, longue pâmoison verte entre deux anges vigoureux !

Angélique et l'Ermite, Rubens
Et cet autre tableau fou du Palazzo Pitti, à Florence, l'une de ses dernières toiles, l'une de ses projections les plus voluptueusement déchaînées, aussi : Vénus cherche à retenir Mars ou les Conséquences de la guerre. Ce sont ses "horreurs de la guerre" à lui, mais voyez la différence avec le Trois mai de Goya : Rubens est pour la paix, bien sûr, comme tout le monde, qui n'est l'est pas ? Mais il l'est d'autant plus à fond que c'est un thème convenu et qu'il adore les thèmes convenus qui lui permettent de peindre des nus.

Allégorie de guerre, Rubens
Le Trois mai, Goya
Et ces Assomptions, où la Vierge est un point d'exclamation théologique perpendiculaire aux cercles remuants des êtres restés à terre ! Tout son discours royal, d'ailleurs, est fait d'apostrophes et d'exclamations. Il peint des voix, les siennes, les autres, chacun de ses personnages est la pointe sensible d'une déclaration, un fragment de conversation. Ses tableaux s'entendent, c'est rare. Tous ces déplacements font du bruit, ces corps qui bougent sont perceptibles. Audibles. Toutes ces bouches ouvertes soupirent, chuchotent, appellent, rient. Demandent et répondent. L'esprit classique naissant, le "bon sens naturel", la raison ("mais la raison accompagnée de toute la pompe et de tous les ornements dont notre langue est capable", corrigera Racine un peu plus tard), s'engouffrent dans sa peinture pour en ressortir maquillés, tourbillonnés, gonflés, travestis, allégorisés, déshabillés, et surtout parlants. Parlants à tout bout de champ. Le dialogue c'est l'empoignade de la Raison avec elle-même. Versailles est encore loin, les sociétés européennes commencent seulement à apprendre à s'expliquer, la syntaxe s'explore elle-même, des salons sont en cours de constitution, et Rubens, très en avance sur ces pionniers du raffinement, est peut-être le seul peintre qu'on se surprend à recevoir comme un concert, un festival de périodes oratoires enflammées, développées, affrontées.
[...] A Paulhan qui voulait qu'il donne des articles à la NRF, Céline répondait en 1933 : "j'écris très lentement et seulement dans d'énormes cadres et dans le cours d'années. Ces infirmités diverses me condamnent aux monuments que vous savez. Rubens, lui aussi, est condamné aux monuments, aux énormes cadres, lumineuse punition ! Je confesse, dit-il un jour, "d'être, par un instinct naturel, plus propre à faire des ouvrages bien grands que des petites curiosités." Oui, il y a des gens comme ça, il n'est pas le seul : "Ne me parlez de rien de petit !" lance Bernin à Colbert. Et Delacroix : "La proportion entre pour beaucoup dans le plus ou moins de puissance d'un tableau. Et Dostoïevski, plus tard, avouera ne pouvoir s'exciter sur un roman que lorsqu'il a mis en place et noué ensemble les matières d'au moins deux ou trois gros livres.
[...]
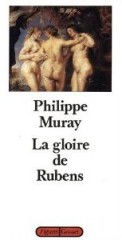 Se procurer l'ouvrage :
Se procurer l'ouvrage :
La gloire de Rubens
Philippe Muray
1991
Grasset
284 pages
07:00 Publié dans Beaux-Arts, Ecrits, littérature contemporaine, Peinture, Réflexions, philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la gloire de rubens, rubens, rembrandt, philippe muray
mercredi, 29 mai 2013
La dissonance cognitive - Philippe Muray

Philippe Muray (1945-2006)
Extrait de On ferme, Philippe Muray, Les Belles Lettres, troisième tirage, p.556 :
De quoi est-ce que Bérénice parlait maintenant ? Hein ? De la "dissonance cognitive" ? Elle en était devenue, ces derniers temps, une adepte des plus farouches. C'était une théorie formidable qu'elle mettait en pratique, à l'occasion, dans certains de ses séminaires. Pourquoi est-ce qu'elle lui parlait de ça ? Le monde continuait à se déformer. « On n'engage vraiment quelqu'un, de nos jours, mais alors ce qui s'appelle engager, c'est-à-dire esclavagiser, qu'en lui racontant qu'il est libre de ne pas faire ce qu'on a décidé qu'il fera. Tu comprends ? On insiste : c'est à lui de voir ! À lui de choisir ! De se décider ! Déclaration de pleine liberté ! » Le monde ne se déformait plus du tout. Il avait cessé d'exister. La "dissonance cognitive". Il ne comprenait rien à ce qu'elle disait. Il n'arrivait pas à se concentrer. Il racontait n'importe quoi.
 Se procurer l'ouvrage :
Se procurer l'ouvrage :
On ferme
Philippe Muray
2011
Les belles lettres
677 pages
http://www.amazon.fr/ferme-Philippe-Muray/dp/2251444270/r...
07:00 Publié dans Ecrits, Les mots français, littérature contemporaine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe muray, on ferme, les belles lettres, dissonance cognitive
mercredi, 08 mai 2013
Keep your hat on






http://www.youtube.com/watch?v=fpEmIUFXJK0&feature=pl...
Extrait de Chantal Delsol à propos de l'ouvrage qu'elle a postfacé Philippe Muray, la femme et Dieu, Maxence Caron, Artège, 2011 :
[...]
La hantise de Muray demeure l’anéantissement de la domination masculine : c’est cela, la castration dont sans cesse il se plaint. Muray décrit la période post-historique comme une période d’indifférenciation entre les sexes, ce qui est réel sur le mode pervers, mais le contemporain ne se confond pas avec sa perversion. Muray a inventé le féminihilisme – ce qui montre à quel point pour lui le nihilisme se nourrit essentiellement de revendication féminine. Le paradis, c’est le moment où l’on peut encore identifier la jouissance et le divin – ce qui ne laisse à la femme d’autre marge de manœuvre que celle d’un objet sophistiqué : ce fut le dernier mot de Shelley et de Sade. Lorsque le plaisir est, comme dit Maxence Caron, « le lieu de toute mesure ontologique », il faut bien s’enfermer dans la violence à l’égard de l’être qui confère le plaisir.
[...]
> Pour le texte intégral qui figure sur le blog de Chantal Delsol : http://www.chantaldelsol.fr/philippe-muray/
> Pour la page Wikipedia de Chantal Delsol : http://fr.wikipedia.org/wiki/Chantal_Delsol
Extrait d'un poème de Philippe Muray paru dans Minimum Respect, Les Belles Lettres, 2003 :
Ton insupportable portable
A sonné quand je te mettais
Tu ne t'es même pas décrochée
Pour répondre c'est incontestable
J'avais ton cul à marée haute
Et ta chevelure qui tressaute
J'avais tes seins en ligne de mire
On ne pouvait pas rêver pire
C'était Marcelin qui appelait
Car il préparait le dîner
Dans l'appareil il te criait
De surtout ne pas oublier
Tout ce que tu devais acheter
Lorsque tu serais rhabillée
Par cette belle soirée d'été
En nocturne au supermarché
Ton abominable portable
A sonné en pleine mélopée
Tu ne t'es même pas déplantée
Pour répondre c'est déraisonnable
J'avais ta bouche à bout portant
Tu n'étais pas au bout de tes peines
Moi j'étais à bout d'arguments
Tu étais belle en femme de peine
C'était Donata qui disait
Qu'elle ne pourrait t'accompagner
À votre cours de tai chi
Car elle avait physique-chimie
Elle était désolée bien sûr
Elle se sentait presque parjure
Ce n'était que partie remise
Pour l'instant tu étais bien mise
Ton intolérable portable
A sonné comme un incongru
Quand j'avais mon doigt dans ton cul
Tu n'étais pas très présentable
J'avais tes yeux en face des trous
Et j'avais tes trous plein la vue
Qu'est-ce qu'on pouvait souhaiter de plus
Que tes soupirs et tes remous
[...]
> Pour le texte intégral : http://philippemuray.e-monsite.com/pages/textes/morceaux-...



07:00 Publié dans Farce et attrape, Trivialités parisiennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : daft punk, star wars, chantal delsol, maxence caron, philippe muray
mercredi, 17 octobre 2012
Le prix de l'art - Philippe Muray

Philippe Muray (1945-2006)
Extrait de La gloire de Rubens, 1991, Philippe Muray, Grasset :
[...]
Il peut paraître provocant de dire que Rubens est la peinture par définition, parce que la peinture, toute la peinture semble au contraire s'étaler pour vous déconseiller ce détour. Et pas seulement la peinture, mais ce qui foisonne dans ses proximités, l'histoire de l'art, la critique d'art, les organisateurs d'art, directeurs d'art, conservateurs d'art, commissaires d'art, animateurs et réanimateurs infatigables d'art. Il y a belle lurette que tout ce petit monde passe son temps à faire maigrir la peinture comme les designers de mode firent maigrir les femmes pour vous dégoûter de la beauté pleine de leurs volumes comme de la splendeur saturante de celles de Rubens. Pourquoi ? Tiens donc ! Parce que si on y était arrivé vraiment, à Rubens, eh bien la mort de l'art, au lieu de se produire au XXe siècle, aurait peut-être eu lieu dès ce moment-là, dans ce milieu du XVIIe siècle où lui-même disparaît.
Le bout du tunnel aux illuminations serait alors apparu. La question esthétique aurait été réglée, quel temps gagné ! On se serait rendu compte que ce n'était plus la peine. Qu'il avait tout fait. Vous imaginez le drame ? Plus de marché ! Plus de cotes ! Pas de "Fondations" ! Pas d'inflation ni d'"installations" ! De catalogues ! De muséographie ! De commissaires ! De commentateurs ! Pas de messes anniversaires autour de l'art défunt ! Rien que le mouvement perpétuel de la gigantomachie rubénienne tournant, ivre, sans fin, jusqu'à la fin des mondes.
Le temps de la peinture est passé. J'établirai en quelques lignes comment et pourquoi il s'est terminé ; c'est fait. Plus on se fout de l'art, et plus il flambe. Il est heureux que la cote des peintres d'aujourd'hui, publiée désormais dans des revues en nombre croissant, dispense les spéculateurs d'avoir à s'approcher des œuvres elles-mêmes : ainsi leur foi a-t-elle des chances de rester intacte et leur enthousiasme inentamé. Les grands trafiquants de drogue, après tout, brassent bien les narcodollars en quantité astronomique sans être obligés d'approcher, dans toute leur vie, d'un gramme de coke ou d'héroïne. C'est d'un cœur plus allègre que l'on change le plomb en or si l'on ne touche pas trop au plomb et qu'on ne voit que l'or. Dans le cas de l'art, évidemment, cette invisibilité se complique d'une mystique sur laquelle il serait mal vu d'ironiser, dans la mesure où elle est le cache-sexe poétique qui permet aux lois du marché de ne pas être mises trop crûment à nu.
Comme toutes les lois, celles-ci reposent sur des cadavres. La poule aux œufs d'or a le croupion sur un cimetière : celui où furent enterrées, au XIXe, ces victimes sacrées de l'âge contemporain qu'on devait appeler Impressionnistes. Nous n'en finissons pas de payer le martyre de ces christs ! Tout est permis, depuis, en leur nom. En réparation de ce qu'ils ont subi. En pénitence de nos péchés. L'art dit moderne est une grande opération religieuse de contribution à la culpabilité publique.
La faillite est complète, mais on garde le moral. Aujourd'hui, tout le monde se marre en annonçant son propre naufrage. Mort aux tristes ! Des millions d'apparatchiks soviétiques ne viennent-ils pas de nous donner l'exemple de la plus saine gaieté en annonçant, tordus de rire, la disparition du communisme, c'est-à-dire, après tout, de leur fonds de commerce ? L'art est en cessation de magie, mais ses liquidateurs s'activent parmi les mouches avec bonne humeur. Pas de quoi pleurer. L'art est une catégorie rentable de l'ère des loisirs pour les masses résignées. L'Etat mécène providence poursuit sa tâche de dressage des citoyens en plantant aux carrefours d'inimaginables gadgets que l'on peut considérer comme autant d'étapes méthodiques et méditées dans la guerre qui se livre contre le goût à seule fin que celui-ci ne soit plus capable de servir d'instrument de mesure, donc de jugement, pour ce qui se présente comme nouveauté à adorer. Multiplier les commandes publiques est devenu le plus sûr moyen d'abolir le souvenir de l'art. On en voudrait encore plus, toujours plus, tous les jours ! Subventionner n'importe quoi est aujourd'hui synonyme de guerre contre l'art d' "avant". Même chose, d'ailleurs, en littérature : il est plus subtil de ne pas brûler les rares livres qui comptent, mais d'en faire écrire d'autres, à tour de bras, par des robots appelés "auteurs", dans l'espoir (en général comblé) que le flot de ces artefacts noiera les rares ouvrages de quelque intérêt qui risqueraient de voir le jour, ici ou là, malgré les considérables mesures de sécurité qui ont été prises.
Depuis que plus personne ne sait à quoi pourrait servir la peinture, on lui a trouvé une destination providentielle : elle sert à blanchir (de l'argent, mais pas seulement). La spéculation sur la nullité est une idée neuve en Europe et dans le reste du monde. Et plus ils payent, plus on sent que c'est aussi leur argent dont les amateurs voudraient qu'on ne sache pas qu'il est mort.
Et plus encore, peut-être, sont-ce les industries désolantes et superflues d'où ils tiennent, pour la plupart, cet argent, dont ils souhaitent que la nullité demeure inconnue. Golden boys japonais, américains, australiens, tous payent, donc, pour ne pas savoir ou pour empêcher qu'on sache.
Les seuls véritables spécialistes du néant contemporain, ce sont eux, pourtant. Comment ignoreraient-ils qu'il n'y a rien, dans le saint des saints, et que ça pourrait être démontré ? Une peur à la mesure des millions de dollars qui y sont engagés règne donc sur cet univers. Le mensonge est si énorme, si planétaire, qu'il faut qu'il soit éternisé pour ne jamais courir le risque d'être révélé.
Art et Thanatos ! Il était fatal que le siècle où les peintres se sont affranchis de toutes les lois soit celui où l'on aura vu les lois du marché venir y mettre leur ordre, le dernier qui puisse encore être respecté. Supprimer les obstacles, comme le déclarait Picasso, à rebrousse-poil de tout le catéchisme moderne, ce n'est pas la liberté, "c'est un affadissement qui rend tout invertébré, informe, dénué de sens, zéro".
En effet : beaucoup de zéros.
On ne raconte jamais à quel point, vers la fin de sa vie, il était exaspéré par le monde qui s'annonçait, Picasso. Je ne vois pas souvent citer ses pires réflexions, les plus amères, les plus lucides :
"Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que personne ne dit du mal de personne... Dans toutes les expositions, il y a quelque chose. En tout cas, à quelque chose près, tout est valable... Tout est sur le même niveau. Pourquoi ? Sûrement pas parce que c'est vrai. Alors ? Parce qu'on ne pense plus. Ou parce qu'on n'ose pas le dire."
Mais qu'importe l'art, après tout ? Tel qu'on le fait consommer de force aux populations hébétées, il n'est qu'une assurance de plus, un de ces "plus petits communs dénominateurs" consensuels dont notre détresse a besoin, et plus que jamais. L'effondrement de ces non-valeurs, s'il arrive un jour, ne fera pas pleurer grand monde. Le temps de la peinture est passé, parlons de Rubens. L'art comme je le conçois est un effort patient pour ne pas donner son consentement à l'ordre du monde, pour ne jamais se résigner à la passivité unanime devant toutes les formes de la mort inéluctable, y compris les plus souriantes, les plus apparemment rassurantes, celles qui veulent le plus votre bien. Ce n'était peut-être que cela, en fin de compte, que Rubens visait, quand il avouait son désir si simple, si "modeste", de mourir un peu plus instruit qu'il n'était né.
[...] En une époque plus récente, Stendhal a repéré les progrès de l'analphabétisme : "A mesure que les demi-sots deviennent de plus en plus nombreux, la part de la forme diminue." [...]
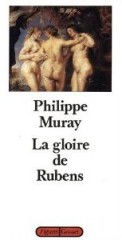 Se procurer l'ouvrage :
Se procurer l'ouvrage :
La gloire de Rubens
Philippe Muray
1991
Grasset
284 pages
http://www.amazon.fr/gloire-Rubens-Philippe-Muray/dp/2246...
08:04 Publié dans Beaux-Arts, Ecrits, littérature contemporaine, Peinture, Réflexions, philosophie, Thèse | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : la gloire de rubens, philippe muray






