mardi, 29 janvier 2013
Considérations sur la littérature - Balzac
Vous ne vous figurez pas ce que c’est que la Comédie humaine ; c’est plus vaste, littérairement parlant, que la cathédrale de Bourges architecturalement.
(Lettre à Zulma Carraud, janvier 1845)
> Pour diverses analyses et autres anecdotes :
http://debalzac.wordpress.com/tag/comedie-humaine/
> Pour des extraits illustrés : http://milema.canalblog.com/archives/la_comedie_humaine__...
Auto-préface de La Comédie humaine, 1842, Honoré de Balzac :
En donnant à une oeuvre entreprise depuis bientôt treize ans, le titre de la Comédie humaine, il est nécessaire d'en dire la pensée, d'en raconter l'origine, d'en expliquer brièvement le plan, en essayant de parler de ces choses comme si je n'y étais pas intéressé. Ceci n'est pas aussi difficile que le public pourrait le penser. Peu d'oeuvres donne beaucoup d'amour-propre, beaucoup de travail donne infiniment de modestie. Cette observation rend compte des examens que Corneille, Molière et autres grands auteurs faisaient de leurs ouvrages : s'il est impossible de les égaler dans leurs belles conceptions, on peut vouloir leur ressembler en ce sentiment.
L'idée première de la Comédie humaine fut d'abord chez moi comme un rêve, comme un de ces projets impossibles que l'on caresse et qu'on laisse s'envoler ; une chimère qui sourit, qui montre son visage de femme et qui déploie aussitôt ses ailes en remontant dans un ciel fantastique. Mais la chimère, comme beaucoup de chimères, se change en réalité, elle a ses commandements et sa tyrannie auxquels il faut céder.
Cette idée vint d'une comparaison entre l'Humanité et l'Animalité.
Ce serait une erreur de croire que la grande querelle qui, dans ces derniers temps, s'est émue entre Cuvier et Geoffroi Saint-Hilaire, reposait sur une innovation scientifique. L'unité de composition occupait déjà sous d'autres termes les plus grands esprits des deux siècles précédents. En relisant les oeuvres si extraordinaires des écrivains mystiques qui se sont occupés des sciences dans leurs relations avec l'infini, tels que Swedenborg, Saint-Martin, etc., et les écrits des plus beaux génies en histoire naturelle, tels que Leibnitz, Buffon, Charles Bonnet, etc., on trouve dans les monades de Leibnitz, dans les molécules organiques de Buffon, dans la force végétatrice de Needham, dans l'emboîtement des parties similaires de Charles Bonnet, assez hardi pour écrire en 1760 : L'animal végète comme la plante ; on trouve, dis-je, les rudiments de la belle loi du soi pour soi sur laquelle repose l' unité de composition. Il n'y a qu'un animal. Le créateur ne s'est servi que d'un seul et même patron pour tous les êtres organisés. L'animal est un principe qui prend sa forme extérieure, ou, pour parler plus exactement, les différences de sa forme, dans les milieux où il est appelé à se développer. Les Espèces Zoologiques résultent de ces différences. La proclamation et le soutien de ce système, en harmonie d'ailleurs avec les idées que nous nous faisons de la puissance divine, sera l'éternel honneur de Geoffroi Saint-Hilaire, le vainqueur de Cuvier sur ce point de la haute science, et dont le triomphe a été salué par le dernier article qu'écrivit le grand Goethe.
Pénétré de ce système bien avant les débats auxquels il a donné lieu, je vis que, sous ce rapport, la Société ressemblait à la Nature. La Société ne fait-elle pas de l'homme, suivant les milieux où son action se déploie, autant d'hommes différents qu'il y a de variétés en zoologie ? Les différences entre un soldat, un ouvrier, un administrateur, un avocat, un oisif, un savant, un homme d'état, un commerçant, un marin, un poète, un pauvre, un prêtre, sont, quoique plus difficiles à saisir, aussi considérables que celles qui distinguent le loup, le lion, l'âne, le corbeau, le requin, le veau marin, la brebis, etc. Il a donc existé, il existera donc de tout temps des Espèces Sociales comme il y a des Espèces Zoologiques. Si Buffon a fait un magnifique ouvrage en essayant de représenter dans un livre l'ensemble de la zoologie, n'y avait-il pas une oeuvre de ce genre à faire pour la Société ? Mais la Nature a posé, pour les variétés animales, des bornes entre lesquelles la Société ne devait pas se tenir. Quand Buffon peignait le lion, il achevait la lionne en quelques phrases ; tandis que dans la Société la femme ne se trouve pas toujours être la femelle du mâle. Il peut y avoir deux êtres parfaitement dissemblables dans un ménage. La femme d'un marchand est quelquefois digne d'être celle d'un prince, et souvent celle d'un prince ne vaut pas celle d'un artiste. L'Etat Social a des hasards que ne se permet pas la Nature, car il est la Nature plus la Société. La description des Espèces Sociales était donc au moins double de celle des Espèces Animales, à ne considérer que les deux sexes. Enfin, entre les animaux, il y a peu de drames, la confusion ne s'y met guère ; ils courent sus les uns aux autres, voilà tout. Les hommes courent bien aussi les uns sur les autres ; mais leur plus ou moins d'intelligence rend le combat autrement compliqué. Si quelques savants n'admettent pas encore que l'Animalité se transborde dans l'Humanité par un immense courant de vie, l'épicier devient certainement pair de France, et le noble descend parfois au dernier rang social. Puis, Buffon a trouvé la vie excessivement simple chez les animaux. L'animal a peu de mobilier, il n'a ni arts ni sciences ; tandis que l'homme, par une loi qui est à rechercher, tend à représenter ses moeurs, sa pensée et sa vie dans tout ce qu'il approprie à ses besoins. Quoique Leuwenhoëk, Swammerdam, Spallanzani, Réaumur, Charles Bonnet, Muller, Haller et autres patients zoographes aient démontré combien les moeurs des animaux étaient intéressantes ; les habitudes de chaque animal sont, à nos yeux du moins, constamment semblables en tout temps ; tandis que les habitudes, les vêtements, les paroles, les demeures d'un prince, d'un banquier, d'un artiste, d'un bourgeois, d'un prêtre et d'un pauvre sont entièrement dissemblables et changent au gré des civilisations.
Ainsi l'oeuvre à faire devait avoir une triple forme : les hommes, les femmes et les choses, c'est-à-dire les personnes et la représentation matérielle qu'ils donnent de leur pensée ; enfin l'homme et la vie.
En lisant les sèches et rebutantes nomenclatures de faits appelées histoires, qui ne s'est aperçu que les écrivains ont oublié, dans tous les temps, en Egypte, en Perse, en Grèce, à Rome, de nous donner l'histoire des moeurs. Le morceau de Pétrone sur la vie privée des Romains irrite plutôt qu'il ne satisfait notre curiosité. Après avoir remarqué cette immense lacune dans le champ de l'histoire, l'abbé Bartélemy consacra sa vie à refaire les moeurs grecques dans Anacharsis.
Mais comment rendre intéressant le drame à trois ou quatre mille personnages que présente une Société ? comment plaire à la fois au poète, au philosophe et aux masses qui veulent la poésie et la philosophie sous de saisissantes images ? Si je concevais l'importance et la poésie de cette histoire du coeur humain, je ne voyais aucun moyen d'exécution ; car, jusqu'à notre époque, les plus célèbres conteurs avaient dépensé leur talent à créer un ou deux personnages typiques, à peindre une face de la vie. Ce fut avec cette pensée que je lus les oeuvres de Walter Scott. Walter Scott, ce trouveur (trouvère) moderne, imprimait alors une allure gigantesque à un genre de composition injustement appelé secondaire. N'est-il pas véritablement plus difficile de faire concurrence à l'Etat-Civil avec Daphnis et Chloë, Roland, Amadis, Panurge, Don Quichotte, Manon Lescaut, Clarisse, Lovelace, Robinson Crusoë, Gilblas, Ossian, Julie d'Etanges, mon oncle Tobie, Werther, René, Corinne, Adolphe, Paul et Virginie, Jeanie Dean, Claverhouse, Ivanhoë, Manfred, Mignon, que de mettre en ordre les faits à peu près les mêmes chez toutes les nations, de rechercher l'esprit de lois tombées en désuétude, de rédiger des théories qui égarent les peuples, ou, comme certains métaphysiciens, d'expliquer ce qui est ? D'abord, presque toujours ces personnages, dont l'existence devient plus longue, plus authentique que celle des générations au milieu desquelles on les fait naître, ne vivent qu'à la condition d'être une grande image du présent. Conçus dans les entrailles de leur siècle, tout le coeur humain se remue sous leur enveloppe, il s'y cache souvent toute une philosophie. Walter Scott élevait donc à la valeur philosophique de l'histoire le roman, cette littérature qui, de siècle en siècle, incruste d'immortels diamants la couronne poétique des pays où se cultivent les lettres. Il y mettait l'esprit des anciens temps, il y réunissait à la fois le drame, le dialogue, le portrait, le paysage, la description ; il y faisait entrer le merveilleux et le vrai, ces éléments de l'épopée, il y faisait coudoyer la poésie par la familiarité des plus humbles langages. Mais, ayant moins imaginé un système que trouvé sa manière dans le feu du travail ou par la logique de ce travail, il n'avait pas songé à relier ses compositions l'une à l'autre de manière à coordonner une histoire complète, dont chaque chapitre eût été un roman, et chaque roman une époque. En apercevant ce défaut de liaison, qui d'ailleurs ne rend pas l'Ecossais moins grand, je vis à la fois le système favorable à l'exécution de mon ouvrage et la possibilité de l'exécuter. Quoique, pour ainsi dire, ébloui par la fécondité surprenante de Walter Scott, toujours semblable à lui-même et toujours original, je ne fus pas désespéré, car je trouvai la raison de ce talent dans l'infinie variété de la nature humaine. Le hasard est le plus grand romancier du monde : pour être fécond, il n'y a qu'à l'étudier. La Société française allait être l'historien, je ne devais être que le secrétaire. En dressant l'inventaire des vices et des vertus, en rassemblant les principaux faits des passions, en peignant les caractères, en choisissant les événements principaux de la Société, en composant des types par la réunion des traits de plusieurs caractères homogènes, peut-être pouvais-je arriver à écrire l'histoire oubliée par tant d'historiens, celle des moeurs. Avec beaucoup de patience et de courage, je réaliserais, sur la France au dix-neuvième siècle, ce livre que nous regrettons tous, que Rome, Athènes, Tyr, Memphis, la Perse, l'Inde ne nous ont malheureusement pas laissé sur leurs civilisations, et qu'à l'instar de l'abbé Barthélemy, le courageux et patient Monteil avait essayé pour le Moyen-Age, mais sous une forme peu attrayante.
Ce travail n'était rien encore. S'en tenant à cette reproduction rigoureuse, un écrivain pouvait devenir un peintre plus ou moins fidèle, plus ou moins heureux, patient ou courageux des types humains, le conteur des drames de la vie intime, l'archéologue du mobilier social, le nomenclateur des professions, l'enregistreur du bien et du mal ; mais, pour mériter les éloges que doit ambitionner tout artiste, ne devais-je pas étudier les raisons ou la raison de ces effets sociaux, surprendre le sens caché dans cet immense assemblage de figures, de passions et d'événements. Enfin, après avoir cherché, je ne dis pas trouvé, cette raison, ce moteur social, ne fallait-il pas méditer sur les principes naturels et voir en quoi les Sociétés s'écartent ou se rapprochent de la règle éternelle, du vrai, du beau ? Malgré l'étendue des prémisses, qui pouvaient être à elles seules un ouvrage, l'oeuvre, pour être entière, voulait une conclusion. Ainsi dépeinte, la Société devait porter avec elle la raison de son mouvement.

La loi de l'écrivain, ce qui le fait tel, ce qui, je ne crains pas de le dire, le rend égal et peut-être supérieur à l'homme d'état, est une décision quelconque sur les choses humaines, un dévouement absolu à des principes. Machiavel, Hobbes, Bossuet, Leibnitz, Kant, Montesquieu sont la science que les hommes d'état appliquent. " Un écrivain doit avoir en morale et en politique des opinions arrêtées, il doit se regarder comme un instituteur des hommes ; car les hommes n'ont pas besoin de maîtres pour douter," a dit Bonald. J'ai pris de bonne heure pour règle ces grandes paroles, qui sont la loi de l'écrivain monarchique aussi bien que celle de l'écrivain démocratique. Aussi, quand on voudra m'opposer à moi-même, se trouvera-t-il qu'on aura mal interprété quelque ironie, ou bien l'on rétorquera mal à propos contre moi le discours d'un de mes personnages, manoeuvre particulière aux calomniateurs. Quant au sens intime, à l'âme de cet ouvrage, voici les principes qui lui servent de base.
L'homme n'est ni bon ni méchant, il naît avec des instincts et des aptitudes ; la Société, loin de le dépraver, comme l'a prétendu Rousseau, le perfectionne, le rend meilleur ; mais l'intérêt développe aussi ses penchants mauvais. Le christianisme, et surtout le catholicisme, étant, comme je l'ai dit dans le Médecin de Campagne, un système complet de répression des tendances dépravées de l'homme, est le plus grand élément d'Ordre Social.
En lisant attentivement le tableau de la Société, moulée, pour ainsi dire, sur le vif avec tout son bien et tout son mal, il en résulte cet enseignement que si la pensée, ou la passion, qui comprend la pensée et le sentiment, est l'élément social, elle en est aussi l'élément destructeur. En ceci, la vie sociale ressemble à la vie humaine. On ne donne aux peuples de longévité qu'en modérant leur action vitale. L'enseignement, ou mieux, l'éducation par des Corps Religieux est donc le grand principe d'existence pour les peuples, le seul moyen de diminuer la somme du mal et d'augmenter la somme du bien dans toute Société. La pensée, principe des maux et des biens, ne peut être préparée, domptée, dirigée que par la religion. L'unique religion possible est le christianisme (voir la lettre écrite de Paris dans LOUIS LAMBERT, où le jeune philosophe mystique explique, à propos de la doctrine de Swedenborg, comment il n'y a jamais eu qu'une même religion depuis l'origine du monde). Le Christianisme a créé les peuples modernes, il les conservera. De là sans doute la nécessité du principe monarchique. Le Catholicisme et la Royauté sont deux principes jumeaux. Quant aux limites dans lesquelles ces deux principes doivent être enfermés par des Institutions afin de ne pas les laisser se développer absolument, chacun sentira qu'une préface aussi succincte que doit l'être celle-ci, ne saurait devenir un traité politique. Aussi ne dois-je entrer ni dans les dissensions religieuses ni dans les dissensions politiques du moment. J'écris à la lueur de deux Vérités éternelles : la Religion, la Monarchie, deux nécessités que les événements contemporains proclament, et vers lesquelles tout écrivain de bon sens doit essayer de ramener notre pays. Sans être l'ennemi de l'Election, principe excellent pour constituer la loi, je repousse l'Election prise comme unique moyen social, et surtout aussi mal organisée qu'elle l'est aujourd'hui, car elle ne représente pas d'imposantes minorités aux idées, aux intérêts desquelles songerait un gouvernement monarchique. L'Election, étendue à tout, nous donne le gouvernement par les masses, le seul qui ne soit point responsable, et où la tyrannie est sans bornes, car elle s'appelle la loi. Aussi regardé-je la Famille et non l'Individu comme le véritable élément social. Sous ce rapport, au risque d'être regardé comme un esprit rétrograde, je me range du côté de Bossuet et de Bonald, au lieu d'aller avec les novateurs modernes. Comme l'Election est devenue l'unique moyen social, si j'y avais recours pour moi-même, il ne faudrait pas inférer la moindre contradiction entre mes actes et ma pensée. Un ingénieur annonce que tel pont est près de crouler, qu'il y a danger pour tous à s'en servir, et il y passe lui-même quand ce pont est la seule route pour arriver à la ville. Napoléon avait merveilleusement adapté l'Election au génie de notre pays. Aussi les moindres députés de son Corps Législatif ont-ils été les plus célèbres orateurs des Chambres sous la Restauration. Aucune Chambre n'a valu le Corps législatif en les comparant homme à homme. Le système électif de l'Empire est donc incontestablement le meilleur.
Certaines personnes pourront trouver quelque chose de superbe et d'avantageux dans cette déclaration. On cherchera querelle au romancier de ce qu'il veut être historien, on lui demandera raison de sa politique. J'obéis ici à une obligation, voilà toute la réponse. L'ouvrage que j'ai entrepris aura la longueur d'une histoire, j'en devais la raison, encore cachée, les principes et la morale.
Nécessairement forcé de supprimer les préfaces publiées pour répondre à des critiques essentiellement passagères, je n'en veux conserver qu'une observation.
Les écrivains qui ont un but, fût-ce un retour aux principes qui se trouvent dans le passé par cela même qu'ils sont éternels, doivent toujours déblayer le terrain. Or, quiconque apporte sa pierre dans le domaine des idées, quiconque signale un abus, quiconque marque d'un signe le mauvais pour être retranché, celui-là passe toujours pour être immoral. Le reproche d'immoralité, qui n'a jamais failli à l'écrivain courageux, est d'ailleurs le dernier qui reste à faire quand on n'a plus rien à dire à un poète. Si vous êtes vrai dans vos peintures ; si à force de travaux diurnes et nocturnes, vous parvenez à écrire la langue la plus difficile du monde, on vous jette alors le mot immoral à la face. Socrate fut immoral, Jésus-Christ fut immoral ; tous deux ils furent poursuivis au nom des Sociétés qu'ils renversaient ou réformaient. Quand on veut tuer quelqu'un, on le taxe d'immoralité. Cette manoeuvre, familière aux partis, est la honte de tous ceux qui l'emploient. Luther et Calvin savaient bien ce qu'ils faisaient en se servant des Intérêts matériels blessés comme d'un bouclier ! Aussi ont-ils vécu toute leur vie.
En copiant toute la Société, la saisissant dans l'immensité de ses agitations, il arrive, il devait arriver que telle composition offrait plus de mal que de bien, que telle partie de la fresque représentait un groupe coupable, et la critique de crier à l'immoralité, sans faire observer la moralité de telle autre partie destinée à former un contraste parfait. Comme la critique ignorait le plan général, je lui pardonnais d'autant mieux qu'on ne peut pas plus empêcher la critique qu'on ne peut empêcher la vue, le langage et le jugement de s'exercer. Puis le temps de l'impartialité n'est pas encore venu pour moi. D'ailleurs, l'auteur qui ne sait pas se résoudre à essuyer le feu de la critique ne doit pas plus se mettre à écrire qu'un voyageur ne doit se mettre en route en comptant sur un ciel toujours serein. Sur ce point, il me reste à faire observer que les moralistes les plus consciencieux doutent fort que la Société puisse offrir autant de bonnes que de mauvaises actions, et dans le tableau que j'en fais, il se trouve plus de personnages vertueux que de personnages répréhensibles. Les actions blâmables, les fautes, les crimes, depuis les plus légers jusqu'aux plus graves, y trouvent toujours leur punition humaine ou divine, éclatante ou secrète. J'ai mieux fait que l'historien, je suis plus libre. Cromwell fut, ici-bas, sans autre châtiment que celui que lui infligeait le penseur. Encore y a-t-il eu discussion d'école à école. Bossuet lui-même a ménagé ce grand régicide. Guillaume d'Orange l'usurpateur, Hugues Capet, cet autre usurpateur, meurent pleins de jours, sans avoir eu plus de défiances ni plus de craintes qu'Henri IV et que Charles Ier. La vie de Catherine II et celle de Louis XVI, mises en regard concluraient contre toute espèce de morale à les juger au point de vue de la morale qui régit les particuliers ; car pour les Rois, pour les Hommes d'Etat, il y a, comme l'a dit Napoléon, une petite et une grande morale.
Les Scènes de la vie politique sont basées sur cette belle réflexion. L'histoire n'a pas pour loi, comme le roman, de tendre vers le beau idéal. L'histoire est ou devrait être ce qu'elle fut; tandis que le roman doit être le monde meilleur, a dit madame Necker, un des esprits les plus distingués du dernier siècle. Mais le roman ne serait rien si, dans cet auguste mensonge, il n'était pas vrai dans les détails. Obligé de se conformer aux idées d'un pays essentiellement hypocrite, Walter Scott a été faux, relativement à l'humanité, dans la peinture de la femme parce que ses modèles étaient des schismatiques. La femme protestante n'a pas d'idéal. Elle peut être chaste, pure, vertueuse ; mais son amour sans expansion sera toujours calme et rangé comme un devoir accompli. Il semblerait que la Vierge Marie ait refroidi le coeur des sophistes qui la bannissaient du ciel, elle et ses trésors de miséricorde. Dans le protestantisme, il n'y a plus rien de possible pour la femme après la faute ; tandis que dans l'Eglise catholique l'espoir du pardon la rend sublime. Aussi n'existe-t-il qu'une seule femme pour l'écrivain protestant, tandis que l'écrivain catholique trouve une femme nouvelle, dans chaque nouvelle situation. Si Walter Scott eût été catholique, s'il se fût donné pour tâche la description vraie des différentes Sociétés qui se sont succédé en Ecosse, peut-être le peintre d'Effie et d'Alice (les deux figures qu'il se reprocha dans ses vieux jours d'avoir dessinées) eût-il admis les passions avec leurs fautes et leurs châtiments, avec les vertus que le repentir leur indique. La passion est toute l'humanité. Sans elle, la religion, l'histoire, le roman, l'art seraient inutiles.
En me voyant amasser tant de faits et les peindre comme ils sont, avec la passion pour élément, quelques personnes ont imaginé, bien à tort, que j'appartenais à l'école sensualiste et matérialiste, deux faces du même fait, le panthéisme. Mais peut-être pouvait-on, devait-on s'y tromper. Je ne partage point la croyance à un progrès indéfini, quant aux Sociétés ; je crois aux progrès de l'homme sur lui-même. Ceux qui veulent apercevoir chez moi l'intention de considérer l'homme comme une créature finie se trompent donc étrangement. Séraphita, la doctrine en action du Bouddha chrétien, me semble une réponse suffisante à cette accusation assez légèrement avancée d'ailleurs.
Dans certains fragments de ce long ouvrage, j'ai tenté de populariser les faits étonnants, je puis dire les prodiges de l'électricité qui se métamorphose chez l'homme en une puissance incalculée ; mais en quoi les phénomènes cérébraux et nerveux qui démontrent l'existence d'un nouveau monde moral dérangent-ils les rapports certains et nécessaires entre les mondes et Dieu ? en quoi les dogmes catholiques en seraient-ils ébranlés ? Si, par des faits incontestables, la pensée est rangée un jour parmi les fluides qui ne se révèlent que par leurs effets et dont la substance échappe à nos sens même agrandis par tant de moyens mécaniques, il en sera de ceci comme de la sphéricité de la terre observée par Christophe Colomb, comme de sa rotation démontrée par Galilée. Notre avenir restera le même. Le magnétisme animal, aux miracles duquel je me suis familiarisé depuis 1820 ; les belles recherches de Gall, le continuateur de Lavater ; tous ceux qui, depuis cinquante ans, ont travaillé la pensée comme les opticiens ont travaillé la lumière, deux choses quasi semblables, concluent et pour les mystiques, ces disciples de l'apôtre saint Jean, et pour tous les grands penseurs qui ont établi le monde spirituel, cette sphère où se révèlent les rapports entre l'homme et Dieu.
En saisissant bien le sens de cette composition, on reconnaîtra que j'accorde aux faits constants, quotidiens, secrets ou patents, aux actes de la vie individuelle, à leurs causes et à leurs principes autant d'importance que jusqu'alors les historiens en ont attaché aux événements de la vie publique des nations. La bataille inconnue qui se livre dans une vallée de l'Indre entre madame de Mortsauf et la passion est peut-être aussi grande que la plus illustre des batailles connues (Le Lys dans la vallée). Dans celle-ci, la gloire d'un conquérant est en jeu ; dans l'autre, il s'agit du ciel. Les infortunes des Birotteau, le prêtre et le parfumeur, sont pour moi celles de l'humanité. La Fosseuse (Médecin de campagne), et madame Graslin (Curé de village) sont presque toute la femme. Nous souffrons tous les jours ainsi. J'ai eu cent fois à faire ce que Richardson n'a fait qu'une seule fois. Lovelace a mille formes, car la corruption sociale prend les couleurs de tous les milieux où elle se développe. Au contraire, Clarisse, cette belle image de la vertu passionnée, a des lignes d'une pureté désespérante. Pour créer beaucoup de vierges, il faut être Raphaël. La littérature est peut-être, sous ce rapport, au-dessous de la peinture. Aussi peut-il m'être permis de faire remarquer combien il se trouve de figures irréprochables (comme vertu) dans les portions publiées de cet ouvrage : Pierrette Lorrain, Ursule Mirouët, Constance Birotteau, la Fosseuse, Eugénie Grandet, Marguerite Claës, Pauline de Villenoix, madame Jules, madame de La Chanterie, Eve Chardon, mademoiselle d'Esgrignon, madame Firmiani, Agathe Rouget, Renée de Maucombe ; enfin bien des figures du second plan, qui pour être moins en relief que celles-ci, n'en offrent pas moins au lecteur la pratique des vertus domestiques, Joseph Lebas, Genestas, Benassis, le curé Bonnet, le médecin Minoret, Pillerault, David Séchard, les deux Birotteau, le curé Chaperon, le juge Popinot, Bourgeat, les Sauviat, les Tascheron, et bien d'autres ne résolvent-ils pas le difficile problème littéraire qui consiste à rendre intéressant un personnage vertueux.
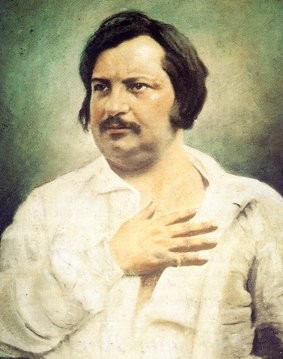
Honoré de Balzac (1799-1850)
Ce n'était pas une petite tâche que de peindre les deux ou trois mille figures saillantes d'une époque, car telle est, en définitif, la somme des types que présente chaque génération et que La Comédie humaine comportera. Ce nombre de figures, de caractères, cette multitude d'existences exigeaient des cadres, et, qu'on me pardonne cette expression, des galeries. De là, les divisions si naturelles, déjà connues, de mon ouvrage en Scènes de la vie privée, de province, parisienne, politique, militaire et de campagne. Dans ces six livres sont classées toutes les Etudes de moeurs qui forment l'histoire générale de la Société, la collection de tous ses faits et gestes, eussent dit nos ancêtres. Ces six livres répondent d'ailleurs à des idées générales. Chacun d'eux a son sens, sa signification, et formule une époque de la vie humaine. Je répéterai là, mais succinctement, ce qu'écrivit, après s'être enquis de mon plan, Félix Davin, jeune talent ravi aux lettres par une mort prématurée. Les Scènes de la vie privée représentent l'enfance, l'adolescence et leurs fautes, comme les Scènes de la vie de province représentent l'âge des passions, des calculs, des intérêts et de l'ambition. Puis les Scènes de la vie parisienne offrent le tableau des goûts, des vices et de toutes les choses effrénées qu'excitent les moeurs particulières aux capitales où se rencontrent à la fois l'extrême bien et l'extrême mal. Chacune de ces trois parties a sa couleur locale : Paris et la province, cette antithèse sociale a fourni ses immenses ressources. Non-seulement les hommes, mais encore les événements principaux de la vie, se formulent par des types. Il y a des situations qui se représentent dans toutes les existences, des phases typiques, et c'est là l'une des exactitudes que j'ai le plus cherchées. J'ai tâché de donner une idée des différentes contrées de notre beau pays. Mon ouvrage a sa géographie comme il a sa généalogie et ses familles, ses lieux et ses choses, ses personnes et ses faits ; comme il a son armorial, ses nobles et ses bourgeois, ses artisans et ses paysans, ses politiques et ses dandies, son armée, tout son monde enfin !
Après avoir peint dans ces trois livres la vie sociale, il restait à montrer les existences d'exception qui résument les intérêts de plusieurs ou de tous, qui sont en quelque sorte hors la loi commune : de là les Scènes de la vie politique. Cette vaste peinture de la société finie et achevée, ne fallait-il pas la montrer dans son état le plus violent, se portant hors de chez elle, soit pour la défense, soit pour la conquête ? De là les Scènes de la vie militaire, la portion la moins complète encore de mon ouvrage, mais dont la place sera laissée dans cette édition, afin qu'elle en fasse partie quand je l'aurai terminée. Enfin, les Scènes de la vie de campagne sont en quelque sorte le soir de cette longue journée, s'il m'est permis de nommer ainsi le drame social. Dans ce livre, se trouvent les plus purs caractères et l'application des grands principes d'ordre, de politique, de moralité.
Telle est l'assise pleine de figures, pleine de comédies et de tragédies sur laquelle s'élèvent les Etudes philosophiques, Seconde Partie de l'ouvrage, où le moyen social de tous les effets se trouve démontré, où les ravages de la pensée sont peints, sentiment à sentiment, et dont le premier ouvrage, La Peau de chagrin, relie en quelque sorte les Etudes de moeurs aux Etudes philosophiques par l'anneau d'une fantaisie presque orientale où la Vie elle-même est peinte aux prises avec le Désir, principe de toute Passion.
Au-dessus, se trouveront les Etudes analytiques, desquelles je ne dirai rien, car il n'en a été publié qu'une seule, La Physiologie du mariage. D'ici à quelque temps, je dois donner deux autres ouvrages de ce genre. D'abord la Pathologie de la vie sociale, puis l'Anatomie des corps enseignants et la Monographie de la vertu.
En voyant tout ce qui reste à faire, peut-être dira-t-on de moi ce qu'ont dit mes éditeurs : Que Dieu vous prête vie ! Je souhaite seulement de n'être pas aussi tourmenté par les hommes et par les choses que je le suis depuis que j'ai entrepris cet effroyable labeur. J'ai eu ceci pour moi, dont je rends grâce à Dieu, que les plus grands talents de cette époque, que les plus beaux caractères, que de sincères amis, aussi grands dans la vie privée que ceux-ci le sont dans la vie publique, m'ont serré la main en me disant : - Courage ! Et pourquoi n'avouerais-je pas que ces amitiés, que des témoignages donnés çà et là par des inconnus, m'ont soutenu dans la carrière et contre moi-même et contre d'injustes attaques, contre la calomnie qui m'a si souvent poursuivi, contre le découragement et contre cette trop vive espérance dont les paroles sont prises pour celles d'un amour-propre excessif ? J'avais résolu d'opposer une impassibilité stoïque aux attaques et aux injures ; mais, en deux occasions, de lâches calomnies ont rendu la défense nécessaire. Si les partisans du pardon des injures regrettent que j'aie montré mon savoir en fait d'escrime littéraire, plusieurs chrétiens pensent que nous vivons dans un temps où il est bon de faire voir que le silence a sa générosité.
A ce propos, je dois faire observer que je ne reconnais pour mes ouvrages que ceux qui portent mon nom. En dehors de La Comédie humaine, il n'y a de moi que les Cent contes drôlatiques, deux pièces de théâtre et des articles isolés qui d'ailleurs sont signés. J'use ici d'un droit incontestable. Mais ce désaveu, quand même il atteindrait des ouvrages auxquels j'aurais collaboré, m'est commandé moins par l'amour-propre que par la vérité. Si l'on persistait à m'attribuer des livres que, littérairement parlant, je ne reconnais point pour miens, mais dont la propriété me fut confiée, je laisserais dire par la même raison que je laisse le champ libre aux calomnies.
L'immensité d'un plan qui embrasse à la fois l'histoire et la critique de la Société, l'analyse de ses maux et la discussion de ses principes, m'autorise, je crois, à donner à mon ouvrage le titre sous lequel il parait aujourd'hui : La Comédie humaine. Est-ce ambitieux ? N'est-ce que juste ? C'est ce que, l'ouvrage terminé, le public décidera.
Paris, juillet 1842.
07:34 Publié dans Beaux-Arts, Ecrits, Littérature, Portraits de personnalités, Thèse | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 28 janvier 2013
Honoré

Honoré de Balzac (1799-1850)
Extrait du Larousse en ligne :
Son œuvre gigantesque aux ambitions démesurées fait de Balzac l'écrivain le plus emblématique du roman français. Si l'auteur de la Comédie humaine passe pour l'un des initiateurs du réalisme en littérature à l'époque romantique, l'ambiguïté de son œuvre va bien au-delà de cette catégorie. Il est aussi celui qui inaugure une nouvelle forme de relation de la vie à l'œuvre, celui pour qui les événements vécus et l'aventure littéraire, de revers en triomphes, sont portés par le même élan.
Famille : il est né le 20 mai 1799. Son père, Bernard-François Balzac, est d'origine paysanne (dans l'Albigeois). L'ascension sociale de ce dernier sera constante avant la Révolution puis sous l'Empire (1804-1814). Bernard-François fait accoler une particule au nom « Balzac » (1802).
Formation : Honoré étudie au collège de Vendôme (1807-1813), avant de devenir pensionnaire de l'institution Ganser à Paris (1813). Il montre un intérêt certain pour la philosophie et fait des études de droit (1816-1819).
Début de carrière : en 1819, il s'essaie à la tragédie (Scylla, Cromwell) ; entre 1820 et 1825, il compose plusieurs « romans de jeunesse » sous divers pseudonymes : lord R'Hoone, Horace de Saint-Aubin. Il devient imprimeur (1826) mais fait faillite (1828) et contracte de lourdes dettes.
Premiers succès : en 1829, le Dernier Chouan est le premier roman signé « M. Honoré Balzac » (il signera « de Balzac » à partir de 1830). Il fréquente les salons à la mode. La Peau de chagrin (août 1831) et Eugénie Grandet (décembre 1833) lancent sa carrière d'écrivain. Il rencontre Mme Hanska, une comtesse polonaise admiratrice de son œuvre (septembre 1833).
La consécration : le Père Goriot (1834-1835) inaugure le principe du retour des personnages d'un roman à l'autre. Élaboration d'un vaste univers romanesque, divisé en trois axes : Études de mœurs, Études philosophiques et Études analytiques. Le Lys dans la vallée (1835) et Illusions perdues (1837-1843) finissent de consacrer Balzac comme maître du réalisme.
Dernière partie de carrière : de 1842 à 1848, il édifie la Comédie humaine : un ensemble de romans formant une fresque de la société française de la Révolution (1789) à la fin de la monarchie de Juillet (1830-1848). Plus de 2 000 personnages composent une société hantée par le pouvoir de l'argent et de la presse, livrée à des passions dévorantes. En 1845, il élabore le plan d'ensemble de la Comédie humaine, lequel prévoit 137 titres (90 romans seront achevés). Il épouse Mme Hanska (14 mars 1850).
Mort : le 18 août 1850. Balzac est inhumé le 21 août au cimetière du Père-Lachaise, où Victor Hugo prononce son éloge funèbre.
> Source et pour la suite : http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Honor%C3%A...

La maison de Balzac, 47, rue Raynouard, Paris XVIe
http://fichtre.hautetfort.com/archive/2012/10/08/la-maison-de-balzac.html
Le plus divertissant de tout, ce serait de se mettre à lire Balzac (si votre ami ne l’a pas lu) ou au moins tout un cycle de Balzac, car un roman ne peut se lire isolément, on s’en tire difficilement à moins d’une tétralogie et c’est quelquefois une décalogie. Quelques nouvelles, vraiment divines, peuvent se lire isolément, ce grand peintre de fresques ayant été un incomparable miniaturiste. Si vous voulez des conseils balzaciens, je vous écrirai mais ce serait toute une lettre.
(Proust, l. à Mme de Camaran-Chimay, 20/07/1907)
Contrairement à Flaubert, Marcel Proust (1871-1922) ne s’agace pas des comparaisons avec Honoré de Balzac. Il en est même flatté : « Je rougis devant cette comparaison écrasante pour moi » écrit-il en mai 1921. Chez les Proust, « lire Balzac c’est parler la langue de la famille » puisque sa mère, déjà, lui parle des livres de Balzac. Proust est un lecteur averti de l’œuvre de l’écrivain tourangeau ; on retrouve dans leurs écrits quelques points communs comme les phénomènes du sommeil...
> Source et suite : http://debalzac.wordpress.com/2012/10/25/balzac-et-proust/
A l'angle du boulevard du Montparnasse et du boulevard Raspail
« Je viens de lire la Correspondance de Balzac. Il en résulte que : c’était un très brave homme. Et qu’on l’aurait aimé. Mais quelle préoccupation de l’Argent ! et quel peu d’amour de l’Art° ! Avez-vous remarqué qu’il n’en parle pas, une fois ? Il cherchait la gloire mais non le Beau°. Et il était catholique, légitimiste, propriétaire, ambitionnait la Députation et l’Académie°. Avant tout ignorant comme une cruche, provincial jusque dans la moelle des os ; le luxe l’épate. – Sa plus grande admiration littéraire est pour Walter Scott° ! – En résumé c’est pour moi un immense bonhomme mais de second ordre. »
(G. Flaubert, l. à Edmond de Goncourt. 31 décembre [1876])
Flaubert (1821-1880) est plus jeune que Balzac. Il n’a jamais rencontré son aîné, du moins officiellement car il y a tout de même une rencontre furtive en 1839, Flaubert a 17 ans, et Balzac vient à Rouen pour le compte de la Société des gens de lettres (il a donc 40 ans et a déjà écrit la plupart des ses grandes œuvres dont La Peau de chagrin, Eugénie Grandet, Le Père Goriot, Le Lys dans la vallée, Illusions Perdues…). Le jeune Flaubert le croise et suit, de loin. Balzac est alors une personnalité littéraire de tout premier plan qu’il vient de découvrir et dont la lecture lui est décisive. Contes philosophiques, Contes fantastiques, physiologies : grâce à lui il découvre ces nouveaux genres littéraires.
> Source et suite : http://debalzac.wordpress.com/2012/10/23/balzac-et-flaube...

Source : http://debalzac.wordpress.com/2009/12/12/balzac-et-louis-...
Balzac écrit sa Comédie Humaine (ses romans presque complets, disons) en moins de 20 ans : entre 1829 et 1848). Louis-Philippe est Roi des Français entre 1830 et 1848, ce qui correspond absolument aux mêmes dates. On sait que Balzac veut être un historien des moeurs de son temps, il s'inspire donc beaucoup de cette monarchie (de juillet) dans laquelle il vit.
On retrouve, pour ne citer que les plus connus, des références à cela dans La Peau de chagrin (la crise qui a suivi l'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe) et dans Le Père Goriot (l'émergence d'une bourgeoisie d'affaire favorisée par ce Roi qu'on dit Roi-bourgeois au dépend de la noblesse). Balzac, qui est un royaliste (un légitimiste même) affirmé n'aime pourtant pas Louis-Philippe qui ne semble pas être assez royaliste à son goût (puisqu'il se compromet avec la bourgeoisie).
Au début des années 1830, comme l'art de la caricature se développe considérablement, Louis-Philippe est attaqué et représenté sous forme de poire (ici au centre de la lithographie) en référence à ses joues tombantes. En 1835, Louis Philippe interdit définitivement qu'on le représente ; les caricaturistes, plutôt que de risquer la prison, se tournent donc vers d'autres personnalités comme les écrivains... et donc Balzac.
07:34 Publié dans Ecrits, Littérature, Portraits de personnalités, Thèse | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 24 janvier 2013
Un regard philosophique et littéraire sur le MPT - Romain Debluë
Avant de commencer, voyons l'étymologie du mot "mariage" gracieusement fournie par Wikipedia :
En français, le nom mariage provient du verbe latin maritare, issu de maritus, qui dérive, d’après une explication traditionnelle, de mas / maris, le mâle.
L’adjectif qui lui correspond « matrimonial », provient du substantif latin matrimonium, issu de mater, la mère et signifiant également mariage.
L'usage du mot latin matrimonium dans les textes juridiques et théologiques a largement contribué en Europe à l’élaboration de la notion. Il n'a pas laissé de substantif en français moderne, mais reste néanmoins présent en italien et en espagnol, sous la forme de matrimonio. Dans les pays d'Europe occidentale dont les langues découlent du latin, le cadre lexical du mariage renvoie donc à une forme juridique par laquelle la femme se prépare à devenir mère par sa rencontre avec un homme.
*
> Pour davantage : http://fichtre.hautetfort.com/les-mots-francais.html
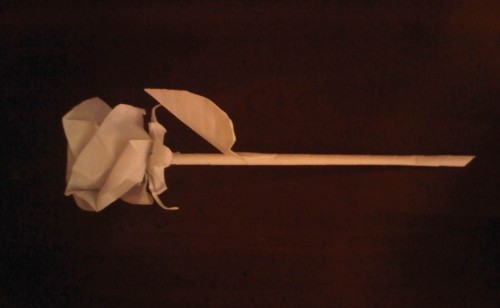
Rose en papier faite main par une fillette en voyage
Extrait de "Petit traité de gamologie contemporaine", 2013, Romain Debluë :
"On a tout essayé, par la suite, avec le mariage. On l'a plié dans tous les sens. On a tâté de la polygamie, de la bigamie, de la monogamie, de l'adultère, du divorce à répétition, du mariage forcé, du mariage civil, du mariage religieux, du mariage d'argent, du mariage raté. On a même vu des mariages heureux. On a vu des mariages stériles et d'autres féconds, des unions dramatiques et des noces de sang. On en a fait des vaudevilles et des tragédies. Avec des placards pleins d'amants, des cocus en caleçon, des maîtresses acariâtres. Le mariage, en résumé, n'a été inventé que pour fournir des sujets de romans et pour assurer la chaîne sans fin des générations ainsi que veut l'espèce." (Ph. Muray, Le mariage transformé par ses célibataires mêmes, in Exorcismes spirituels IV)
Le mariage, institution des temps antérieurs, sacrale mais par lucidité religieuse, semble aujourd'hui comme jamais certes jadis disgracié de ses antiques prérogatives anthropologiques, - mais implicites toujours car luisantes des heureuses amours modernes.
Maint hémisphérique crétin désormais s'entrapplaudissent de n'y plus rien comprendre et glosent d'aisance une éphémère chimère dont à l'horizon de leur propre sottise, seule, ils peuvent parfois entrevoir l'ombre, vite abolie. On ne sait trop, d'ailleurs - faute à leur malaisance verbale bien souvent - quels sémantismes l'on devrait ouïr vibrer lorsque d'aucuns énoncent l'infatigable quoiqu'absurde formule du "mariage pour tous", ce mystérieux grumeau d'une gerbure d'intellect moisi, dégluti par quelque étêté politicard au fond d'une morne journée d'hypotention mentale.
Lors même que le mariage, en vertu de sa prime définition, constitue d'excellence une institution à toutes et tous ouverte ; pour peu, bien sûr, que l'on entende, de pleine volonté, se plier à sa structure, lors donc certains - insavants peut-être de l'art alphabétique, se répandent politiquement en bruyants hurlements d'étranges revendications qui, certes, eussent fait tressauter de rire ces notoires invertis que furent, par exemple, Proust, Wilde et, selon certain, Michel-Ange.
Le débat contemporain, qui voudrait qu'il n'y ait point débat puisque Dieu, en la bouche détournée et multiple du Parti Socialiste, a parlé, afflige et désole maints : certains parce que son objet fait évidence de son aberration, d'autres parce que l'opposition à son objet leur apparaît une monstruosité au moins comparable à ce que, jadis, l'inversion représentait aux yeux des moralistes.
Tous, notoires indigents mentaux, font mine de savoir de quoi l’on parle, et par l’insensé verbiage de leurs grinçants argumentaires, espèrent élever leur intime opinion à valeur d’universelle raison. Fasse l’Histoire que leur bilatérale folie ne puisse plus être longtemps dissimulée, car m’apparaît urgent de considérer, une bonne fois pour toute, le problème en ses principes et non point en ses inconciliables et confuses ramifications.
J'affirme, pour ma part, que l'infernal pandémonium qui aujourd'hui tient lieu de nationale préoccupation en terres françaises ne relève ni, en ses origines, du social, ni du sociétal, ni de l'anthropologique pur, ni bien sûr du politique : la question du mariage telle qu'elle est tordue et, osons le mot, pervertie aux nôtre embrumées époques, relève du Langage ; et donc, avant tout, de la littérature. Excluons donc de nos intellectuels interlocuteurs ceux qui n'y peuvent rien entendre, à commencer par le très cocasse gouvernement où d'égale façon se répartissent les jobards et les ribaudes en lequel résonnent depuis de longues semaines les sermons émouvants de Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes et de l'Universelle Pénitence Masculine, souriante benjamine du gouvernement dont il semble, à première vue, fort malaisé de ne point se gausser tant son immuable ton de joviale maîtresse d'école, sorte de flûte envoûtante du Bien, paraît destiné à susciter chez autrui la plus immédiate vague d'hilarité qui soit, - méchante et misogyne bien sûr, car c'est un péché que de moquer une femme politique à travers laquelle, toujours, gronde l'assemblée intégrale des femelles d'ici et d'ailleurs prêtes à dégainer une plainte pénale exorbitante.
Comment, en effet, ne point ricaner lorsque l'on entend cette jeune et dynamique mégère déclarer, dans Le Monde, ce "choc des paupières" comme disait Desproges, que "pour les élèves, un apprentissage de l'égalité sera mis en place de la fin de la maternelle à la fin du primaire" et que, "enfin, l'éducation à la sexualité deviendra effective : il ne s'agit pas de parler de pratiques, mais d'apprendre l'égale dignité et le respect entre les sexes." Ainsi que, sans doute, demanderait Philippe Muray, moi-même m'interroge : quelle éducation ? quelle dignité et surtout quels sexes ? Autant de mots que, depuis plus de trente longues années, la France s'emploie à décortiquer comme d'inertes crevettes pour, très bientôt, finir par en jeter les débris épars dans les poubelles de l'Histoire terminée. Que puis-je donc, moi pauvre mâle phallique et mal famé, respecter lorsque l'autre sexe n'existe plus que d'une espérance de cosmique dissolution ?
[...]
Il semble difficile pour les nébulosités céphaliques de Mme Vallaud-Belkacem d'émettre ne serait-ce qu'un millilitre de substance cohérente et claire, quoique peut-être, nous pourrions l'espérer, vaguement élaborée. Si la susdite ministre du Droit aux radasses à faire voter en toute impunité leurs lois salopes n'avait pas, comme je le suppose, été au moins première de classe en cours de langue vivante II, option Français-Langue de bois, nous n'eussions pas eu à subir les ravages de sa prose sur plus, probablement, de deux lignes et demi car, peu ou prou, ainsi aurait-elle formulé sa diatribe : tant que l'individu n'est pas un mâle, l'individu a le droit de faire tout ce qu'il veut avec tous ceux qui consentent à ses phantasmes, sans quoi les gens risqueraient de ne point s'aimer les uns les autres, - et pour cause.
Qu'on me permette de traduire une seconde fois, pour les plus engourdis : la Loi n’a qu’un but, divin et socialiste, sa propre abolition dans la pure reconnaissance d’elle-même dans la fluide mouvance des désirs de tous. Hegel, en temps historiques où bientôt Marx allait surgir sur les terres par lui préparées à cette pensée, affirmait, cela dit avec le vague qui convient à une simplification pédagogique, que l’Histoire se pouvait ramener en ultime compréhension à quelque chose comme le « jeu du sujet singulier et de la Loi universelle »*; par malfortune, la post-Histoire qui est hui notre quotidien paraît bien loin de réaliser la finale synthèse qu’il affirmait être sienne. Si, de fait, le jeu a cessé, car les cons temporés n’aiment point l’implicite de gratuité qui sourd en cette activité, ce n’est certes pas en un sens d’aboutissement, bien plutôt de conflagration folle où se débat en débats et déboires l’humanité d’un temps en quoi le sujet singulier pour n’avoir plus à s’interdire quoi que ce soit, fait de la Loi l’instrument docile – car abstrait – de ses personnelles exigences. La Loi, primordiale quoiqu’en cet aspect inexhaustive et allégée de ses conséquences, était interdiction ; car c’est par l’interdiction que, du chaos naturel des vivants, s’extirpe l’Homme par-là devenu être de culture et de société. À la source, bien sûr, de cette assomption de l’Homme en sa propre essence, qui de toujours fut d’être culturel, se niche et même point ne se cache l’interdit de l’inceste, primitive nécessité de tout ordre social futurement projeté et réalisée par l’acte d’attribution aux mâles d’une femelle, empêchant par ce geste fondateur l’ancienne domination de l’unique chef de meute qui, de par cette position, portait haut le privilège d’ensemencer à lui seul toutes les utérines cavités alentours. D’où jaillissement d’une neuve et très symbolique fonction : la fonction du père, – et bientôt celle même des Nom-du-Père, ainsi que la formalisera Jacques Lacan. Inexistante, icelle, jusques alors, ce qui déjà signifie une évidence aujourd’hui oubliée, celle de l’indissolubilité radicale de la paternité et du mariage. Disons-le en termes simples, au risque d’éclabousser de cette simplicité quelqu’âme sensible inhabituée à sentir heurtés ses ronronnants préjugés post-modernes, le mariage n’a point d’autre prime et élémentaire fonction que d’offrir à tout enfant un père, c’est-à-dire, puisque par le père vient celle-là, une Loi ; pour mieux dire une existence au sein de cette Loi que dit le père et que, dans la bouche du fils, il entend faire respecter ; entende qui n’est pas toujours compréhension d’ailleurs.
[...] Mère l’est sans le dire, nul recours à la parole ici nécessaire, père en revanche ne l’est qu’en l’horizon du langage, et s’affirmer tel ne peut, en réalité, qu’être toujours un peu travestissement de la réalité, – car le langage laisse la possibilité de ne pas le dire. Dans cette précise négation réside la particularité de la fonction paternelle qui, à y regarder bien, n’a que peu de rapport avec le rôle de la mère, pourtant dit aujourd’hui adjacent et peut-être même équivalent. Point n’est ici notre volonté de contester la capacité que peuvent avoir deux hommes ou deux femmes à élever un enfant, car quoiqu’en disent les éberlués partisans du « mariage avec n’importe qui », la question ne peut ainsi être posée. La réalité des familles monoparentales ou, parfois même, homoparentales, comme l’on dit, n’est pas à nier, mais elle est à conserver en sa nature, qui est précisément d’être réalité ; or il est dangereux de mêler sans en prendre conscience le réel et le symbolique, selon les lacaniennes dénominations dont aujourd’hui tout le monde semble faire fi. L’enfant n’a pas, comme s’évertuent à le répéter les grenouilles ignares qui s’époumonent à coasser des lieux-communs de la psychanalyse en surgelés, d’un père et d’une mère nécessairement, mais de bien plus essentielle façon d’avoir prise sur deux fonctions, qui sont de paternité et de maternité, mais n’existent que dans l’ordre du Symbolique ; quoique profondément ancré dans le Réel soit la fonction maternelle, qui pourtant peut souffrir de lacune sans dommages psychiques systématiques. Aberration, donc, si l’on discute la réalité mais folie en revanche si l’on prétend faire d’icelle l’autorité des structures symboliques, dont la Loi, ultimement, n’est que la cristallisation culturelle la plus implacable.
Si les partisans et les opposants à cette loi ne pourront, d'éternité, s'entendre (et outre le fait que les deux clans sont en majorité composés d'irréductibles imbéciles) c'est en premier lieu parce qu'ils ne parlent tout simplement plus la même langue. Ou plutôt les uns radotent une langue morte dont ils n'ont plus l'entente, tandis que les autres bredouillent un post-langage infinitésimal dont avec l'inoxydable Vallaud-Belkacem nous avons pu avoir quelque impression vertigineuse. Cette égalité entre les enfants naturels et légitime, par exemple, ne voyons-nous donc point qu’en plus de signer la mort définitive de toute possible paternité, – qui commence précisément là où s’opère la distinction entre ces deux modes de géniture –, elle constitue (du moins en sa forme ultime qui, d’un jour à l’autre, menace de nous tomber sur le coin de la gueule) le plus court chemin vers cet ordre naturel dont plus haut j’ai fait mention en le disant préposé à toute forme de société car n’étant pas encore théâtre du partage des femmes, et donc de la plus originelle distinction qui se puisse concevoir en ce domaine qui est celui du parlêtre duquel l’Homme tient sa définition même ? Dans ce contexte, la Loi est rabougrie à l’état, latent, de phantasmes universalisés et portés à hauteur de décrets : si deux personnes s’aiment, de facto elles doivent pouvoir se marier car la loi est à présent celle du désir et son rôle, lorsque ce n’est pas en faveur d’un malin phallus, est de permettre, encore et toujours, jusqu’à ce que ce terme même, comme tant d’autres jà dissous, ne signifie plus que sa propre extinction imminente. En rien ne s’agit-il ici de nier le succès que peuvent avoir deux hommes ou deux femmes à éduquer un enfant, – quoique personnellement l’idée d’avoir deux mères me ferait arder d’une surnaturelle angoisse car l’on a bien assez d’une seule à laquelle échapper. Le plan susévoqué du Réel n’est ici nullement en cause, et nécessaire se fait la distinction. En revanche, là où le débat blesse, c’est lorsqu’il est exigé que cette réalité soit transcendée symbolique par l’action d’une Loi, laquelle précisément n’existe que pour n’avoir rien à faire avec la réalité sinon de surplomb et de prééminence.
Le mariage ouvert à tous entre tous et certainement bientôt entre parents proches, puisque la très algide Élisabeth Badinter, dans un ouvrage intitulé L’un et l’autre, au cœur d’un chapitre titré : La mort du patriarcat, autant dire tout un programme, et des plus bucoliques, écrivait que « pour la première fois, certains osent revendiquer à visage découvert le droit à l’inceste et d’autres s’emploient à le dédramatiser »** et semblait s’en réjouir comme si elle n’avait jamais fait d’études de Philosophie, – ce qui, dans le fond, est sans doute le cas ; ce mariage ouvert à tous, donc, constitue bel et bien l’annulation pure et simple du but premier et fondamental du mariage qui, jadis, était d’offrir à l’enfant un père, grâce à la sursumation légale de ce rôle dont nous avons dit qu’à l’origine, il se peut résumer à un pur acte de langage.
Comme on le peut constater sans peine, l’amour n’a que peu de rapport avec cette affaire, car il me paraît évidence que tout amour véritable, en matière sociale, cherche avant tout à profiter d’une certaine clandestinité ; et sur ce point, ce n’est certes pas Sollers qui me contredira. Or, depuis quelques années, il semble que maints s’accordent à considérer le mariage comme une forme de reconnaissance sociale de l’affection tissée entre un nombre d’êtres encore réduit à celui du couple, mais bientôt extensible à souhaits, cela va sans dire : se marier revient donc à demander à l’État de faire exister avec un peu plus de consistance l’amour que Monsieur Lambda éprouve pour un autre Lambda, vaguement apparenté à l’une des dix-huit identités sexuelles répertoriées. Faut-il donc, au fond du gouffre, rappeler que l’amour n’a nul besoin du mariage et qu’en affirmant pareille bêtise, les progressistes béats se mettent, à l’inverse de leurs troubles intentions, à faire le lit des plus traditionnelles et moralisatoires idéologies conjugales ?
J'ai dit plus haut que l’essentiel de la question était littéraire, et sur ce point ce me paraît être limpide, car après tout, seuls les contes de fées, destinés à offrir aux enfants une prise symbolique sur le Réel, se terminent par l’heureux mariage du Prince et de la Princesse. La littérature romanesque, précisément, commence là où finit le conte de fée, et s’entend donc le roman comme toujours étude de mœurs, sinon poésie insue. Impossible, cela va de soi, d’écrire Madame Bovary dans un monde où règne le droit pour tous d’infuser la substance de ses désirs dans la moelle de la Loi ; impossible d’écrire L’Education sentimentale dans un monde où il suffirait à Mme Arnoux de divorcer sans conséquence pour rejoindre Frédéric, de vivre avec lui jusqu’à plus soif, et peut-être même, après une durée de cohabitation suffisante, de le légaliser tuteur officiel de ses deux enfants ; impossible d’écrire Un prêtre marié en une époque où c’est précisément parce qu’ils sont célibataires que les ecclésiastiques sont la cible des moqueries de tous les éternels potaches de la République ; impossible à Feydeau d’écrire la moindre de ses hilarantes comédies dans un monde où nul amant n’a encore besoin de se cacher dans aucun placard ; impossible aussi d’écrire L’Homme qui rit dans un monde où Ursus aurait simplement pu adopter Gwynplaine et par là effacer jusqu’à la trace de sa biologique filiation que nul n’aurait pu découvrir nobiliaire ; impossible également d’écrire la Recherche du Temps perdu dans un monde où Charlus serait marié à Jupien et Albertine à Mlle de Vinteuil, les deux couples ayant d’ailleurs employé les vits et utérus anonymes de quelque philanthropique donneur et mère porteuse afin d’avoir trois enfants par couple, trois beaux enfants épanouis et heureux qui, le dimanche après-midi, s’en iraient porter des madeleines à Monsieur Proust dont tout le monde saurait qu’il envisage de se pacser avec sa chère « maman. » Je ne crois pas un seul chef-d’œuvre de la littérature capable de résister à cette énumération, qui se peut indéfiniment poursuivre d’ailleurs : impossible d’écrire Hamlet dans un monde où le père n’est qu’une construction sociale née d’un modèle arbitraire d’hétérosexualité dominante et qui donc en rien ne mérite qu’on le venge de quoi que ce soit ; impossible d’écrire Le lys dans la vallée, Partage de midi, Sous le Soleil de Satan, Les liaisons dangereuses, impossible aussi d’écrire le premier roman, superbe, de Boutang : La maison un dimanche, impossible d'écrire Rodogune et son noeud de vipères familial admirablement tressé tandis que tournoie dans l'obscurité une brillante coupe de poison, en laquelle scintille la Mort, plus noir que la nuit des âmes alentours ; bref l'à peu près intégralité des romans fondamentaux de notre histoire.
[...] Si d’aucuns peuvent, sans que les axones de leurs neurones s’entrelacent de confusion, affirmer que le « mariage pour tous » ne change rien, c’est parce qu’eux-mêmes, en prémisses de leur absence de raisonnement, admettent une définition du mariage qui jà change tout. Si l’on entend dénier au mariage toute pertinence symbolique, en le résorbant en l’orbe atrophié d’une pure déclaration d’affection, le faisant ainsi, en termes hégéliens, le jouet d’une belle âme qui ne trouve sa vérité qu’en ses propres intimes désirs mais ne peut néanmoins s’empêcher de s’en justifier par ce moyen universel qu’est le Langage afin d’obtenir d’autrui manière de légitimation ; déjà, alors, on le défigure, on le prostitue sans vergogne aux autoritaires exigences d'un Surmoi de jouissance couronné souverain. L’égalité des droits est une nécessité qui n’exige rien de plus – nul ne me fera sur ce point dévier – que la mise en place d’une union civile taillée sur mesure pour les couples d’invertis ; laquelle exclurait bien sûr toute prolongation filiale et ne constituerait qu’une manière de faciliter, pour ces personnes, une vie sociale que, parfois, j’imagine effectivement compliquée.
Dans un monde où les mots pourraient encore avoir quelque forme d'importance, ce genre d'union ne pourrait bien sûr être désigné sous le terme de mariage, mais comme je l'ai affirmé plus haut, le post-humain militant ne parle malheureusement plus la langue qu'ici, pour ma part, je m'efforce d'ânonner avec plus ou moins de rigueur et, nonobstant, d'élégance. Lorsqu’il glapit : « mariage pour tous ! » j’entends une évidence qui est celle d’une institution ouverte à tout individu qui désirerait bénéficier d’icelle en tant que structure donnée ; nous ne nous comprenons plus parce que nous n’existons plus dans le même ordre d’être-au-monde, et c’est ce divorce significatif que signe et confirme cette nouvelle utopie des temps nôtres, ou la démence est faite roue libre pour le plaisir de tous et les droits d’aucun. Nous vivons à ce point de vue une époque des plus fascinantes, quoique nauséabonde par de nombreux côtés, qui s’affirme celle d’un tournant radical dans la débâcle post-historique dont Philippe Muray a su analyser les premières effusions. Consummatum est, peut-être, ou très bientôt en tous cas, et ne reste plus qu’à observer, de loin, les gagnants continuer à se battre pour une victoire déjà obtenue et les perdants continuer à résister, myopes, pour sauver tout ce qui est déjà mort et dont à présent ils n’agitent plus que les spectres ridicules et translucides. Peu me chaut que pareil projet soit voté ou ne le soit pas : il l’est déjà et lutter contre de pareilles évidences, tant elles sont démentielles, relève de l’inexorable effort inutile. Je préfère m’employer à prendre cette boue que l’on ne donne même pas afin que d’essayer d’en faire de l’or, – c’est-à-dire de la littérature. Ce qui, en la présente matière, vient d’être fait grâce à ce texte.
> A consulter pour le texte intégral et beaucoup plus : http://amicusveritatis.over-blog.com/article-petit-traite...
07:45 Publié dans Les mots français, Politique & co, Réflexions, philosophie, Thèse | Lien permanent | Commentaires (1)
vendredi, 11 janvier 2013
L'amour est plus froid que la mort - Fassbinder, Fassbinder, Schygulla
Film : L'amour est plus froid que la mort / Liebe ist kalter als der Tod (1969, durée 1h28)
Réalisateur : Rainer Werner Fassbinder
Bruno (Ulli Lommel), Joanna (Hanna Schygulla), Franz (Rainer Werner Fassbinder), Peter (Hans Hirschmüller), Georges (Les Olvides), Raoul (Howard Gaines), la femme dans le train (Katrin Schaake)
- Vous avez trois condamnations à votre actif, deux pour braquage, une pour proxénétisme. Est-ce exact ?
Franz : A peu près.
- C'est parfaitement exact. Nos renseignements sont de premier ordre. Bien. Vous connaissez la raison de notre présence ici ? Dans ce cas, je vais vous l'expliquer. Le syndicat désire que vous travailliez pour nous. Vous fumez ? ... Et les désirs du syndicat sont des ordres, vous le savez. Sur le principe, c'est simple. Vous travaillez et vous êtes régulièrement rémunéré. Cette perspective vous paraît sympathique ? Vous avez une petite amie. Elle est très mignonne, n'est-ce pas ? Allez-vous travailler pour le syndicat ? Vous allez travailler pour le syndicat.
Franz : Je travaille uniquement pour mon compte.
- Raoul...
Raoul (à droite) se lève.
Franz : Je veux pas travailler pour le syndicat.
- Avez-vous réfléchi à la chose ? Votre avenir est assuré au service du syndicat. Le syndicat a les meilleurs avocats, les meilleures relations.
Franz : Je veux être libre.
Munich, 129 rue Hess.
La femme dans le train : A cette station, je me retrouve souvent en agréable compagnie. Vous la voulez, cette pomme ?... Ce que c'est banal. C'est bien ? ... Elle était bonne la pomme.
Bruno : A douze ans, j'ai tué mon père en lui cassant un vase sur la tête. A seize ans, j'étais meneur de bande. Un jour, on a liquidé un type assis sur un banc avec une gamine. On lui avait pissé dessus du haut de la colline. Il est venu râler. On l'a tabassé. Il a tourné de l'oeil. Avec des coups de poing américains. Il était mort. Clamsé, quoi.
La femme : Je t'ai observé. Tu es garé là depuis un bout de temps. T'es seul, pas vrai ? Moi aussi, je suis seule. Tous les deux, on pourrait peut-être...
Franz : Comment c'était ?
Elle lui tend l'argent, s'en va et revient.
Joanna : On devrait avoir un logement où on puisse rester, et un enfant, et du calme.
Il se lève et part.
Munich, 129 rue Hess.
07:53 Publié dans Films historiques, littéraires, N&B, biopics, Les mots des films, Thèse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fassbinder
samedi, 05 janvier 2013
L'Enfer de Dante - Chants 7 & 11 - Considérations sur l'Art et l'argent - Delacroix
Les Limbes, Delacroix
Sont représentés Cincinnatus, Orphée, Sapho, Caton d'Utique, Marc Aurèle, Virgile, Dante, Homère, Horace, Jules César, Trajan, Hannibal, Pyrrhus, Alexandre le Grand, Les Muses, Achille, Aristote, Aspasie, Alcibiade, Démosthène, Ovide, Platon, Socrate, Dante
Source à consulter : http://www.insecula.com/oeuvre/photo_ME0000051356.html
CONSIDERATIONS SUR L'ART ET L'ARGENT
Extrait de La divine comédie, L'Enfer, 1314, Dante, traduction de Jacqueline Risset, GF-Flammarion 1985 :
Chant 11
[...]
"O Soleil qui guéris la vue troublée,
tu me rends si content quand tu résous mes doutes,
que le doute m'est doux autant que le savoir.
Mais reviens encore un peu en arrière",
lui dis-je, "là où tu me dis que l'usure
offense la divine bonté, et délie-moi ce nœud."
"La philosophie", dit-il, "à qui l'entend
enseigne, et dans plus d'un écrit,
comment la nature procède
de la divine intelligence et de son art ;
et si tu lis bien ta Physique*,
tu trouveras, dans les premières pages,
que l'art humain, autant qu'il peut, suit la Nature,
comme un élève suit son maître,
si bien que l'art est comme un petit-fils de Dieu.
Des deux, Art et Nature, si tu as en mémoire
les premiers vers de la Genèse, il faut
que l'homme tire vie, et qu'il avance ;
et puisque l'usurier suit d'autres voies,
il méprise Nature pour elle et pour son art,
puisqu'il met son espoir en un autre lieu.
[...]
* Ta Physique : la physique d'Aristote.
Chant 7
[...]
Là je vis des gens, plus nombreux qu'ailleurs,
de çà, de là, avec des hurlements,
pousser des fardeaux à coups de poitrine.
Ils se cognaient l'un contre l'autre ; et à ce point
chacun se retournait, repartant vers l'arrière,
criant : "Pourquoi tiens-tu ?", "pourquoi lâches-tu ?".
C'est ainsi qu'ils tournaient par le cercle lugubre
sur chaque bord, vers le point opposé,
en criant encore leur honteux couplet ;
puis chacun se tournait, quand il était venu
par son demi-cercle à la deuxième joute.
Et moi qui en avais le cœur comme brisé,
je dis : "Mon maître, explique-moi
qui sont ces gens, s'ils furent tous clercs,
ces tonsurés à notre gauche."
Et lui, à moi : "Tous ils furent borgnes
dans leur esprit durant la vie, de sorte
qu'ils n'eurent aucune mesure en leur dépense.
Leur voix l'aboie très clairement,
quand ils parviennent à ces deux points du cercle
où le péché contraire les désassemble.
Ceux-ci furent clercs, qui n'ont pas de couvercle
de poil en tête, et papes et cardinaux,
en qui l'avarice montre sa démesure."
Et moi : "Maître, chez ces gens-là
je devrais bien en reconnaître quelques-uns
qui furent salis par ces deux vices."
Et lui à moi : "Tu as des pensées vaines :
la vie méconnaissante que firent ces méchants
les brunit à présent à la reconnaissance.
Pour toujours ils iront aux deux points de rencontre :
ceux-ci resurgiront de leur sépulcre
avec le poing fermé, ceux-là le poil rogné*.
Mal donner, mal tenir leur a ôté
le beau séjour, et mis en cette échauffourée :
Ce qu'elle est n'a pas besoin de beaux discours.
Tu peux, mon fils, voir à présent le souffle court
des biens qui sont confiés à la fortune,
pour qui les humains se combattent ;
car tout l'or qui est sous la lune
et a été, ne pourrait donner le repos
à une seule de ces âmes lassées."
"Maître", lui dis-je, "enseigne-moi encore :
cette fortune** que tu nommes, qui est-elle,
qui a tous les biens de la terre en ses griffes ?"
Et lui à moi : "Ô stupides créatures,
quelle ignorance vous opprime !
Je veux que tu saisisses ma pensée.
Celui dont le savoir surpasse tout
fit les cieux*** et leur donna des guides,
si bien que chaque partie lui sur les autres
en répandant une lumière égale.
Pareillement pour les splendeurs mondaines
il mit pour guide une intelligence ordinatrice
qui change à temps tous les vains biens
de race à race, de l'un à l'autre sang,
outre l'opposition des volontés humaines.
Ainsi un peuple règne et un autre languit,
suivant la décision de cette intelligence
qui reste cachée comme serpent dans l'herbe.
Votre savoir ne peut lui résister :
elle pourvoit, juge et maintient son règne
ainsi que font les autres dieux****.
Ses mutations n'ont pas de trêve :
et la nécessité la rend rapide ;
ainsi voit-on les hommes changer souvent d'état.
C'est elle qui si souvent est mise en croix
par ceux-là mêmes qui devraient la chanter,
et qui lui font à tort mauvais renom ;
mais elle est bienheureuse et n'entend rien :
et joyeuse parmi les créatures premières,
elle tourne sa sphère et jouit de soi.
[...]
* avec le poing fermé : symbole d'avarice.
le poil rogné : symbole de prodigalité.
** cette fortune : la Fortune est ici représentée comme un Ange, chargé de régler le cours des affaires humaines. [...]
*** fit les cieux : Dieu crée les neuf cieux et leur assigne les intelligences motrices ; chacune d'elle reflète sa lumière intellectuelle sur chaque ciel matériel, sur chaque sphère céleste, en distribuant également la lumière divine dont elle est douée.
**** les autres dieux : les autres intelligences, vulgairement appelées Anges.
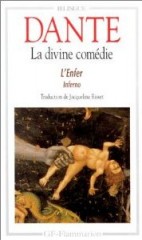 Se procurer l'ouvrage :
Se procurer l'ouvrage :
La divine comédie, L'Enfer
34 chants, écrits en 1314
Dante
1985
Traduction de Jacqueline Risset, GF Flammarion
380 pages, édition bilingue
07:35 Publié dans Beaux-Arts, Ecrits, Foi, Peinture, Poësie, Thèse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dante, l'enfer, divine comédie, delacroix
vendredi, 23 novembre 2012
La charge héroïque - John Ford, John Wayne

Film : La charge héroïque / She wore a yellow ribbon (1950, durée 1h44)
Réalisateur : John Ford
Le capitaine Nathan Cutting Brittles (John Wayne), le lieutenant Flint Cohill (John Agar), le sergent Tyree (Ben Johnson), le sous-lieutenant Ross Pennell (Harry Carey Jr), le sergent Quincannon (Victor McLaglen), le docteur O'Laughlin (Arthur Shields), le sergent Hochbauer (Michael Dugan), Hench (Fred Graham), Mike Quayne (Tom Tyler)
Le major Mac Allshard (George O'Brien), Olivia Dandridge la nièce du major (Joanne Dru), Abby Allshard la femme du major (Mildred Natwick),
Le chef Red Shirt / chemise rouge (Noble Johnson), le chef Pony that Walks / poney qui marche (Chef John Big Tree)
Le narrateur (Irving Pichel)
Oscar pour la meilleure photographie d'un film en couleur.
Voix off : Partout où le drapeau flotte sur un poste isolé de l'armée, il y a peut-être un homme, un capitaine, qui tiendra bientôt entre ses mains l'épée du destin.
Quincannon : Bonjour, mon Capitaine ! Il est exactement cinq heures treize.
Brittles : Cinq heures douze.
Quincannon : Aujourd'hui il fait un très joli temps, aussi frais que l'enfer ! Et madame Janson--- a eu un bébé cette nuit. Le service de diligence d'ici à Sudwall--- est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Un courrier est arrivé voici une heure du poste de Paradise River, mon capitaine. Le pauvre McKenzie a reçu une balle dans la tête.
Brittles : Un garçon ou une fille ?
Quincannon : Euh, c'est un futur cavalier.
Brittles : A partir de quand le service est-il interrompu ?
Quincannon : C'est, c'est fini depuis aujourd'hui, euh, terminé, euh, plus de diligence.
Brittles : Et McKenzie ? Est-il mort ?
Quincannon : Oui, mon capitaine.
Brittles : Ah, un très bon soldat McKenzie. Il serait devenu caporal dans cinq ou six ans. Tu t'es encore pochardé, tu sens l'alcool à vingt pas, ivrogne !
Quincannon : Mais, capitaine chéri, j'ai juré de ne boire que de l'eau après l'affaire des Capulti Peg--- !
Brittles : Et à Belron---, et à Gettysburg et à Shellow, et à la saint Patrick aussi !
Quincannon : Mais non, mon capitaine, je vous jure !
Brittles : Et le jour de ton anniversaire !
Quincannon : Ho-ho-ho, capitaine chéri, oh...
Brittles : J'aimerais savoir où tu caches ton whiskey. [...] Encore six jours. Six jours et je serai à la retraite. Eh bien...
Quincannon : Ce sera plus la même armée quand nous aurons pris notre retraite.
Brittles : L'armée est toujours la même. Le soleil et la lune changent, mais l'armée ne connaît aucune saison.
Quincannon : Nous sommes encore dans la force de l'âge et on nous met au rancart ! Ces gens-là abusent de l'argent que paient les bons et honnêtes citoyens !
Brittles : Toi, les seules taxes que tu paies, ce sont les taxes sur le whiskey !
Brittles : Votre rapport, sergent.
Le sergent : Touché d'une balle de fusil, il était mort à mon arrivée.
Brittles : Où ?
Le sergent : Près de la butte rouge. Les chevaux étaient claqués. L'argent a disparu, mon capitaine.
¤ ¤ ¤
Le commandant : Que pensez-vous de la blessure, docteur ?
Le docteur O'Laughlin : Je vous le dirai dans une heure, mon commandant. Qu'on le porte à l'infirmerie !
Le sergent : Une flèche kiowa ?
Brittles : Non, ni une flèche Commanche, ni Arapahoes, à cause des bandes de couleur.
Tyree : Mon capitaine...
Brittles : Allez-y, sergent, parlez si vous en avez envie.
Tyree : Euh, j'ai déjà vu de ces flèches avec des bandes jaunes et rouges. Ce sont des flèches de Cheyennes du sud.
Brittles : Mais je sais que les Bannocks et les Snakes utilisent souvent ces couleurs.
Tyree : En effet, c'est exact. Mais regardez, on voit le signe du clan. C'est le signe du chien. Je suis sûr que cette flèche-là provient de l'arc d'un soldat chien des Cheyennes du sud.
Brittles : Mais, pour l'amour du ciel, qu'est-ce que vos Cheyennes viendraient faire dans cette région ?
Tyree : Cette question n'est pas de ma compétence.
Brittles : Alertez le poste, sergent.
Le sergent : Oui, mon commandant.
Brittles : Allez vous reposer, sergent Tyree.
Tyree : Merci, mon capitaine.
Cohill : Vous alliez pique-niquer au bord de la mer ?
Pennell : Nous allions seulement auprès de la rivière mais je m'excuse...
Brittles : Evitez de vous excuser, c'est un signe de faiblesse. Monsieur Cohill, il n'y a aucune raison d'empêcher monsieur Pennell de sortir et de pique-niquer.
Cohill : Vos ordres seront exécutés.
Olivia : Merci, capitaine Brittles.
Brittles : Mais, mademoiselle, monsieur Cohill avait parfaitement raison de vous empêcher de quitter le poste car nous sommes en état d'alerte. Permettez-moi de vous raccompagner chez vous. Vous pouvez aller pique-niquer sur l'herbe, monsieur Pennell !
Cohill : Laissez-passer le lieutenant Pennell, sergent !
Le sergent : Laissez-passer le lieutenant Pennell !
Un autre soldat : Laissez-passer le lieutenant Pennell !
Brittles : Voilà Mary, il ne reste plus que six jours à courir, et ton vieux Nathan quittera l'armée. Je n'ai rien décidé. Je ne sais où j'irai. Depuis des années, j'ai servi l'armée de toute mon âme, et maintenant je vais aller croupir dans quelque petite ville, à ne savoir que faire de mon temps. Non, je ne peux me faire à cette idée. Je vais peut-être me diriger vers l'ouest, vers les nouvelles colonies de Californie. Bien triste nouvelle aujourd'hui, Mary. Georges Custer, avec tous ses hommes, tués dans une embuscade. Miles Keogh, Mary, tu te rappelles bien, Miles ? Ce bel irlandais qui riait constamment. Celui qui valsait souvent avec toi. Oui, oui, je le sais, certains jours je t'ai fait des scènes de jalousie. Moi, je n'ai jamais bien su valser. Demain, à l'aube, je sortirai du poste avec la troupe. Il y a des Cheyennes aux alentours. Je rassemble au plus vite les patrouilles isolées, et je les ramène vers le nord. Probablement ma dernière mission, Mary. J'ai de la peine à le croire. J'ai de la peine à le croire.
Olivia : J'espère ne pas être indiscrète, capitaine. Mais je vous ai vu venir ici, sur la tombe de votre femme. Alors, j'ai apporté ceci.
Brittles : Merci. C'est une pensée délicate, mademoiselle.
Olivia : Ce sont des cyclamens, c'est un mot grec qui signifie oreille de lapin, je crois.
Brittles : Ma femme les appelait flèches ardentes. Oui, toute sa vie, elle a aimé les fleurs.
Olivia : J'ai... capitaine, je suis vraiment confuse, je me suis couverte de ridicule ce matin.
Brittles : Ne soyez pas confuse, vous avez seulement tourné la tête à deux lieutenants. Mais il n'ya rien dans les règlements qui l'interdit.
Olivia : Vous n'êtes pas trop fâché ?
Brittles : Ah, laissons cela.
Olivia : Bien... bonsoir, capitaine.
Brittles : Bonsoir, mademoiselle Dandridge, et merci.
¤ ¤ ¤
Brittles : C'est une très gentille enfant. Quand je la vois, je pense à toi.
Brittles : Alors, vieux camarade. Notre dernière patrouille, hein ?
Quincannon : La dernière d'une longue série, mon capitaine !
Brittles : Eh voilà, plus que cinq.
Quincannon : Trois, mon capitaine !
Brittles : J'ai dit plus que cinq.
Quincannon : Trois, mon capitaine !!
Brittles : Tu ne sais plus compter, Quincannon !
Quincannon : Je veux dire trois semaines avant que mois aussi je sois aussi à la retraite.
Brittles : Oh, les jours, les semaines, où est la différence ? Tu vas rester planté là toute la journée ?
Quincannon : Je prie de m'excuser, capitaine chéri...
Brittles : S'excuser est un signe de faiblesse ! Tu es prêt ?
Quincannon : Oui, mon capitaine !
Brittles : Des selles d'amazone ?
Hochbauer : Oui, des selles d'amazone.
Brittles : Des selles d'amazone ? Mon commandant, qui est-ce qui a donné le damné... !
Allshard : Assez, assez, je sais, la voiture.
Brittles : Oui, la voiture, avec des vêtements de femme jusqu'en haut ! Je refuse d'encombrer une patrouille avec une voiture, en particulier cette patrouille !
Allshard : Nathan, je fais partir ma femme et ma nièce avec vous. Elles iront avec la troupe jusqu'à Sudowelles---. Là elles auront la diligence qui les conduira vers l'est et c'est un ordre, capitaine.
Brittles : Et moi je proteste contre cet ordre.
Allshard : Oh, je m'y attendais. Par écrit, sans doute.
Brittles : Oui et tout de suite.
Allshard : Nathan, je n'ai réfléchi qu'à cela toute la nuit. En aucun cas je ne peux les garder ici. Il y a trop de risques à présent.
Brittles : Evidemment, pour les raisons suivantes.
Allshard : Du café ?
Brittles : Premièrement... Non. Oui. Nous savons qu'un parti d'Indiens Cheyennes du clan Chien fait une incursion sur ce territoire.
Allshard : J'ai l'impression que toutes les femmes sont...
Brittles : Un "R" ou deux à "territoire" ?
Allshard : Deux.
Brittles : Ah.
Quincannon : Messieurs ! Je vous demande d'ouvrir bien grandes vos oreilles et d'écouter ce que je vais dire ! Il va y avoir des femmes qui suivront la troupe. Alors messieurs, tâchez voir à surveiller vos expressions !
Un soldat : Tâchez voir à pas abîmer la grammaire !
Quincannon : ... A qui est ce chien ? A qui est ce chien !? Joli chien... un setter irlandais, hu-hu huh ?
¤ ¤ ¤
Allshard : Pauvre Abby. Elle est furieuse, elle dit que tout le monde ici pensera qu'elle a peur. C'est aussi très embêtant pour moi, célibataire pendant tout un hiver.
Brittles : Et en conclusion, je me vois dans l'obligation de protester contre la décision de mon officier supérieur, qui désorganise la troupe en mêlant sa famille aux choses stratégiques...
Allshard : "Q", "U", "E", "S".
Brittles : ... à une heure critique. Signé : Nathan Brittles, et cæaetera.
Allshard : C'est très bien tourné, Nathan. Je vais le mettre dans mon tiroir.
Brittles : Hochbauer ?
Hochbauer : Mon commandant ?
Brittles : Vous avez dû hésiter longtemps, c'était une décision difficile à prendre, mais vous regretterez Abby.
Allshard : Je suis désolée d'avoir à vous encombrer de la sorte, mais entourez-vous de toutes les précautions.
Brittles : Mac !
Allshard : Vous avez raison, je n'aurais pas dû dire ça.
Abby : Ca va, repos, Hochbauer ! Voilà ! Messieurs, je suis à vos ordres. Et qu'a dit ce bougon de capitaine quand il a su que la vieille dure à cuire partait avec lui ?
Allshard : Il a protesté avec énergie.
Brittles : Je l'ai fait par écrit, comme d'habitude. Ce sera avec grand plaisir que j'escorterai notre nationale Amélie ! Puisque c'est un ordre, il n'y a qu'à l'exécuter gentiment.
Allshard : Amélie, quel accoutrement ridicule ! Où avez-vous été dénicher ça ? C'est Quincannon qui vous l'a prêté ?
Abby : Oui !
Olivia : Comment trouvez-vous mon uniforme ?
Cohill : Il est très joli. Et il vous va à ravir. Alors, félicitations, vous arborez le ruban jaune en l'honneur de Pennell.
Olivia : Que diriez-vous si c'était en votre honneur, monsieur ?
Cohill : Euh, j'en serais vraiment très flatté. Et extrêmement heureux. Oui, extrêmement heureux.
Brittles : Bonjour !
Olivia : Le soldat Dandridge est à vos ordres, capitaine !
Brittles : Ah, voilà un gentil petit troupier, très gentil ! Vous n'êtes pas ce cet avis, monsieur Cohill ?
Cohill : Oh si, tout à fait.
Brittles : Et qu'est-ce que je vois, mademoiselle, un ruban jaune ? Vous savez ce que ça signifie dans la cavalerie ? Un amoureux !
Olivia : Oui, vraiment ?
Brittles : Le nom de l'heureux élu ?
Olivia : Mais voyons, c'est vous, capitaine Brittles !
Brittles : Ha-ha-ha, c'est moi, ha-ha-ha ! Ces deux fougueux jeunes gens vont être jaloux !
Abby : Oh, bonjour Flint ! Ma chérie, tu es ravissante ! J'espère que John a vu ton joli ruban jaune.
Pennell : J'ose croire que c'est pour moi que vous arborez ce ruban, Olivia.
Olivia : Voyons, ce n'est pour personne d'autre, John.
Cohill : C'est romantique, mademoiselle. Les étendards flottent dans le vent, des hommes bronzés chantent à tue-tête, les chevaux caracolent,... on a les pieds en compote.
Olivia : Pourquoi est-ce qu'il faut que vous soyez si vulgaire, monsieur Cohill ?
Cohill : Dans la cavalerie, on n'a que faire du raffinement, mademoiselle.
Olivia : La cavalerie... Est-ce que vous ne trouvez pas ridicule d'être obligé de descendre de cheval toutes les heures. A ce compte-là, pourquoi ne pas être... dans l'infanterie ?
Cohill : Nous y serions rapidement si nous claquions nos montures. Vous n'avez qu'à aller dans le fourgon à l'arrière.
Olivia : Non merci. Pourquoi l'armée ne met-elle pas de ressorts à ses voitures ?
Cohill : Les soldats ont préféré avoir des rince-doigts, mademoiselle.
Olivia : Hinh, vous êtes un garçon très spirituel, monsieur Cohill. Avec votre permission, je vais aller un peu à l'arrière de la colonne. J'aime mieux avaler de la poussière avec monsieur Pennell.
Cohill : Je vous assure que vous lui avez assez jeté de poudre aux yeux. Pourquoi ne le laissez-vous pas tranquille ?
Brittles : Monsieur Cohill, relevez monsieur Pennell à l'arrière-garde !
Cohill : Oui, mon capitaine !
Abby : Aaah l'armée... Moi, j'ai planté plus de vingt jardins dans les dix années qui ont suivi notre mariage, et jamais je ne suis restée assez longtemps pour récolter un légume ou une fleur.
¤ ¤ ¤
Brittles : Je ne sais pas qui vous a donné cette cervelle, sergent, mais c'est sûrement Dieu qui vous a fait cadeau de ces yeux-là. Ce sont des Arapahoes en effet. Et ils vont du même côté que nous. J'aimerais pourtant savoir pourquoi ils vont à SudoWells---. Sergent, vous avez une idée ?
Cohill : Ma mère n'a pas donné le jour à un fils pour jouer aux devinettes avec un capitaine.
Brittles : Bon, je le saurai bientôt. C'est un risque que je n'ose courir avec deux femmes.
¤ ¤ ¤
Brittles : C'est inquiétant, monsieur Cohill. C'est très inquiétant.
Cohill : Des Arapahoes sans doute.
Brittles : Nous allons les contourner, messieurs. En passant par l'est, nous approcherons de Sudo Wells- par Twin Forks.
Allshard : Mais ça va nous retarder d'une demi-journée, et ces dames vont manquer la diligence.
Brittles : Préféreriez-vous qu'il leur manque leurs cheveux, monsieur ? Allez en tête de la colonne, lieutenant Cohill.
Cohill : Oui, mon capitaine.
Allshard : Je m'excuse d'avoir dit...
Brittles : Oh, ça suffit !
¤ ¤ ¤
Pennell : Je vous relève, monsieur Cohill ! Je reprends l'arrière-garde.
Cohill : Je vous cède la place avec plaisir. Le vieux ne m'a pas dit un mot durant trois heures. "Mais ces dames vont manquer la diligence." Ho-ho, estimez-vous heureux si le vieux vous dit quoi que ce soit avant trois jours.
Pennell : Il n'aura pas d'autre occasion de le faire.
Cohill : Tiens ! Ainsi, le lieutenant Pennell veut toujours rentrer dans la vie civile.
Pennell : Sans aucune hésitation !
Cohill : J'aurai le regret de déchirer votre demande. Voyons, mon vieux, vous êtes dans le cas de tous les sous-lieutenants. Cette existence les décourage et ils ont le cafard de temps à autre.
Pennell : Moi, c'est différent. Je n'ai pas besoin de la solde que m'alloue notre gouvernement.
Cohill : C'est exact, vous êtes un gosse de riche. Je n'y songeais plus. Mais mademoiselle Olivia Dandridge le sait, aussi vous préfère-t-elle !
Pennell : Voulez-vous que nous réglions cette affaire à coups de poing, monsieur Cohill ?
¤ ¤ ¤
Cohill : Pourquoi vous acharnez-vous à séduire John Pennell ? Sans vous, il ferait un excellent officier.
Olivia : Etes-vous chargé de veiller sur lui ou sur moi, monsieur Cohill ?
Cohill : Je vous dis ma façon de voir quand même. John est un enfant de riche, trop gâté, et l'armée est sa seule chance. Alors, puisque vous détestez l'armée, laissez-le en paix !
Olivia : Tante Emilie, est-ce que vous êtes sûre ?
Abby : Oui, ce sont des buffles.
Quincannon : Ah, il y en a quelques milliers. Ca me rappelle l'époque où j'étais jeune. Hé-hé-hé, le whiskey ne valait que cinquante cents la bouteille ! Ha-ha-ha !
- Je serais content de goûter la viande de ces bêtes-là.
- Moi aussi. J'aimerais en tâter.
- Mangez donc des haricots. Croyez-moi, c'est plus prudent. Ah, vous allez voir les Indiens arriver à toute allure, et il y aura du vilain.
Brittles : Quelle est votre idée, sergent ? Et ne me dites pas que vous n'êtes pas compétent.
Cohill : C'est-à-dire, mon capitaine, on ne me paie pas pour avoir des idées. En tout cas, voilà ce que je pense. Si j'avais autant d'ambition qu'un jeune peau rouge, et si j'étais très impatient de me faire valoir aux yeux des Cheyennes, je me planterais devant le feu de camp, le soir, et je leur parlerais. Je dirais que c'est moi qui, par mes sortilèges, ait fait venir les buffles ici. Je discourrais sur la puissance du grand manitou. Je crierais que les Indiens ont intérêt à s'unir, qu'ils ne doivent plus se quereller. Qu'ils doivent aider leurs frères Cheyennes, qui ont battu le général Custer, et infligé de grosses pertes aux soldats Yankees. Oui, c'est bien ce que je ferais. Oh, évidemment, je ne fais que deviner, mon capitaine.
Brittles : Oui, évidemment je devine aussi, sergent. Mais si j'étais agent officiel, comme l'est ce monsieur Rinders---, je m'adjoindrais un bon complice ou deux, pour faire de la contrebande d'armes. Je profiterais de cette magnifique occasion et je serais tout près du camps des têtes rouges, très décidé de leur offrir au plus haut prix mon stock de bons fusils.
¤ ¤ ¤
Quayne : Caporal Quayne, mon capitaine. Rapport de la patrouille de Paradise River. Les Arapahoes nous ont surpris au coucher du soleil !
McCarty: Avec Red Shirt à leur tête, mon capitaine ! Ce fils de chienne et ces sauvages nous tiré dessus !
Quayne : La ferme, McCarty !! Vous autres taisez-vous ! C'est moi qui fait ce rapport, oui ou non ?
McCarty et les autres : Ca va, Mike, calme-toi, ça.
Quayne : Ils nous avaient encerclés mais, pendant la nuit, on s'est échappés. Après, on a été vous attendre au point indiqué. Vous n'y étiez pas à l'heure dite.
Brittles : Nous avons été un peu retardés, caporal. Mais continuez.
Quayne : De nouveau on a été attaqués, au lever du soleil. Et j'ai été touché.
Brittles : C'est un excellent rapport. Il sera dans votre dossier. Il vous aidera à passer sergent... dans deux ou trois ans.
Quayne : Merci, mon capitaine.
Brittles : Sonnez l'ambulance.
Quayne : Doucement.
Brittles : Bon travail. Bon travail McCarty, bon travail, mes amis ! On va vous donner du whiskey, Quayne. Après, ça ira !

Le docteur O'Laughlin : Je vais tenter une opération très difficile. Il faudrait faire...
Brittles : Ah non, ce serait trop risqué.
O'Laughlin : Rien qu'une demi-heure, Nathan ! Vingt-cinq minutes et je suis certain de pouvoir le sauver.
Brittles : Docteur, arrêter la colonne serait une folie, je ne la commettrai en aucun cas. Quayne est un soldat, il doit courir les risques du soldat.
O'Laughlin : Il sait cela ! C'est moi qui le demande, Nathan.
Brittles : Je vais essayer de vous aider. Halte ! Pied à terre !
O'Laughlin : Je vous remercie.
Abby : Avalez un grand coup.
Quayne : Après vous, madame, s'il vous plaît.
Abby : Ohhh, l'alcool, ça donne du courage.
Olivia : Je suis bien contente pour ce pauvre caporal Quayne.
Cohill : Pourquoi ? Ce n'est rien qu'un soldat quelconque, revêtu d'une sale vareuse bleue. Qu'il meure ou qu'il vive, quelle différence y'a-t-il ? Avez-vous dansé avec ce malheureux au fort ? L'avez-vous regardé ? Avez-vous dit quelque chose à cet homme ? Bien sûr que non, il n'a pas de galon d'officier, ce n'est pas un gentleman.
Olivia : Je commence à croire qu'on peut être officier sans être un gentleman.
Cohill : Vous êtes sûrement contente de la guérison de Quayne, mais seulement parce que ça vous donne un dénouement heureux à l'histoire que vous pourrez raconter entre le thé et les petits gâteaux. Eh bien, vous direz à vos amis que vous avez tout vu. Une charge contre les indiens, un soldat avec une flèche fichée dans les côtes...
Olivia : Monsieur Cohill !
Cohill : Votre villégiature ici aura été presque parfaite !
Un soldat : Oh-ho, madame Allshard a de gros ennuis là-bas, mademoiselle Dandridge, le chloroforme et le reste. Voudriez-vous aller l'aider ?
Olivia : J'y vais tout de suite, capitaine, j'en ai assez entendu.
Brittles : Monsieur Cohill, est-ce que vous avez déjà reçu une paire de claques ou une fessée ?
Cohill : Mais non, mon capitaine. C'est-à-dire oui, de mon père lorsque je faisais des bêtises.
Brittles : J'ai l'impression que je suis assez vieux pour être votre père, mon ami. Allez, au galop, maintenant !
Cohill : A votre place, je n'irai pas plus loin. Nous sommes déjà assez éloignés du camp. Il y a probablement des Indiens autour de nous. Ils nous surveillent sans que nous les voyions.
On entend siffler.
Cohill : Ne croyez pas que c'est un oiseau. Venez, Olivia, retournons maintenant.
Olivia : Je reviendrai bien toute seule, merci.
Cohill : Olivia. Notre vieux capitaine dit qu'il ne faut jamais s'excuser, que c'est un signe de faiblesse. Mais j... je m'excuse... de ce que j'ai fait, et de tout ce que je vous ai dit jusqu'ici. Oh, chérie, je vous aime tant.
Pennell : C'est bon, Flint, finissons-en ! Enlevez-votre vareuse !
Cohill : Est-ce que vous êtes fou, Pennell ?
Pennell : Ce n'est pas parce que vous êtes mon supérieur que vous m'impressionnez. Vous êtes malade de jalousie !
Cohill : Veuillez reboutonner votre vareuse !
Olivia : John, je vous ne prie.
Pennell : Je vous interdis de faire la cour à la jeune fille que j'aime !
Cohill : Dans ce cas, monsieur, je suis à vos ordres. Réglons cette affaire tout de suite, je suis de votre avis.
Brittles : Mettez-vous en tenue, monsieur Pennell. J'avais meilleure opinion de vous. Il y a quatre ans que vous êtes ici, et vous agissez encore comme un cadet qui sort de l'école. Je voudrais savoir ce qui se passe, monsieur Cohill.
Cohill : Je regrette. Cette histoire ne regarde que nous, et je ne puis répondre.
Brittles : Monsieur Cohill, je suis extrêmement déçu de votre attitude. Il y a déjà neuf ans que vous êtes officier, vous avez l'expérience de la cavalerie. Et c'est à vous que je vais bientôt remettre le commandement de la troupe qui a été sous mes ordres. Est-ce que vous vous croyez capable d'être un chef, vous qui alliez vous battre à coups de poing comme un charretier ou un ivrogne avec un inférieur, alors que les tambours résonnent encore sur la tombe d'un homme a su se sacrifier. Le Seigneur protège la troupe quand je serai parti.
Pennell : C'est ma faute.
Brittles : Veuillez vous taire, monsieur Pennell !
Olivia : Capitaine, c'est un malentendu !
Brittles : Vous, je vous prie de regagner le camp ! Monsieur Cohill, veuillez dire aux hommes de faire de très grands feux ce soir. Je veux donner l'impression que nous nous installons pour quelques temps. Et nous partirons dans la nuit. Nous irons vers la rivière. Nous rentrons au poste.
Cohill : Je m'excuse, John.
Pennell : Je m'excuse, Flint.
- Je viens de voir notre ami, monsieur Rinders---, non loin d'ici, en train de faire d'excellentes affaires.
Brittles : Monsieur Rinders---... j'en étais sûr. Avertissez monsieur Pennell à l'avant-garde. Suivez-moi.
Un Indien : *ù%§¤£µé"'_çè('-($$£^^$**§§ù !
Le traducteur de Rinders : Il dit que cinquante dollars, c'est beaucoup trop.
Rinders : Beaucoup trop ? Alors dites à ce fils de voleur de chevaux que je sais qu'il a volé l'argent de l'officier Peyer---. Dites-lui que je sais qu'il a tué le major Shilde---. Et que s'il ne donne pas cinquante dollars, il n'aura aucun fusil.
Le traducteur : *ù%§¤£µé"'_çè('-($$£^^$**§§ù !
Abby : Il ne me dira certainement pas cela, Nathan, parce que le mot "adieu" est inconnu dans la cavalerie. Nous nous reverrons à votre prochain poste.
Olivia : Moi aussi, je serais contente d'aller vous voir, capitaine.

07:23 Publié dans Films historiques, littéraires, N&B, biopics, Les mots des films, Thèse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charge, heroique, she, wore, yellow, ribbon, john, ford, wayne
jeudi, 22 novembre 2012
Un été 42 - Jennifer O'Neill

Film : Un été 42 (1971, durée 1h43)
Réalisateur : Robert Mulligan
Musique : Michel Legrand
D'après les mémoires de Herman Raucher
Dorothy (Jennifer O'Neill), Herbert (Gary Grimes), Oscar (Jerry Houser), Bernard (Oliver Conant), Aggie (Katherine Allentuck), Miriam (Christopher Norris), le droguiste-épicier (Lou Frizzell)
¤ ¤ ¤
Voix off : Quand j'avais quinze ans, ma famille est venue passer les vacances dans l'île. Il y avait beaucoup moins de maisons et beaucoup moins de gens que maintenant. Le caractère de ville et la singularité de la mer étaient beaucoup plus remarquables à cette époque-là. Pour qu'un garçon ne meurt pas d'ennui, il fallait que sa famille soir sure que d'autres familles du voisinage fourniraient à l'île son contingent d'enfants.
Pendant l'été de quarante-deux, il y avait en plus de moi Oscar, mon meilleur ami, et Bernard, mon second meilleur ami. Nous nous étions donné le nom de "trio terrible"
Cette maison isolée était celle qu'elle habitait. Personne, depuis la première fois que je l'ai vue, ni rien de ce qui m'est arrivé ensuite, ne m'a donné une telle sensation de peur et de confusion. Aucun des êtres que j'ai connus n'a autant fait pour me rendre plus sûr de moi et plus incertain, plus persuadé de mon importance et de mon insignifiance.
Bernard : Hé, hé Oscar, regarde, c'est encore cette femme.
Oscar : Oh, Herbert, tu vas pas encore recommencer à te mettre en transe, non ? Ah, j'te l'jure, je sais pas ce qui te prend avec elle. Tu ne t'es pas encore aperçu que c'était une vieille ? Je vois pas l'intérêt, moi.
Bernard : C'est pour son esprit ! Leurs esprits vont peut-être se rencontrer et se dire "salut !".
Oscar : Tu devrais aller lui dire bonjour à son esprit, Herbert ! Vas-y, va lui dire bonjour.
Herbert : Ca va, écrase.
Oscar : Allez, vas-y, si elle est l'amour de ta vie, il faut que tu ailles la saluer. Allez, dépêche-toi, on veut te voir lui dire bonjour. T'es peut-être un tombeur formidable ? On n'en sait rien après tout.
Dorothy : J'ai reçu une lettre de douze pages aujourd'hui !
Herbert : Oh c'est chic ça.
Dorothy : Oui alors, c'est chic !
Dorothy : Vous avez beaucoup d'amis dans l'île ?
Herbert : Euh, deux.
Dorothy : Ah.
Herbert : Mais c'est des types... pas très mûrs, vous voyez ?
Dorothy : Et qu'est-ce que vous faites pendant les vacances ?
Herbert : Il y a évidemment le basket qui me plaît. Mais j'trouve que ça vaut quand même pas le baseball. Au moins, au baseball, on n'a pas les épaules tombantes à force de dribbler.
Dorothy : Non, c'est très juste. Vous aimez la musique ?
Herbert : Oui, oui, je suis très musicien.
Dorothy : Ah, vous jouez d'un instrument ?
Herbert : Oui, je chante. Moi j'trouve que la voix, c'est une sorte d'instrument.
Dorothy : Oui, moi aussi.
Herbert : Et puis on peut toujours siffler pour changer.
Dorothy : C'est évident.
¤ ¤ ¤
Oscar : Comment ça a marché ?
Herbert : Pas mal.
Oscar : Qu'est-ce que t'as fait ?
Herbert : Oh j'lui ai tenu un nichon.
Oscar : C'est pas vrai !
Herbert : Pendant près de onze minutes.
Oscar : Sans blague ! Formidable !
Herbert : Onze minutes pleines.
Oscar : T'as chronométré ?
Herbert : Ouais. Le plus que j'avais fait c'était huit minutes avec Lily Harrisson.
Oscar : Alors t'as battu ton record.
Herbert : De trois minutes.
Oscar : Quel effet ça te faisait ?
Herbert : Comment l'effet que ça faisait ? L'effet d'un nichon !
Oscar : Pas plutôt l'effet d'un bras ?
Herbert : Un bras ?
Oscar : Oui.
Herbert : Non, ça faisait l'effet d'un nichon.
Oscar : Et moi j'te parie que c'était comme un bras.
Herbert : Pourquoi ça aurait été comme un bras ?
Oscar : Parce que c'en était vraiment un.
Herbert : Non mais sans blague, t'es pas un peu cinglé ?
Oscar : C'que tu tenais, c'était son bras. J't'ai regardé, c'est justement pour ça que j'te dis ça. Tu lui a serré le bras pendant onze minutes, hé patate ! Alors ton record de huit minutes avec Lily Harrisson tient encore.
Herbert : T'es un menteur et un dégueulasse !
Oscar : Oh, j'te mentirais pas pour un bras, Herbert.
Herbert : C'était un bras ? Oh merde alors, dire que je m'excitais juste à cause d'un bras.
Oscar : Oui, mais c'était un très joli bras.
Herbert : T'es un beau salopard !
Oscar : Quoi ?
Herbert : Un beau salopard ! Pourquoi tu m'l'as dit ?
Oscar : Quoi ?
Herbert : Pourquoi tu m'as pas laissé croire que c'était un nichon ?
Oscar : Il fallait que tu saches la vérité. Il faut que tu t'instruises pour pas faire la même gourance une autre fois.
Herbert : T'as seulement voulu me gâcher mon souvenir, espèce de salopard.
Oscar : Oh, dis, moi j'en ai rien à foutre si tu passes toute ta vie en t'amusant à serrer des bras. Mais il faut que tu vois la réalité, surtout si tu chronomètres tes performances pour battre des records.
Herbert : Oh j'crois que t'as raison. Bon Dieu, je pourrai plus jamais la regarder en face.
Oscar : T'auras qu'à lui dire de mettre des manches longues.
Herbert : Un bras, c'est pas vrai !
Oscar : Un bras de onze minutes !
Herbert : Un bras ! Un bras !
Oscar : Lily Harrisson, ton record est toujours bon !
Herbert : Lily Harrisson !
Dorothy : Mais qu'est-ce qu'il y a ? Vous vous sentez bien ?
Herbert : Euh oui.
Dorothy : Vos jambes tremblent.
Herbert : J'crois que l'escabeau est pas très solide.
Dorothy : Vous voulez que je vienne ?
Herbert : Vous pouvez me passer un autre paquet maintenant.
Dorothy : Voilà, c'est le dernier. Ca y est, vous pouvez descendre. Vous m'avez bien aidée. Ecoutez, cette fois, il faut que vous me laissiez vous donner un peu d'argent.
Herbert : Non-non, je veux pas d'argent, merci.
Dorothy : Oh, mais il faut accepter. Jamais je ne serais arrivée à monter ces boites au grenier à moi toute seule.
Herbert : Non, vraiment. Je vous aime bien.
Dorothy : Vous êtes très gentil, Herbert, je vous aime bien aussi.
Herbert : Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens que j'aime.
¤ ¤ ¤
Oscar : Ah, j'aimerais les peloter toutes, les filles. Tu sais, j'aurais qu'à faire semblant de tomber dessus, et elles s'apercevraient de rien.
Herbert : Eh non, c'est pas comme ça qu'il faut faire.
Oscar : Non ? Alors comment il faut faire ?
Herbert : Faut leur dire des choses.
Oscar : Ouais, c'est ça, j'vais leur dire "Excusez-moi..."
Herbert : Tu sais très bien c'que j'veux dire. Tu peux pas accoster une fille et lui tomber dessus comme ça. Ca s'fait pas.
Oscar : Pourquoi ? Je l'ai fait à Gladys Potter.
Herbert : Ouais mais c'est une p'tite gosse de douze ans. Elle sait rien.
Oscar : C'est pas sûr. En tout cas, elle a pas rouspété.
Herbert : Elle a été surprise.
Oscar : Oui, moi aussi, y'avait rien à peloter. Hé Bernard, tu t'amènes, oui ? J'sais pas c'qu'on va faire de lui. Il n'a aucune émotion.
Herbert : Il est troublé, c'est de son âge.
Oscar : Oui. C'est comme moi. Je m'réveille au milieu de la nuit en ce moment. Toutes les nuits.
Herbert : Ouais, c'est normal. Moi aussi.
Oscar : Toi aussi ?
Herbert : Oui.
Oscar : Ben ouais, mais... je m'réveille comme un dingue. Et je pense à Vera Miller.
Herbert : Et alors ?
Oscar : Alors ? Je déteste Vera Miller. Tu crois que j'suis amoureux d'elle ?
Herbert : J'en sais rien, moi.
Oscar : Non, j'peux pas être amoureux d'elle, puisque j'la déteste.
Herbert : Quel genre de pensées tu as à propos d'elle ?
Oscar : Benh, j'ai oublié.
Herbert : Alors qu'est-ce que tu veux que j'fasse pour toi ?
Oscar : Personne te demande de faire quelque chose pour moi.
Bernard : De quoi vous parlez, tous les deux ?
Oscar : De choses que tu comprendrais pas.
Bernard : Oh, va te faire voir !
Oscar : C'est justement de ça qu'il est question, Bernard. Dis dons, si au lieu de m'envoyer aller m'faire voir, t'aller voir une fille, toi ?
Bernard : Ouais, d'accord.
Oscar : Haa, d'accord qu'il a dit ! Ca c'est quelque chose ! Tu saurais même pas pas où commencer.
Bernard : Si, j'saurais.
Oscar : Alors, par quoi tu commencerais ?
Bernard : Pas la peloter !
Oscar : Mais non, par l'embrasser.
Bernard : T'as pas embrassé Gladys Potter.
Oscar : Parce que j'avais pas le béguin pour elle. Quand on a le béguin pour une fille, on l'embrasse d'abord ! C'est pas vrai, Herbert ?
Herbert : C'est plus poli.
Bernard : En tout cas, c'est pas forcé.
Oscar : Mais si, c'est forcé, hé cloche !
Bernard : C'est pas vrai !
Oscar : Aah, qu'est-ce que t'en sais ?
Bernard : J'l'ai lu dans un bouquin.
Bernard : Si ma mère savait que j'ai pris c'bouquin ! Il n'est pas à moi ! Il n'est pas non plus à ma mère ! Il appartient aux gens qui nous louent la maison. Si vous faites des taches, j'vous préviens, c'est vous qui trinquerez ! Ha, ma mère va s'apercevoir qu'il est plus là. C'est le plus gros livre de l'étagère. J'en ai fait tomber dix en le prenant !
Herbert : Dépêche-toi, quoi.
Oscar : J'peux pas lire aussi vite que toi.
Herbert : Allez, tourne !
Oscar : Tu crois que c'est vrai tout ce qu'ils disent là-dedans ?
Herbert : Oh oui, c'est un bouquin médical. Ils racontent pas d'histoires.
Oscar : Mais... mais comment ils prennent ces photos-là ?
Herbert : Ils doivent avoir des appareils spéciaux.
Oscar : Oh, penses-tu, aucun drugstore ne voudrait les développer ! Si on portait des trucs pareils au père Sanders, on s'ferait mettre en maison de correction.
Herbert : Oui, sans doute qu'ils les développent eux-mêmes. Oui, je pense que c'est comme ça qu'ils doivent faire.
Bernard : Laisse-moi voir.
Oscar : Oh, vas-t-en, Bernard ! Ca va te faire baver.
Bernard : Mais c'est à moi, c'bouquin !
Herbert : Oh tu peux le laisser voir, merde.
Oscar : Tiens, là ils le font !
Herbert : J'crois pas que ça soit ça.
Oscar : Benh si tu crois pas, c'est dommage pour toi parce que, quand ce sera ton tour de l'faire, il vaudra mieux que tu saches.
Bernard : Oh non, c'est pas comme ça. Mon père et ma mère font jamais ces trucs-là ! Jamais !
Oscar : Pourquoi ça ?
Bernard : Parce que c'est stupide.
Oscar : Oh écoute, je regrette beaucoup de te l'apprendre, mais c'est comme ça qu'on fait.
Bernard : Dites, vous avez intérêt à pas me charier, parce que ça pourrait être dangereux pour vos gueules.
Herbert : Oh écoute, Bernard, si tu regardes simplement les photos comme ça, bien sûr que ça a l'air bête. Mais quand deux personnes s'aiment, il paraît que ça peut vraiment faire plaisir.
Bernard : Oh, qu'est-ce que t'en sais ? Tu l'as jamais fait, alors tais-toi.
Herbert : C'est c'qui est marqué dans l'bouquin. En noir et blanc et en couleurs. C'est pour ça qu'on s'embrasse d'abord ! C'est la meilleure manière de faire connaissance. Une fois que les gens se connaissent, ils deviennent amoureux et une fois qu'ils sont amoureux, ils font l'amour.
Oscar : Pré-li-mi-naires, ça s'appelle "préliminaires" ! Euh, d'abord, tout le monde se déshabille, et après on fait les préliminaires. Ensuite, lui il fait ça. Et puis elle, elle fait ça ; lui, il fait, ça, et en moins de deux, ils sont en train de se grimper ! C'est tout ce qu'il y a de plus simple, tu avoueras ! Tu sais, moi aussi, avant de voir les photos, je croyais que c'était pas possible, ces choses-là. Mais c'est des photos prises d'après nature. C'est pas comme des dessins. Moi, j'en ai vu des dessins. Ca, c'est des vraies photos.
Herbert : Mais qu'est-ce que tu fous ?
Oscar : Eh bien je fais deux copies, une pour moi et une pour toi. Tu pourras l'avoir tout le temps sous la main pour l'étudier et la consulter.
Herbert : Mais à quoi ça va me servir ?
Oscar : Tu vas pas t'amener chez une fille avec un livre sous le bras, alors j'en fais un résumé point par point. Si tu suis exactement, ça marchera.
Herbert : Ecoute, j'suis bien embêté. J'crois que j'ai des sentiments profonds pour elle.
Oscar : Et alors ?
Herbert : Alors j'veux pas juste coucher avec elle. J'la respecte.
Oscar : Herbert, il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. C'est très bien de respecter une fille, mais elle ne te respecte pas si tu n'essaies pas de coucher avec elle.
Herbert : J'crois pas à ça.
Oscar : Mais c'est vrai, c'est mon frangin qui m'la dit. Toutes les femmes sont comme ça. Elles veulent qu'on essaie, même si elles ne marchent pas. Parce que, même si elles ne te laissent pas faire, elles veulent que tu essaies.
Herbert : J'cois que je vois ce que tu veux dire, oui.
Herbert : Vous allez bien ?
Dorothy : Très bien, merci, et vous ?
Herbert : Pas mal.
Dorothy : Bien. Quelle merveilleuse matinée ! Ca sera une belle journée, je crois.
Herbert : Ah oui, je crois aussi. Au fait, les boites qu'on a mises au grenier, tout va bien ?
Dorothy : Oui-oui, ça va très bien, elles sont toujours en place.
Herbert : Elles sont mieux là-haut.
Dorothy : Mmmmh.
Herbert : Oh je vous aurais invitée au ciné, mais c'est le même film. Vous voulez le revoir ?
Dorothy : Oh, non, non, merci.
Herbert : Au fond, j'vous comprends, quand on connaît la fin, ça perd tout son intérêt.
Dorothy : Oui.

Herbert : Vous n'avez pas chez vous d'autres objets lourds à déménager ?
Dorothy : Oh, non, je vois pas pour l'instant.
Herbert : Si vous vouliez quelque chose, faut pas vous gêner.
Dorothy : Entendu, j'y penserai, merci.
Herbert : Vous serez chez vous ce soir ?
Dorothy : Pardon ?
Herbert : Je pensais que je pourrais peut-être passer. Je dois justement aller par-là.
Dorothy : Alors vous n'aurez qu'à passer.
Herbert : Je suis pas tout à fait sûr de pouvoir, hein, alors comptez pas trop sur moi.
Dorothy : Bien. Oh, il commence à être tard, il faut que j'aille à la poste, je dois expédier des lettres.
Herbert : J'peux vous les porter si vous voulez.
Dorothy : Oh, non, non merci, c'est un peu compliqué, c'est pour l'étranger, merci quand même.
Herbert : Hé, dites, j'connais même pas votre nom.
Dorothy : Dorothy.
Herbert : J'ai eu une chatte qui s'appelait comme ça. Elle est passée sous un camion.
Dorothy : Au revoir.
¤ ¤ ¤
Herbert : Oh dis donc, c'est dingue !
Oscar : Quoi ?
Herbert : Le numéro III !
Oscar : Qu'est-ce que ça a de dingue ?
Herbert : Jamais j'ai entendu ce mot-là !
Oscar : C'est du latin. Les gars qui ont trouvé ça étaient des latins.
Herbert : J'sais même pas comment ça s'prononce !
Oscar : Ne le prononce pas, fais-le.
Herbert : Mais je sais même pas où ça se tient ! Et de quoi est-ce qu'ils parlent au numéro 4 ?
Oscar : C'est aussi du latin, tout est en latin, tu vois pas ?
Herbert : Ah oui, alors j'vais lui demander où se trouvent tous ces trucs-là ?
Oscar : Oh, ils sont tous à peu près au même endroit. Cherche t tu trouveras. Et puis d'ailleurs, elle sera là pour t'aider.
Herbert : Oh oui, j'espère, parce que je vais vachement avoir besoin d'aide.
Oscar : Le numéro VI, Herbert, c'est très important.
Herbert : Préliminaires ?
Oscar : Oui, c'est un mot qui revient à tout bout-de-champ.
Herbert : N'empêche que j'sais toujours pas quoi faire. J'vais pas lui dire "On fait un coup de préliminaires" ?
Oscar : Je t'ai déjà dit que tu n'avais pas besoin de parler.
Herbert : Tu crois ça ? Au numéro II, ils disent en toutes lettres qu'il faut converser.
Oscar : Oui, mais quand tu arrives au numéro VI, tu n'as plus besoin de rien dire, tu pousses des gémissements. Des gémissements, c'est tout.
Herbert : Mais elle croira que j'ai mal au cœur.
Oscar : Non, elle poussera aussi des gémissements.
Herbert : Ca risque de faire du chahut. Bon Dieu... Dis donc, Oscar, si je vais au bout des XII paragraphes, je vais lui faire un gosse ? J't'assure que j'tiens pas à avoir un gosse à mon âge ! Oh, j'aime mieux laisser tomber !
Oscar : Oh c'est pas croyable c'que tu peux être balo.
Herbert : J'suis peut-être balo, mais j'ai pas du tout envie d'être père. Deux maux ne font pas un bien.
Oscar : Prends des précautions. Mets une capote anglaise. T'as jamais entendu parler des capotes ?
Herbert : Si, bien sûr, j'sais c'que c'est.
Oscar : Alors ça va. Tu n'as qu'à en mettre une, c'est tout. Moi, j'ai déjà la mienne. Quand mon frère est parti à l'armée, il m'en a fait cadeau. J'la porte toujours sur moi depuis c'teps-là. Elle me sert de talisman.
Herbert : Combien tu m'la vendrais ?
Oscar : Elle me vient de mon frère. J'la vends pas, c'est un bijou de famille ! Tu n'as qu'à t'en acheter une autre. Y'en a au drugstore.
Herbert : Oh, j'peux pas risquer l'coup ! Puis il verrait bien que j'ai pas encore l'âge ! Et puis d'ailleurs, j't'apprendrais qu'il y a tout le temps des femmes dans le drugstore.
Oscar : Où et-ce que tu espères en trouver ? Dans un magasin de sport ?
Herbert : Enfin, si t'étais un vrai copain, tu me prêterais la tienne !
Oscar : Quoi ?
Herbert : J'te la rendrai !
Oscar : Oh-ho, Herbert, j'commence à croire sérieusement que tu dois être pédé !
Herbert : Tout va bien, j'te remercie.
Oscar : Non, non, j'veux dire que tu n'connais rien de rien. Une capote anglaise, ça ne sert qu'une fois. Seulement une fois et seulement pour une personne. On ne pet jamais la partager, même avec son meilleur ami.
Herbert : Oh... Y'a qu'à laisser choir, tant pis.
Le droguiste : Qu'est-ce que vous cherchez ? J'pourrais peut-être vous aider à trouver.
Herbert : Oh,... je l'saurai en le voyant.
Le droguiste : Pourquoi ne me dites-vous pas ce que vous cherchez ?
Herbert : Oh,... j'vais vous l'dire. Je viens juste de me rappeler.
Le droguiste : Hein, oui ?
Herbert : J'voudrais une glace, à la fraise.
Le droguiste : Très bien, venez avec moi. Simple ou double ?
Herbert : Vous pouvez m'en donner une triple.
Le droguiste : Voilà, ça fait dix cents.
Herbert : J'aurais besoin d'autre chose, j'viens de me rappeler.
Le droguiste : Oui, qu'est-ce que c'est ?
Herbert : Un peu de chocolat.
Le droguiste : Bon, très bien. Du chocolat. Et voilà.
Herbert : J'vous remercie.
Le droguiste : Ca nous fera douze cents. Vous désirez autre chose ?
Herbert : Euh, oui, je regrette de vous déranger, mais je...
Le droguiste : Parlez, je vous écoute.
Herbert : J'peux avoir une serviette ?
Le droguiste : Oui, voilà. Et avec ça ?
Herbert : Est-ce que j'peux avoir des capotes ?
Le droguiste : Pardon ?
Herbert : J'ai entendu dire que vous en avez.
Le droguiste : Que j'ai quoi ?
Herbert : Oh, voyons, vous savez bien.
Le droguiste : Des préservatifs ?
Herbert : Oui ! Voilà.
Le droguiste : Et vous avez l'intention d'en acheter.
Herbert : Oui.
Le droguiste : Pourquoi faire ?
Herbert : Oh, j'pense que vous devez l'savoir.
Le droguiste : Très bien. Quelle marque ?
Herbert : Quelle marque ?
Le droguiste : Oui, quelle marque ? Quel modèle ?
Herbert : L'habituelle.
Le droguiste : Oh, vous savez, il y a plusieurs marques.
Herbert : Ne les étalez pas, c'est pas la peine !
Le droguiste : Alors, lequel voulez-vous ?
Herbert : Le paquet bleu.
Le droguiste : Et combien en voulez-vous ?
Herbert : Oh, trois douzaines ?
Le droguiste : Vous prévoyez une belle nuit !
Herbert : Oh, juste comme d'habitude.
Le droguiste : Ca nous fera douze dollars.
Herbert : Douze dollars !?
Le droguiste : Et pour le cornet de glace douze cents en plus.
Herbert : Ca ferait combien pour une douzaine ?
Le droguiste : Quatre dollars.
Herbert : J'en aurais combien pour un dollar ?
Le droguiste : Trois.
Herbert : J'en prendrai deux.
Le droguiste : Je regrette mais c'est en paquet de trois.
Herbert : Alors est-ce que vous pourriez me faire crédit pour la glace ?
Le droguiste : Ecoutez, mon garçon, on a bien le droit de s'amuser, mais quel âge avez-vous ?
Herbert : Seize ans.
Le droguiste : Quel âge ?
Herbert : A mon prochain anniversaire.
Le droguiste : Qu'est-ce que vous pensez faire avec ça ?
Herbert : Eh benh, c'est pour mon frère, mon frère aîné.
Le droguiste : Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas les acheter lui-même ?
Herbert : Il est malade.
Le droguiste : Eh bien pourquoi en a-t-il besoin ?
Herbert : Pour quand il ira mieux. Il est dans les Rangers.
Le droguiste : Oh. Est-ce que vous savez quel usage on doit en faire ?
Herbert : ... Oh oui, on commence par les remplir d'eau et on les jette du haut d'une fenêtre.
Le droguiste : Très bien, je voulais seulement m'assurer que vous saviez comment on n'en servait.
Herbert : Bien sûr que je l'sais. Mon frère m'aurait jamais envoyé en acheter sans m'expliquer à quoi ça servait.
Le droguiste : Bon, alors ça fera un dollar tout compris, avec le cornet de glace.
Herbert : D'accord. Merci beaucoup.
¤ ¤ ¤
Oscar : On s'est disputés cet après-midi. Alors après, j'ai été chez elle pour lui dire que je regrettais. Elle avait l'appendicite, tu te rends compte !? Il a fallu la transporter d'urgence sur le continent. Oh, mais je regretterais qu'on lui coupe les nichons pour l'opérer !
Herbert : Oh, y'a pas d'raisons pour que l'entaille aille si loin.
Oscar : Elle me dit qu'elle veut plus de moi et après elle se paie une appendicite. Elle peut rien faire sans exagérer.
Lettre de Dorothy : Cher Herbert, il faut que je reparte. Je suis sure que vous comprendrez, j'ai beaucoup de choses à faire. Je ne veux pas essayer d'expliquer ce qui s'est passé hier soir, parce que je suis sure que plus tard, dans votre souvenir, vous en trouverez la vraie raison. Je ne vous oublierai pas. J'espère que toutes les tragédies absurdes vous seront épargnées. Je vous souhaite tout le bien possible, Herbert. Rien que du bien. Toujours. Dorothée.
¤ ¤ ¤
Voix off de Herbert : Je ne devais jamais la revoir. Ni savoir ce qu'elle est devenue. En ce temps-là, les jeunes étaient différents. Nous n'étions pas comme ceux d'aujourd'hui. Il nous fallait plus longtemps pour comprendre ce que nous éprouvions. La vie est faite de changements, petits ou grands. Pour chaque chose qu'on acquiert, on en abandonne une autre. Pendant l'été quarante-deux, nous avons attaqué quatre fois le poste de garde-côte, nous avons vu cinq films et eu neuf jours de pluie. Bernard a cassé sa montre. Oscar a abandonné l'harmonica et d'une manière bien particulière, j'ai perdu Herbert, pour toujours.
> Pour écouter : lettre et voix off de fin.WMA
¤ ¤ ¤
> Et en musique, trois vidéos : http://fichtre.hautetfort.com/archive/2014/06/17/un-ete-42.html
07:42 Publié dans Films historiques, littéraires, N&B, biopics, Les mots des films, Thèse | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : été, 42, 1942, jennifer, o'neill, michel, legrand, herman, raucher































































