jeudi, 31 janvier 2013
La maison du Chat-qui-pelote - Balzac - le texte
Dédié à Mademoiselle Marie de Montheau
Ecrit en octobre 1829.
Paraît pour la première fois dans le tome II des Scènes de la Vie Privée, sous le titre « Gloire et malheur » (2 volumes in-8, Paris, Mame et Delaunay-Vallée, 1830).
En 1842, cette nouvelle entre, avec son titre actuel,
dans le tome I de la Comédie Humaine.

> pdf book : pour une lecture page à page
http://www.inlibroveritas.net/lire/oeuvre2412.html#page_1
> version audio : durée 2h22, voix de femme
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/b...
Au milieu de la rue Saint-Denis, presque au coin de la rue du Petit-Lion, existait naguère une de ces maisons précieuses qui donnent aux historiens la facilité de reconstruire par analogie l’ancien Paris. Les murs menaçants de cette bicoque semblaient avoir été bariolés d’hiéroglyphes. Quel autre nom le flâneur pouvait-il donner au X et aux V que traçaient sur la façade les pièces de bois transversales ou diagonales dessinées dans le badigeon par de petites lézardes parallèles ? Évidemment, au passage de toutes les voitures, chacune de ces solives s’agitait dans sa mortaise. Ce vénérable édifice était surmonté d’un toit triangulaire dont aucun modèle ne se verra bientôt plus à Paris. Cette couverture, tordue par les intempéries du climat parisien, s’avançait de trois pieds sur la rue, autant pour garantir des eaux pluviales le seuil de la porte, que pour abriter le mur d’un grenier et sa lucarne sans appui. Ce dernier étage était construit en planches clouées l’une sur l’autre comme des ardoises, afin sans doute de ne pas charger cette frêle maison.
Par une matinée pluvieuse, au mois de mars, un jeune homme, soigneusement enveloppé dans son manteau, se tenait sous l’auvent de la boutique qui se trouvait en face de ce vieux logis, et paraissait l’examiner avec un enthousiasme d’archéologue. À la vérité, ce débris de la bourgeoisie du seizième siècle pouvait offrir à l’observateur plus d’un problème à résoudre. Chaque étage avait sa singularité. Au premier, quatre fenêtres longues, étroites, rapprochées l’une de l’autre, avaient des carreaux de bois dans leur partie inférieure, afin de produire ce jour douteux, à la faveur duquel un habile marchand prête aux étoffes la couleur souhaitée par ses chalands. Le jeune homme semblait plein de dédain pour cette partie essentielle de la maison, ses yeux ne s’y étaient pas encore arrêtés. Les fenêtres du second étage, dont les jalousies relevées laissaient voir, au travers de grands carreaux en verre de Bohême, de petits rideaux de mousseline rousse, ne l’intéressaient pas davantage. Son attention se portait particulièrement au troisième, sur d’humbles croisées dont le bois travaillé grossièrement aurait mérité d’être placé au Conservatoire des arts et métiers pour y indiquer les premiers efforts de la menuiserie française. Ces croisées avaient de petites vitres d’une couleur si verte, que, sans son excellente vue, le jeune homme n’aurait pu apercevoir les rideaux de toile à carreaux bleus qui cachaient les mystères de cet appartement aux yeux des profanes. Parfois, cet observateur, ennuyé de sa contemplation sans résultat, ou du silence dans lequel la maison était ensevelie, ainsi que tout le quartier, abaissait ses regards vers les régions inférieures. Un sourire involontaire se dessinait alors sur ses lèvres, quand il revoyait la boutique où se rencontraient en effet des choses assez risibles. Une formidable pièce de bois, horizontalement appuyée sur quatre piliers qui paraissaient courbés par le poids de cette maison décrépite, avait été rechampie d’autant de couches de diverses peintures que la joue d’une vieille duchesse en a reçu de rouge. Au milieu de cette large poutre mignardement sculptée se trouvait un antique tableau représentant un chat qui pelotait. Cette toile causait la gaieté du jeune homme. Mais il faut dire que le plus spirituel des peintres modernes n’inventerait pas de charge si comique. L’animal tenait dans une de ses pattes de devant une raquette aussi grande que lui, et se dressait sur ses pattes de derrière pour mirer une énorme balle que lui renvoyait un gentilhomme en habit brodé. Dessin, couleurs, accessoires, tout était traité de manière à faire croire que l’artiste avait voulu se moquer du marchand et des passants. En altérant cette peinture naïve, le temps l’avait rendue encore plus grotesque par quelques incertitudes qui devaient inquiéter de consciencieux flâneurs. Ainsi la queue mouchetée du chat était découpée de telle sorte qu’on pouvait la prendre pour un spectateur, tant la queue des chats de nos ancêtres était grosse, haute et fournie. À droite du tableau, sur un champ d’azur qui déguisait imparfaitement la pourriture du bois, les passants lisaient GUILLAUME ; et à gauche, SUCCESSEUR DU SIEUR CHEVREL. Le soleil et la pluie avaient rongé la plus grande partie de l’or moulu parcimonieusement appliqué sur les lettres de cette inscription, dans laquelle les U remplaçaient les V, et réciproquement, selon les lois de notre ancienne orthographe. Afin de rabattre l’orgueil de ceux qui croient que le monde devient de jour en jour plus spirituel, et que le moderne charlatanisme surpasse tout, il convient de faire observer ici que ces enseignes, dont l’étymologie semble bizarre à plus d’un négociant parisien, sont les tableaux morts de vivants tableaux à l’aide desquels nos espiègles ancêtres avaient réussi à amener les chalands dans leurs maisons. Ainsi la Truie-qui-file, le Singe-vert, etc., furent des animaux en cage dont l’adresse émerveillait les passants, et dont l’éducation prouvait la patience de l’industriel au quinzième siècle. De semblables curiosités enrichissaient plus vite leurs heureux possesseurs que les Providence, les Bonne-foi, les Grâce-de-Dieu et les Décollation de saint Jean-Baptiste qui se voient encore rue Saint-Denis. Cependant l’inconnu ne restait certes pas là pour admirer ce chat, qu’un moment d’attention suffisait à graver dans la mémoire. Ce jeune homme avait aussi ses singularités. Son manteau, plissé dans le goût des draperies antiques, laissait voir une élégante chaussure, d’autant plus remarquable au milieu de la boue parisienne, qu’il portait des bas de soie blancs dont les mouchetures attestaient son impatience. Il sortait sans doute d’une noce ou d’un bal ; car à cette heure matinale il tenait à la main des gants blancs ; et les boucles de ses cheveux noirs défrisés, éparpillées sur ses épaules, indiquaient une coiffure à la Caracalla, mise à la mode autant par l’école de David que par cet engouement pour les formes grecques et romaines qui marqua les premières années de ce siècle. Malgré le bruit que faisaient quelques maraîchers attardés passant au galop pour se rendre à la grande halle, cette rue si agitée avait alors un calme dont la magie n’est connue que de ceux qui ont erré dans Paris désert, à ces heures où son tapage, un moment apaisé, renaît et s’entend dans le lointain comme la grande voix de la mer. Cet étrange jeune homme devait être aussi curieux pourles commerçants du Chat-qui-pelote, que le Chat-qui-pelote l’était pour lui. Une cravate éblouissante de blancheur rendait sa figure tourmentée encore plus pâle qu’elle ne l’était réellement. Le feu tour à tour sombre et pétillant que jetaient ses yeux noirs s’harmoniait avec les contours bizarres de son visage, avec sa bouche large et sinueuse qui se contractait en souriant. Son front, ridé par une contrariété violente, avait quelque chose de fatal. Le front n’est-il pas ce qui se trouve de plus prophétique en l’homme ? Quand celui de l’inconnu exprimait la passion, les plis qui s’y formaient causaient une sorte d’effroi par la vigueur avec laquelle ils se prononçaient ; mais lorsqu’il reprenait son calme, si facile à troubler, il y respirait une grâce lumineuse qui rendait attrayante cette physionomie où la joie, la douleur, l’amour, la colère, le dédain éclataient d’une manière si communicative que l’homme le plus froid en devait être impressionné. Cet inconnu se dépitait si bien au moment où l’on ouvrit précipitamment la lucarne du grenier, qu’il n’y vit pas apparaître trois joyeuses figures rondelettes, blanches, roses, mais aussi communes que le sont les figures du Commerce sculptées sur certains monuments. Ces trois faces, encadrées par la lucarne, rappelaient les têtes d’anges bouffis semés dans les nuages qui accompagnent le Père éternel. Les apprentis respirèrent les émanations de la rue avec une avidité qui démontrait combien l’atmosphère de leur grenier était chaude et méphitique. Après avoir indiqué ce singulier factionnaire, le commis qui paraissait être le plus jovial disparut et revint en tenant à la main un instrument dont le métal inflexible a été récemment remplacé par un cuir souple ; puis tous prirent une expression malicieuse en regardant le badaud qu’ils aspergèrent d’une pluie fine et blanchâtre dont le parfum prouvait que les trois mentons venaient d’être rasés. Élevés sur la pointe de leurs pieds et réfugiés au fond de leur grenier pour jouir de la colère de leur victime, les commis cessèrent de rire en voyant l’insouciant dédain avec lequel le jeune homme secoua son manteau, et le profond mépris que peignit sa figure quand il leva les yeux sur la lucarne vide. En ce moment, une main blanche et délicate fit remonter vers l’imposte la partie inférieure d’une des grossières croisées du troisième étage, au moyen de ces coulisses dont le tourniquet laisse souvent tomber à l’improviste le lourd vitrage qu’il doit retenir. Le passant fut alors récompensé de sa longue attente. La figure d’une jeune fille, fraîche comme un de ces blancs calices qui fleurissent au sein des eaux, se montra couronnée d’une ruche en mousseline froissée qui donnait à sa tête un air d’innocence admirable. Quoique couverts d’une étoffe brune, son cou, ses épaules s’apercevaient, grâce à de légers interstices ménagés par les mouvements du sommeil. Aucune expression de contrainte n’altérait ni l’ingénuité de ce visage, ni le calme de ces yeux immortalisés par avance dans les sublimes compositions de Raphaël : c’était la même grâce, la même tranquillité de ces vierges devenues proverbiales. Il existait un charmant contraste produit par la jeunesse des joues de cette figure, sur laquelle le sommeil avait comme mis en relief une surabondance de vie, et par la vieillesse de cette fenêtre massive aux contours grossiers, dont l’appui était noir. Semblable à ces fleurs de jour qui n’ont pas encore au matin déplié leur tunique roulée par le froid des nuits, la jeune fille, à peine éveillée, laissa errer ses yeux bleus sur les toits voisins et regarda le ciel ; puis, par une sorte d’habitude, elle les baissa sur les sombres régions de la rue, où ils rencontrèrent aussitôt ceux de son adorateur. La coquetterie la fit sans doute souffrir d’être vue en déshabillé, elle se retira vivement en arrière, le tourniquet tout usé tourna, la croisée redescendit avec cette rapidité qui, de nos jours, a valu un nom odieux à cette naïve invention de nos ancêtres, et la vision disparut. Il semblait à ce jeune homme que la plus brillante des étoiles du matin avait été soudain cachée par un nuage.
Pendant ces petits événements, les lourds volets intérieurs qui défendaient le léger vitrage de la boutique du Chat-qui-pelote avaient été enlevés comme par magie. La vieille porte à heurtoir fut repliée sur le mur intérieur de la maison par un serviteur vraisemblablement contemporain de l’enseigne, qui d’une main tremblante y attacha le morceau de drap carré sur lequel était brodé en soie jaune le nom de Guillaume, successeur de Chevrel. Il eût été difficile à plus d’un passant de deviner le genre de commerce de monsieur Guillaume. À travers les gros barreaux de fer qui protégeaient extérieurement sa boutique, à peine y apercevait-on des paquets enveloppés de toile brune aussi nombreux que des harengs quand ils traversent l’Océan. Malgré l’apparente simplicité de cette gothique façade, monsieur Guillaume était, de tous les marchands drapiers de Paris, celui dont les magasins se trouvaient toujours le mieux fournis, dont les relations avaient le plus d’étendue, et dont la probité commerciale était la plus exacte. Si quelques-uns de ses confrères avaient conclu des marchés avec le gouvernement, sans avoir la quantité de drap voulue, il était toujours prêt à la leur livrer, quelque considérable que fût le nombre de pièces soumissionnées. Le rusé négociant connaissait mille manières de s’attribuer le plus fort bénéfice sans se trouver obligé, comme eux, de courir chez des protecteurs, y faire des bassesses ou de riches présents. Si les confrères ne pouvaient le payer qu’en excellentes traites un peu longues, il indiquait son notaire comme un homme accommodant, et savait encore tirer une seconde mouture du sac, grâce à cet expédient qui faisait dire proverbialement aux négociants de la rue Saint-Denis : — Dieu vous garde du notaire de monsieur Guillaume ! pour désigner un escompte onéreux. Le vieux négociant se trouva debout comme par miracle, sur le seuil de sa boutique, au moment où le domestique se retira. Monsieur Guillaume regarda la rue Saint-Denis, les boutiques voisines et le temps, comme un homme qui débarque au Havre et revoit la France après un long voyage. Bien convaincu que rien n’avait changé pendant son sommeil, il aperçut alors le passant en faction, qui, de son côté, contemplait le patriarche de la draperie, comme Humboldt dut examiner le premier gymnote électrique qu’il vit en Amérique. Monsieur Guillaume portait de larges culottes de velours noir, des bas chinés et des souliers carrés à boucles d’argent. Son habit à pans carrés, à basques carrées, à collet carré, enveloppait son corps, légèrement voûté, d’un drap verdâtre garni de grands boutons en métal blanc mais rougis par l’usage. Ses cheveux gris étaient si exactement aplatis et peignés sur son crâne jaune, qu’ils le faisaient ressembler à un champ sillonné. Ses petits yeux verts, percés comme avec une vrille, flamboyaient sous deux arcs marqués d’une faible rougeur à défaut de sourcils. Les inquiétudes avaient tracé sur son front des rides horizontales aussi nombreuses que les plis de son habit. Cette figure blême annonçait la patience, la sagesse commerciale, et l’espèce de cupidité rusée que réclament les affaires. À cette époque on voyait moins rarement qu’aujourd’hui de ces vieilles familles où se conservaient, comme de précieuses traditions, les mœurs, les costumes caractéristiques de leurs professions, et restées au milieu de la civilisation nouvelle comme ces débris antédiluviens retrouvés par Cuvier dans les carrières. Le chef de la famille Guillaume était un de ces notables gardiens des anciens usages : on le surprenait à regretter le Prévôt des Marchands, et jamais il ne parlait d’un jugement du tribunal de commerce sans le nommer la sentence des consuls. C’était sans doute en vertu de ces coutumes que, levé le premier de sa maison, il attendait de pied ferme l’arrivée de ses trois commis, pour les gourmander en cas de retard. Ces jeunes disciples de Mercure ne connaissaient rien de plus redoutable que l’activité silencieuse avec laquelle le patron scrutait leurs visages et leurs mouvements, le lundi matin, en y recherchant les preuves ou les traces de leurs escapades. Mais, en ce moment, le vieux drapier ne fit aucune attention à ses apprentis. Il était occupé à chercher le motif de la sollicitude avec laquelle le jeune homme en bas de soie et en manteau portait alternativement les yeux sur son enseigne et sur les profondeurs de son magasin. Le jour, devenu plus éclatant, permettait d’y apercevoir le bureau grillagé, entouré de rideaux en vieille soie verte, où se tenaient les livres immenses, oracles muets de la maison. Le trop curieux étranger semblait convoiter ce petit local, y prendre le plan d’une salle à manger latérale, éclairée par un vitrage pratiqué dans le plafond, et d’où la famille réunie devait facilement voir, pendant ses repas, les plus légers accidents qui pouvaient arriver sur le seuil de la boutique. Un si grand amour pour son logis paraissait suspect à un négociant qui avait subi le régime de la Terreur. Monsieur Guillaume pensait donc assez naturellement que cette figure sinistre en voulait à la caisse du Chat-qui-pelote. Après avoir discrètement joui du duel muet qui avait lieu entre son patron et l’inconnu, le plus âgé des commis hasarda de se placer sur la dalle où était monsieur Guillaume, en voyant le jeune homme contempler à la dérobée les croisées du troisième. Il fit deux pas dans la rue, leva la tête, et crut avoir aperçu mademoiselle Augustine Guillaume qui se retirait avec précipitation. Mécontent de la perspicacité de son premier commis, le drapier lui lança un regard de travers ; mais tout à coup les craintes mutuelles que la présence de ce passant excitait dans l’âme du marchand et de l’amoureux commis se calmèrent. L’inconnu hêla un fiacre qui se rendait à une place voisine, et y monta rapidement en affectant une trompeuse indifférence. Ce départ mit un certain baume dans le cœur des autres commis, assez inquiets de retrouver la victime de leur plaisanterie.
— Hé bien, messieurs, qu’avez-vous donc à rester là, les bras croisés ? dit monsieur Guillaume à ses trois néophytes. Mais autrefois, sarpejeu ! quand j’étais chez le sieur Chevrel, j’avais déjà visité plus de deux pièces de drap.
— Il faisait donc jour de meilleure heure, dit le second commis que cette tâche concernait.
Le vieux négociant ne put s’empêcher de sourire. Quoique deux de ces trois jeunes gens, confiés à ses soins par leurs pères, riches manufacturiers de Louviers et de Sedan, n’eussent qu’à demander cent mille francs pour les avoir, le jour où ils seraient en âge de s’établir, Guillaume croyait de son devoir de les tenir sous la férule d’un antique despotisme inconnu de nos jours dans les brillants magasins modernes dont les commis veulent être riches à trente ans : il les faisait travailler comme des nègres. À eux trois, ces commis suffisaient à une besogne qui aurait mis sur les dents dix de ces employés dont le sybaritisme enfle aujourd’hui les colonnes du budget. Aucun bruit ne troublait la paix de cette maison solennelle, où les gonds semblaient toujours huilés, et dont le moindre meuble avait cette propreté respectable qui annonce un ordre et une économie sévères. Souvent, le plus espiègle des commis s’était amusé à écrire sur le fromage de Gruyère qu’on leur abandonnait au déjeuner, et qu’ils se plaisaient à respecter, la date de sa réception primitive. Cette malice et quelques autres semblables faisaient parfois sourire la plus jeune des deux filles de Guillaume, la jolie vierge qui venait d’apparaître au passant enchanté. Quoique chacun des apprentis, et même le plus ancien, payât une forte pension, aucun d’eux n’eût été assez hardi pour rester à la table du patron au moment où le dessert y était servi. Lorsque madame Guillaume parlait d’accommoder la salade, ces pauvres jeunes gens tremblaient en songeant avec quelle parcimonie sa prudente main savait y épancher l’huile. Il ne fallait pas qu’ils s’avisassent de passer une nuit dehors, sans avoir donné longtemps à l’avance un motif plausible à cette irrégularité. Chaque dimanche, et à tour de rôle, deux commis accompagnaient la famille Guillaume à la messe de Saint-Leu et aux vêpres. Mesdemoiselles Virginie et Augustine, modestement vêtues d’indienne, prenaient chacune le bras d’un commis et marchaient en avant, sous les yeux perçants de leur mère, qui fermait ce petit cortége domestique avec son mari accoutumé par elle à porter deux gros paroissiens reliés en maroquin noir. Le second commis n’avait pas d’appointements. Quant à celui que douze ans de persévérance et de discrétion initiaient aux secrets de la maison, il recevait huit cents francs en récompense de ses labeurs. À certaines fêtes de famille, il était gratifié de quelques cadeaux auxquels la main sèche et ridée de madame Guillaume donnait seule du prix : des bourses en filet, qu’elle avait soin d’emplir de coton pour faire valoir leurs dessins à jour ; des bretelles fortement conditionnées, ou des paires de bas de soie bien lourdes. Quelquefois, mais rarement, ce premier ministre était admis à partager les plaisirs de la famille soit quand elle allait à la campagne, soit quand après des mois d’attente elle se décidait à user de son droit à demander, en louant une loge, une pièce à laquelle Paris ne pensait plus. Quant aux deux autres commis, la barrière de respect qui séparait jadis un maître drapier de ses apprentis était placée si fortement entre eux et le vieux négociant, qu’il leur eût été plus facile de voler une pièce de drap que de déranger cette auguste étiquette. Cette réserve peut paraître ridicule aujourd’hui. Néanmoins, ces vieilles maisons étaient des écoles de mœurs et de probité. Les maîtres adoptaient leurs apprentis. Le linge d’un jeune homme était soigné, réparé, quelquefois renouvelé par la maîtresse de la maison. Un commis tombait-il malade, il devenait l’objet de soins vraiment maternels. En cas de danger, le patron prodiguait son argent pour appeler les plus célèbres docteurs ; car il ne répondait pas seulement des mœurs et du savoir de ces jeunes gens à leurs parents. Si l’un d’eux, honorable par le caractère, éprouvait quelque désastre, ces vieux négociants savaient apprécier l’intelligence qu’ils avaient développée, et n’hésitaient pas à confier le bonheur de leurs filles à celui auquel ils avaient pendant longtemps confié leurs fortunes. Guillaume était un de ces hommes antiques ; et s’il en avait les ridicules, il en avait toutes les qualités. Aussi Joseph Lebas, son premier commis, orphelin et sans fortune, était-il, dans son idée, le futur époux de Virginie sa fille aînée. Mais Joseph ne partageait point les pensées symétriques de son patron, qui, pour un empire, n’aurait pas marié sa seconde fille avant la première. L’infortuné commis se sentait le cœur entièrement pris pour mademoiselle Augustine la cadette. Afin de justifier cette passion, qui avait grandi secrètement, il est nécessaire de pénétrer plus avant dans les ressorts du gouvernement absolu qui régissait la maison du vieux marchand drapier.
Guillaume avait deux filles. L’aînée, mademoiselle Virginie, était tout le portrait de sa mère. Madame Guillaume, fille du sieur Chevrel, se tenait si droite sur la banquette de son comptoir, que plus d’une fois elle avait entendu des plaisants parier qu’elle y était empalée. Sa figure maigre et longue trahissait une dévotion outrée. Sans grâces et sans manières aimables, madame Guillaume ornait habituellement sa tête presque sexagénaire d’un bonnet dont la forme était invariable et garni de barbes comme celui d’une veuve. Tout le voisinage l’appelait la sœur tourière. Sa parole était brève, et ses gestes avaient quelque chose des mouvements saccadés d’un télégraphe. Son œil, clair comme celui d’un chat, semblait en vouloir à tout le monde de ce qu’elle était laide. Mademoiselle Virginie, élevée comme sa jeune sœur sous les lois despotiques de leur mère, avait atteint l’âge de vingt-huit ans. La jeunesse atténuait l’air disgracieux que sa ressemblance avec sa mère donnait parfois à sa figure ; mais la rigueur maternelle l’avait dotée de deux grandes qualités qui pouvaient tout contre-balancer : elle était douce et patiente. Mademoiselle Augustine, à peine âgée de dix-huit ans, ne ressemblait ni à son père ni à sa mère. Elle était de ces filles qui, par l’absence de tout lien physique avec leurs parents, font croire à ce dicton de prude : Dieu donne les enfants. Augustine était petite, ou, pour la mieux peindre, mignonne. Gracieuse et pleine de candeur, un homme du monde n’aurait pu reprocher à cette charmante créature que des gestes mesquins ou certaines attitudes communes, et parfois de la gêne. Sa figure silencieuse et immobile respirait cette mélancolie passagère qui s’empare de toutes les jeunes filles trop faibles pour oser résister aux volontés d’une mère. Toujours modestement vêtues, les deux sœurs ne pouvaient satisfaire la coquetterie innée chez la femme que par un luxe de propreté qui leur allait à merveille et les mettait en harmonie avec ces comptoirs luisants, avec ces rayons sur lesquels le vieux domestique ne souffrait pas un grain de poussière, avec la simplicité antique de tout ce qui se voyait autour d’elles. Obligées par leur genre de vie à chercher des éléments de bonheur dans des travaux obstinés, Augustine et Virginie n’avait donné jusqu’alors que du contentement à leur mère, qui s’applaudissait secrètement de la perfection du caractère de ses deux filles. Il est facile d’imaginer les résultats de l’éducation qu’elles avaient reçue. Élevées pour le commerce, habituées à n’entendre que des raisonnements et des calculs tristement mercantiles, n’ayant étudié que la grammaire, la tenue des livres, un peu d’histoire juive, l’histoire de France dans Le Ragois, et ne lisant que les auteurs dont la lecture leur était permise par leur mère, leurs idées n’avaient pas pris beaucoup d’étendue : elles savaient parfaitement tenir un ménage, elles connaissaient le prix des choses, elles appréciaient les difficultés que l’on éprouve à amasser l’argent, elles étaient économes et portaient un grand respect aux qualités du négociant. Malgré la fortune de leur père, elles étaient aussi habiles à faire des reprises qu’à festonner ; souvent leur mère parlait de leur apprendre la cuisine afin qu’elles sussent bien ordonner un dîner, et pussent gronder une cuisinière en connaissance de cause. Ignorant les plaisirs du monde et voyant comment s’écoulait la vie exemplaire de leurs parents, elles ne jetaient que bien rarement leurs regards au delà de l’enceinte de cette vieille maison patrimoniale qui, pour leur mère, était l’univers. Les réunions occasionnées par les solennités de famille formaient tout l’avenir de leurs joies terrestres. Quand le grand salon situé au second étage devait recevoir madame Roguin, une demoiselle Chevrel, de quinze ans moins âgée que sa cousine et qui portait des diamants ; le jeune Rabourdin, sous-chef aux Finances ; monsieur César Birotteau, riche parfumeur, et sa femme appelée madame César ; monsieur Camusot, le plus riche négociant en soieries de la rue des Bourdonnais ; deux ou trois vieux banquiers, et des femmes irréprochables ; les apprêts nécessités par la manière dont l’argenterie, les porcelaines de Saxe, les bougies, les cristaux étaient empaquetés faisaient une diversion à la vie monotone de ces trois femmes qui allaient et venaient, en se donnant autant de mouvement que des religieuses pour la réception d’un évêque. Puis quand, le soir, fatiguées toutes trois d’avoir essuyé, frotté, déballé, mis en place les ornements de la fête, les deux jeunes filles aidaient leur mère à se coucher, madame Guillaume leur disait : — Nous n’avons rien fait aujourd’hui, mes enfants ! Lorsque, dans ces assemblées solennelles, la sœur tourière permettait de danser en confinant les parties de boston, de whist et de trictrac dans sa chambre à coucher, cette concession était comptée parmi les félicités les plus inespérées, et causait un bonheur égal à celui d’aller à deux ou trois grands bals où Guillaume menait ses filles à l’époque du carnaval. Enfin, une fois par an, l’honnête drapier donnait une fête pour laquelle rien n’était épargné. Quelque riches et élégantes que fussent les personnes invitées, elles se gardaient bien d’y manquer ; car les maisons les plus considérables de la place avaient recours à l’immense crédit, à la fortune ou à la vieille expérience de monsieur Guillaume. Mais les deux filles de ce digne négociant ne profitaient pas autant qu’on pourrait le supposer des enseignements que le monde offre à de jeunes âmes. Elles apportaient dans ces réunions, inscrites d’ailleurs sur le carnet d’échéances de la maison, des parures dont la mesquinerie les faisait rougir. Leur manière de danser n’avait rien de remarquable, et la surveillance maternelle ne leur permettait pas de soutenir la conversation autrement que par Oui et Non avec leurs cavaliers. Puis la loi de la vieille enseigne du Chat-qui-pelote leur ordonnait d’être rentrées à onze heures, moment où les bals et les fêtes commencent à s’animer. Ainsi leurs plaisirs, en apparence assez conformes à la fortune de leur père, devenaient souvent insipides par des circonstances qui tenaient aux habitudes et aux principes de cette famille. Quant à leur vie habituelle, une seule observation achèvera de la peindre. Madame Guillaume exigeait que ses deux filles fussent habillées de grand matin, qu’elles descendissent tous les jours à la même heure, et soumettait leurs occupations à une régularité monastique. Cependant Augustine avait reçu du hasard une âme assez élevée pour sentir le vide de cette existence. Parfois ses yeux bleus se relevaient comme pour interroger les profondeurs de cet escalier sombre et de ces magasins humides. Après avoir sondé ce silence de cloître, elle semblait écouter de loin de confuses révélations de cette vie passionnée qui met les sentiments à un plus haut prix que les choses. En ces moments son visage se colorait, ses mains inactives laissaient tomber la blanche mousseline sur le chêne poli du comptoir, et bientôt sa mère lui disait d’une voix qui restait toujours aigre même dans les tons les plus doux : — Augustine ! à quoi pensez-vous donc, mon bijou ? Peut-être Hippolyte comte de Douglas et le Comte de Comminges, deux romans trouvés par Augustine dans l’armoire d’une cuisinière récemment renvoyée par madame Guillaume, contribuèrent-ils à développer les idées de cette jeune fille qui les avait furtivement dévorés pendant les longues nuits de l’hiver précédent. Les expressions de désir vague, la voix douce, la peau de jasmin et les yeux bleus d’Augustine avaient donc allumé dans l’âme du pauvre Lebas un amour aussi violent que respectueux. Par un caprice facile à comprendre, Augustine ne se sentait aucun goût pour l’orphelin : peut-être était-ceparce qu’elle ne se savait pas aimée. En revanche, les longues jambes, les cheveux châtains, les grosses mains et l’encolure vigoureuse du premier commis avaient trouvé une secrète admiratrice dans mademoiselle Virginie, qui, malgré ses cinquante mille écus de dot, n’était demandée en mariage par personne. Rien de plus naturel que ces deux passions inverses nées dans le silence de ces comptoirs obscurs comme fleurissent des violettes dans la profondeur d’un bois. La muette et constante contemplation qui réunissait les yeux de ces jeunes gens par un besoin violent de distraction au milieu de travaux obstinés et d’une paix religieuse, devait tôt ou tard exciter des sentiments d’amour. L’habitude de voir une figure y fait découvrir insensiblement les qualités de l’âme, et finit par en effacer les défauts.
— Au train dont y va cet homme, nos filles ne tarderont pas à se mettre à genoux devant un prétendu ! se dit monsieur Guillaume en lisant le premier décret par lequel Napoléon anticipa sur les classes de conscrits.
Dès ce jour, désespéré de voir sa fille aîné se faner, le vieux marchand se souvint d’avoir épousé mademoiselle Chevrel à peu près dans la situation où se trouvaient Joseph Lebas et Virginie. Quelle belle affaire que de marier sa fille et d’acquitter une dette sacrée, en rendant à un orphelin le bienfait qu’il avait reçu jadis de son prédécesseur dans les mêmes circonstances ! Âgé de trente-trois ans, Joseph Lebas pensait aux obstacles que quinze ans de différence mettaient entre Augustine et lui. Trop perspicace d’ailleurs pour ne pas deviner les desseins de monsieur Guillaume, il en connaissait assez les principes inexorables pour savoir que jamais la cadette ne se marierait avant l’aînée. Le pauvre commis, dont le cœur était aussi excellent que ses jambes étaient longues et son buste épais, souffrait donc en silence.
Tel était l’état des choses dans cette petite république, qui, au milieu de la rue Saint-Denis, ressemblait assez à une succursale de la Trappe. Mais pour rendre un compte exact des événements extérieurs comme des sentiments, il est nécessaire de remonter à quelques mois avant la scène par laquelle commence cette histoire. À la nuit tombante, un jeune homme passant devant l’obscure boutique du Chat-qui-pelote y était resté un moment en contemplation à l’aspect d’un tableau qui aurait arrêté tous les peintres du monde. Le magasin, n’étant pas encore éclairé, formait un plannoir au fond duquel se voyait la salle à manger du marchand. Une lampe astrale y répandait ce jour jaune qui donne tant de grâce aux tableaux de l’école hollandaise. Le linge blanc, l’argenterie, les cristaux formaient de brillants accessoires qu’embellissaient encore de vives oppositions entre l’ombre et la lumière. La figure du père de famille et celle de sa femme, les visages des commis et les formes pures d’Augustine, à deux pas de laquelle se tenait une grosse fille joufflue, composaient un groupe si curieux ; ces têtes étaient si originales, et chaque caractère avait une expression si franche ; on devinait si bien la paix, le silence et la modeste vie de cette famille, que, pour un artiste accoutumé à exprimer la nature, il y avait quelque chose de désespérant à vouloir rendre cette scène fortuite. Ce passant était un jeune peintre, qui, sept ans auparavant, avait remporté le grand prix de peinture. Il revenait de Rome. Son âme nourrie de poésie, ses yeux rassasiés de Raphaël et de Michel-Ange, avaient soif de la nature vraie, après une longue habitation du pays pompeux où l’art a jeté partout son grandiose. Faux ou juste, tel était son sentiment personnel. Abandonné longtemps à la fougue des passions italiennes, son cœur demandait une de ces vierges modestes et recueillies que, malheureusement, il n’avait su trouver qu’en peinture à Rome. De l’enthousiasme imprimé à son âme exaltée par le tableau naturel qu’il contemplait, il passa naturellement à une profonde admiration pour la figure principale : Augustine paraissait pensive et ne mangeait point ; par une disposition de la lampe dont la lumière tombait entièrement sur son visage, son buste semblait se mouvoir dans un cercle de feu qui détachait plus vivement les contours de sa tête et l’illuminait d’une manière quasi surnaturelle. L’artiste la compara involontairement à un ange exilé qui se souvient du ciel. Une sensation presque inconnue, un amour limpide et bouillonnant inonda son cœur. Après être demeuré pendant un moment comme écrasé sous le poids de ses idées, il s’arracha à son bonheur, rentra chez lui, ne mangea pas, ne dormit point. Le lendemain, il entra dans son atelier pour n’en sortir qu’après avoir déposé sur une toile la magie de cette scène dont le souvenir l’avait en quelque sorte fanatisé. Sa félicité fut incomplète tant qu’il ne posséda pas un fidèle portrait de son idole. Il passa plusieurs fois devant la maison du Chat-qui-pelote ; il osa même y entrer une ou deux fois sous le masque d’un déguisement, afin de voir de plus près la ravissante créature que madame Guillaume couvrait de son aile. Pendant huit mois entiers, adonné à son amour, à ses pinceaux, il resta invisible pour ses amis les plus intimes, oubliant le monde, la poésie, le théâtre, la musique, et ses plus chères habitudes. Un matin, Girodet força toutes ces consignes que les artistes connaissent et savent éluder, parvint à lui et le réveilla par cette demande : — Que mettras-tu au Salon ? L’artiste saisit la main de son ami, l’entraîne à son atelier, découvre un petit tableau de chevalet et un portrait. Après une lente et avide contemplation des deux chefs-d’œuvre, Girodet saute au cou de son camarade et l’embrasse, sans trouver de paroles. Ses émotions ne pouvaient se rendre que comme il les sentait, d’âme à âme.
— Tu es amoureux ? dit Girodet.
Tous deux savaient que les plus beaux portraits de Titien, de Raphaël et de Léonard de Vinci sont dus à des sentiments exaltés, qui, sous diverses conditions, engendrent d’ailleurs tous les chefs-d’œuvre. Pour toute réponse, le jeune artiste inclina la tête.
— Es-tu heureux de pouvoir être amoureux ici, en revenant d’Italie ! Je ne te conseille pas de mettre de telles œuvres au Salon, ajouta le grand peintre. Vois-tu, ces deux tableaux n’y seraient pas sentis. Ces couleurs vraies, ce travail prodigieux ne peuvent pas encore être appréciés, le public n’est plus accoutumé à tant de profondeur. Les tableaux que nous peignons, mon bon ami, sont des écrans, des paravents. Tiens, faisons plutôt des vers, et traduisons les Anciens ! il y a plus de gloire à en attendre, que de nos malheureuses toiles.
Malgré cet avis charitable, les deux toiles furent exposées. La scène d’intérieur fit une révolution dans la peinture. Elle donna naissance à ces tableaux de genre dont la prodigieuse quantité importée à toutes nos expositions, pourrait faire croire qu’ils s’obtiennent par des procédés purement mécaniques. Quant au portrait, il est peu d’artistes qui ne gardent le souvenir de cette toile vivante à laquelle le public, quelquefois juste en masse, laissa la couronne que Girodet y plaça lui-même. Les deux tableaux furent entourés d’une foule immense. On s’y tua, comme disent les femmes. Des spéculateurs, des grands seigneurs couvrirent ces deux toiles de doubles napoléons, l’artiste refusa obstinément de les vendre, et refusa d’en faire des copies. On lui offrit une somme énorme pour les laisser graver, les marchands ne furent pas plus heureux quene l’avaient été les amateurs. Quoique cette aventure fît du bruit dans le monde, elle n’était pas de nature à parvenir au fond de la petite Thébaïde de la rue Saint-Denis. Néanmoins, en venant faire une visite à madame Guillaume, la femme du notaire parla de l’exposition devant Augustine, qu’elle aimait beaucoup, et lui en expliqua le but. Le babil de madame Roguin inspira naturellement à Augustine le désir de voir les tableaux, et la hardiesse de demander secrètement à sa cousine de l’accompagner au Louvre. La cousine réussit dans la négociation qu’elle entama auprès de madame Guillaume, pour obtenir la permission d’arracher sa petite cousine à ses tristes travaux pendant environ deux heures. La jeune fille pénétra donc, à travers la foule, jusqu’au tableau couronné. Un frisson la fit trembler comme une feuille de bouleau, quand elle se reconnut. Elle eut peur et regarda autour d’elle pour rejoindre madame Roguin, de qui elle avait été séparée par un flot de monde. En ce moment ses yeux effrayés rencontrèrent la figure enflammée du jeune peintre. Elle se rappela tout à coup la physionomie d’un promeneur que, curieuse, elle avait souvent remarqué, en croyant que c’était un nouveau voisin.
— Vous voyez ce que l’amour m’a fait faire, dit l’artiste à l’oreille de la timide créature qui resta tout épouvantée de ces paroles.
Elle trouva un courage surnaturel pour fendre la presse, et pour rejoindre sa cousine encore occupée à percer la masse du monde qui l’empêchait d’arriver jusqu’au tableau.
— Vous seriez étouffée, s’écria Augustine, partons !
Mais il se rencontre, au Salon, certains moments pendant lesquels deux femmes ne sont pas toujours libres de diriger leurs pas dans les galeries. Mademoiselle Guillaume et sa cousine furent poussées à quelques pas du second tableau, par suite des mouvements irréguliers que la foule leur imprima. Le hasard voulut qu’elles eussent la facilité d’approcher ensemble de la toile illustrée par la mode, d’accord cette fois avec le talent. La femme du notaire fit une exclamation de surprise perdue dans le brouhaha et les bourdonnements de la foule ; mais Augustine pleura involontairement à l’aspect de cette merveilleuse scène. Puis, par un sentiment presque inexplicable, elle mit un doigt sur ses lèvres en apercevant à deux pas d’elle la figure extatique du jeune artiste. L’inconnu répondit par un signe de tête et désigna madame Roguin, comme un trouble-fête, afin de montrer à Augustine qu’elle était comprise. Cette pantomime jeta comme un brasier dans le corps de la pauvre fille qui se trouva criminelle, en se figurant qu’il venait de se conclure un pacte entre elle et l’artiste. Une chaleur étouffante, le continuel aspect des plus brillantes toilettes, et l’étourdissement que produisait sur Augustine la vérité des couleurs, la multitude des figures vivantes ou peintes, la profusion des cadres d’or, lui firent éprouver une espèce d’enivrement qui redoubla ses craintes. Elle se serait peut-être évanouie, si, malgré ce chaos de sensations, il ne s’était élevé au fond de son cœur une jouissance inconnue qui vivifia tout son être. Néanmoins, elle se crut sous l’empire de ce démon dont les terribles pièges lui étaient prédits par la voix tonnante des prédicateurs. Ce moment fut pour elle comme un moment de folie. Elle se vit accompagnée jusqu’à la voiture de sa cousine par ce jeune homme resplendissant de bonheur et d’amour. En proie à une irritation toute nouvelle, à une ivresse qui la livrait en quelque sorte à la nature, Augustine écouta la voix éloquente de son cœur, et regarda plusieurs fois le jeune peintre en laissant paraître le trouble dont elle était saisie. Jamais l’incarnat de ses joues n’avait formé de plus vigoureux contrastes avec la blancheur de sa peau. L’artiste aperçut alors cette beauté dans toute sa fleur, cette pudeur dans toute sa gloire. Augustine éprouva une sorte de joie mêlée de terreur, en pensant que sa présence causait la félicité de celui dont le nom était sur toutes les lèvres, dont le talent donnait l’immortalité à de passagères images. Elle était aimée ! il lui était impossible d’en douter. Quand elle ne vit plus l’artiste, elle entendit encore retentir dans son cœur ces paroles simples : — « Vous voyez ce que l’amour m’a fait faire. » Et les palpitations devenues plus profondes lui semblèrent une douleur, tant son sang plus ardent réveilla dans son corps de puissances inconnues. Elle feignit d’avoir un grand mal de tête pour éviter de répondre aux questions de sa cousine relativement aux tableaux ; mais, au retour, madame Roguin ne put s’empêcher de parler à madame Guillaume de la célébrité obtenue par le Chat-qui-pelote, et Augustine trembla de tous ses membres en entendant dire à sa mère qu’elle irait au Salon pour y voir sa maison. La jeune fille insista de nouveau sur sa souffrance, et obtint la permission d’aller se coucher.
— Voilà ce qu’on gagne à tous ces spectacles, s’écria monsieur Guillaume, des maux de tête. Est-ce donc bien amusant de voir en peinture ce qu’on rencontre tous les jours dans notre rue ! Ne me parlez pas de ces artistes qui sont, comme vos auteurs, des meurt-de-faim. Que diable ont-ils besoin de prendre ma maison pour la vilipender dans leurs tableaux ?
— Cela pourra nous faire vendre quelques aunes de drap de plus, dit Joseph Lebas.
Cette observation n’empêcha pas que les arts et la pensée ne fussent condamnés encore une fois au tribunal du Négoce. Comme on doit bien le penser, ces discours ne donnèrent pas grand espoir à Augustine. Elle eut toute la nuit pour se livrer à la première méditation de l’amour. Les événements de cette journée furent comme un songe qu’elle se plut à reproduire dans sa pensée Elle s’initia aux craintes, aux espérances, aux remords, à toutes ces ondulations de sentiment qui devaient bercer un cœur simple et timide comme le sien. Quel vide elle reconnut dans cette noire maison, et quel trésor elle trouva dans son âme ! Être la femme d’un homme de talent, partager sa gloire ! Quels ravages cette idée ne devait-elle pas faire au cœur d’une enfant élevée au sein de cette famille ! Quelle espérance ne devait-elle pas éveiller chez une jeune personne qui, nourrie jusqu’alors de principes vulgaires, avait désiré une vie élégante ! Un rayon de soleil était tombé dans cette prison. Augustine aima tout à coup. En elle tant de sentiments étaient flattés à la fois, qu’elle succomba sans rien calculer. À dix-huit ans, l’amour ne jette-t-il pas son prisme entre le monde et les yeux d’une jeune fille ! Incapable de deviner les rudes chocs qui résultent de l’alliance d’une femme aimante avec un homme d’imagination, elle crut être appelée à faire le bonheur de celui-ci, sans apercevoir aucune disparate entre elle et lui. Pour elle le présent fut tout l’avenir. Quand le lendemain son père et sa mère revinrent du Salon, leurs figures attristées annoncèrent quelque désappointement. D’abord, les deux tableaux avaient été retirés par le peintre ; puis, madame Guillaume avait perdu son châle de cachemire. Apprendre que les tableaux venaient de disparaître après sa visite au Salon fut pour Augustine la révélation d’une délicatesse de sentiment que les femmes savent toujours apprécier, même instinctivement.
Le matin où, rentrant d’un bal, Théodore de Sommervieux, tel était le nom que la renommée avait apporté dans le cœur d’Augustine, fut aspergé par les commis du Chat-qui-pelote pendant qu’il attendait l’apparition de sa naïve amie, qui ne le savait certes pas là, les deux amants se voyaient pour la quatrième fois seulement depuis la scène du Salon. Les obstacles que le régime de la maison Guillaume opposait au caractère fougueux de l’artiste, donnaient à sa passion pour Augustine une violence facile à concevoir. Comment aborder une jeune fille assise dans un comptoir entre deux femmes telles que mademoiselle Virginie et madame Guillaume ? Comment correspondre avec elle, quand sa mère ne la quittait jamais ? Habile, comme tous les amants, à se forger des malheurs, Théodore se créait un rival dans l’un des commis, et mettait les autres dans les intérêts de son rival. S’il échappait à tant d’Argus, il se voyait échouant sous les yeux sévères du vieux négociant ou de madame Guillaume. Partout des barrières, partout le désespoir ! La violence même de sa passion empêchait le jeune peintre de trouver ces expédients ingénieux qui, chez les prisonniers comme chez les amants, semblent être le dernier effort de la raison échauffée par un sauvage besoin de liberté ou par le feu de l’amour. Théodore tournait alors dans le quartier avec l’activité d’un fou, comme si le mouvement pouvait lui suggérer des ruses. Après s’être bien tourmenté l’imagination, il inventa de gagner à prix d’or la servante joufflue. Quelques lettres furent donc échangées de loin en loin pendant la quinzaine qui suivit la malencontreuse matinée où monsieur Guillaume et Théodore s’étaient si bien examinés.
En ce moment, les deux jeunes gens étaient convenus de se voir à une certaine heure du jour et le dimanche, à Saint-Leu, pendant la messe et les vêpres. Augustine avait envoyé à son cher Théodore la liste des parents et des amis de la famille, chez lesquels le jeune peintre tâcha d’avoir accès afin d’intéresser à ses amoureuses pensées, s’il était possible, une de ces âmes occupées d’argent, de commerce, et auxquelles une passion véritable devait sembler la spéculation la plus monstrueuse, une spéculation inouïe. D’ailleurs, rien ne changea dans les habitudes du Chat-qui-pelote. Si Augustine fut distraite, si, contre toute espèce d’obéissance aux lois de la charte domestique, elle monta à sa chambre pour y aller, grâce à un pot de fleurs, établir des signaux ; si elle soupira, si elle pensa enfin, personne, pas même sa mère, ne s’en aperçut. Cette circonstance causera quelque surprise à ceux qui auront compris l’esprit de cette maison, où une pensée entachée de poésie devait produire un contraste avec les êtres et les choses, où personne ne pouvait se permettre ni un geste, ni un regard qui ne fussent vus et analysés. Cependant rien de plus naturel : le vaisseau si tranquille qui naviguait sur la mer orageuse de la place de Paris, sous le pavillon du Chat-qui-pelote, était la proie d’une de ces tempêtes qu’on pourrait nommer équinoxiales à cause de leur retour périodique. Depuis quinze jours, les quatre hommes de l’équipage, madame Guillaume et mademoiselle Virginie s’adonnaient à ce travail excessif désigné sous le nom d’inventaire. On remuait tous les ballots et l’on vérifiait l’aunage des pièces pour s’assurer de la valeur exacte du coupon. On examinait soigneusement la carte appendue au paquet pour reconnaître en quel temps les draps avaient été achetés. On fixait le prix actuel. Toujours debout, son aune à la main, la plume derrière l’oreille, monsieur Guillaume ressemblait à un capitaine commandant la manœuvre. Sa voix aiguë, passant par un judas pour interroger la profondeur des écoutilles du magasin d’en bas, faisait entendre ces barbares locutions du commerce, qui ne s’exprime que par énigmes : — Combien d’H-N-Z ? — Enlevé. — Que reste-t-il de Q-X ? — Deux aunes. — Quel prix ? — Cinq-cinq-trois. — Portez à trois A tout J-J, tout M-P, et le reste de V-D-O. Mille autres phrases tout aussi intelligibles ronflaient à travers les comptoirs comme des vers de la poésie moderne que des romantiques se seraient cités afin d’entretenir leur enthousiasme pour un de leurs poëtes. Le soir, Guillaume, enfermé avec son commis et sa femme, soldait les comptes, portait à nouveau, écrivait aux retardataires, et dressait des factures. Tous trois préparaient ce travail immense dont le résultat tenait sur un carré de papier tellière, et prouvait à la maison Guillaume qu’il existait tant en argent, tant en marchandises, tant en traites et billets ; qu’elle ne devait pas un sou, qu’il lui était dû cent ou deux cent mille francs ; que le capital avait augmenté ; que les fermes, les maisons, les rentes allaient être ou arrondies, ou réparées, ou doublées. De là résultait la nécessité de recommencer avec plus d’ardeur que jamais à ramasser de nouveaux écus, sans qu’il vînt en tête à ces courageuses fourmis de se demander : À quoi bon ?
À la faveur de ce tumulte annuel, l’heureuse Augustine échappait à l’investigation de ses Argus. Enfin, un samedi soir, la clôturede l’inventaire eut lieu. Les chiffres du total actif offrirent assez de zéros pour qu’en cette circonstance Guillaume levât la consigne sévère qui régnait toute l’année au dessert. Le sournois drapier se frotta les mains, et permit à ses commis de rester à sa table. À peine chacun des hommes de l’équipage achevait-il son petit verre d’une liqueur de ménage, on entendit le roulement d’une voiture. La famille alla voir Cendrillon aux Variétés, tandis que les deux derniers commis reçurent chacun un écu de six francs et la permission d’aller où bon leur semblerait, pourvu qu’ils fussent rentrés à minuit. Malgré cette débauche, le dimanche matin, le vieux marchand drapier fit sa barbe dès six heures, endossa son habit marron dont les superbes reflets lui causaient toujours le même contentement, il attacha les boucles d’or aux oreilles de son ample culotte de soie ; puis, vers sept heures, au moment où tout dormait encore dans la maison, il se dirigea vers le petit cabinet attenant à son magasin du premier étage. Le jour y venait d’une croisée armée de gros barreaux de fer, et qui donnait sur une petite cour carrée formée de murs si noirs qu’elle ressemblait assez à un puits. Le vieux négociant ouvrit lui-même ces volets garnis de tôle qu’il connaissait si bien, et releva une moitié du vitrage en le faisant glisser dans sa coulisse. L’air glacé de la cour vint rafraîchir la chaude atmosphère de ce cabinet, qui exhalait l’odeur particulière aux bureaux. Le marchand resta debout, la main posée sur le bras crasseux d’un fauteuil de canne doublé de maroquin dont la couleur primitive était effacée, il semblait hésiter à s’y asseoir. Il regarda d’un air attendri le bureau à double pupitre, où la place de sa femme se trouvait ménagée, dans le côté opposé à la sienne, par une petite arcade pratiquée dans le mur. Il contempla les cartons numérotés, les ficelles, les ustensiles, les fers à marquer le drap, la caisse, objets d’une origine immémoriale, et crut se revoir devant l’ombre évoquée du sieur Chevrel. Il avança le même tabouret sur lequel il s’était jadis assis en présence de son défunt patron. Ce tabouret garni de cuir noir, et dont le crin s’échappait depuis longtemps par les coins, mais sans se perdre, il le plaça d’une main tremblante au même endroit où son prédécesseur l’avait mis ; puis, dans une agitation difficile à décrire, il tira la sonnette qui correspondait au chevet du lit de Joseph Lebas. Quand ce coup décisif eut été frappé, le vieillard, pour qui ces souvenirs furent sans doute trop lourds, prit trois ou quatre lettres de change qui lui avaient été présentées, et les regarda sans les voir, quand Joseph Lebas se montra soudain.
— Asseyez-vous là, lui dit Guillaume en lui désignant le tabouret.
Comme jamais le vieux maître-drapier n’avait fait asseoir son commis devant lui, Joseph Lebas tressaillit.
— Que pensez-vous de ces traites ? demanda Guillaume.
— Elles ne seront pas payées.
— Comment ?
— Mais j’ai su qu’avant-hier Étienne et compagnie ont fait leurs paiements en or.
— Oh ! oh ! s’écria le drapier, il faut être bien malade pour laisser voir sa bile. Parlons d’autre chose. Joseph, l’inventaire est fini.
— Oui, monsieur, et le dividende est un des plus beaux que vous ayez eus.
— Ne vous servez donc pas de ces nouveaux mots ! Dites le produit, Joseph. Savez-vous, mon garçon, que c’est un peu à vous que nous devons ces résultats ? aussi, ne veux-je plus que vous ayez d’appointements. Madame Guillaume m’a donné l’idée de vous offrir un intérêt. Hein, Joseph ! Guillaume et Lebas, ces mots ne feraient-ils pas une belle raison sociale ? On pourrait mettre et compagnie pour arrondir la signature.
Les larmes vinrent aux yeux de Joseph Lebas, qui s’efforça de les cacher. — Ah, monsieur Guillaume ! comment ai-je pu mériter tant de bontés ? Je n’ai fait que mon devoir. C’était déjà tant que de vous intéresser à un pauvre orph…
Il brossait le parement de sa manche gauche avec la manche droite, et n’osait regarder le vieillard qui souriait en pensant que ce modeste jeune homme avait sans doute besoin, comme lui autrefois, d’être encouragé pour rendre l’explication complète.
— Cependant, reprit le père de Virginie, vous ne méritez pas beaucoup cette faveur, Joseph ! Vous ne mettez pas en moi autant de confiance que j’en mets en vous. (Le commis releva brusquement la tête.) — Vous avez le secret de la caisse. Depuis deux ans je vous ai dit presque toutes mes affaires. Je vous ai fait voyager en fabrique. Enfin, pour vous, je n’ai rien sur le cœur. Mais vous ?… vous avez une inclination, et ne m’en avez pas touché un seul mot. (Joseph Lebas rougit.) — Ah ! ah ! s’écria Guillaume, vous pensiez donc tromper un vieux renard comme moi ? Moi ! à qui vous avez vu deviner la faillite Lecoq !
— Comment, monsieur ? répondit Joseph Lebas en examinant son patron avec autant d’attention que son patron l’examinait, comment, vous sauriez qui j’aime ?
— Je sais tout, vaurien, lui dit le respectable et rusé marchand en lui tordant le bout de l’oreille. Et je pardonne, j’ai fait de même.
— Et vous me l’accorderiez ?
— Oui, avec cinquante mille écus, et je t’en laisserai autant, et nous marcherons sur nouveaux frais avec une nouvelle raison sociale. Nous brasserons encore des affaires, garçon, s’écria le vieux marchand en s’exaltant, se levant et agitant ses bras. Vois-tu, mon gendre, il n’y a que le commerce ! Ceux qui se demandent quels plaisirs on y trouve sont des imbéciles. Être à la piste des affaires, savoir gouverner sur la place, attendre avec anxiété, comme au jeu, si les Étienne et compagnie font faillite, voir passer un régiment de la garde impériale habillé de notre drap, donner un croc en jambe au voisin, loyalement s’entend ! fabriquer à meilleur marché que les autres ; suivre une affaire qu’on ébauche, qui commence, grandit, chancelle et réussit, connaître comme un ministre de la police tous les ressorts des maisons de commerce pour ne pas faire fausse route ; se tenir debout devant les naufrages ; avoir des amis, par correspondance, dans toutes les villes manufacturières, n’est-ce pas un jeu perpétuel, Joseph ? Mais c’est vivre, ça ! Je mourrai dans ce tracas-là, comme le vieux Chevrel, n’en prenant cependant plus qu’à mon aise. Dans la chaleur de sa plus forte improvisation, le père Guillaume n’avait presque pas regardé son commis qui pleurait à chaudes larmes. — Eh bien ! Joseph, mon pauvre garçon, qu’as-tu donc ?
— Ah ! je l’aime tant, tant, monsieur Guillaume, que le cœur me manque, je crois…
— Eh bien ! garçon, dit le marchand attendri, tu es plus heureux que tu ne crois, sarpejeu, car elle t’aime. Je le sais, moi !
Et il cligna ses deux petits yeux verts en regardant son commis.
— Mademoiselle Augustine, mademoiselle Augustine ! s’écria Joseph Lebas dans son enthousiasme.
Il allait s’élancer hors du cabinet, quand il se sentit arrêté par un bras de fer, et son patron stupéfait le ramena vigoureusement devant lui.
— Qu’est-ce que fait donc Augustine dans cette affaire-là ? demanda Guillaume dont la voix glaça sur-le-champ le malheureux Joseph Lebas.
— N’est-ce pas elle… que… j’aime ? dit le commis en balbutiant.
Déconcerté de son défaut de perspicacité, Guillaume se rassit et mit sa tête pointue dans ses deux mains pour réfléchir à la bizarre position dans laquelle il se trouvait. Joseph Lebas honteux et au désespoir resta debout.
— Joseph, reprit le négociant avec une dignité froide, je vous parlais de Virginie. L’amour ne se commande pas, je le sais. Je connais votre discrétion, nous oublierons cela. Je ne marierai jamais Augustine avant Virginie. Votre intérêt sera de dix pour cent.
Le commis, auquel l’amour donna je ne sais quel degré de courage et d’éloquence, joignit les mains, prit la parole, parla pendant un quart d’heure à Guillaume avec tant de chaleur et de sensibilité, que la situation changea. S’il s’était agi d’une affaire commerciale, le vieux négociant aurait eu des règles fixes pour prendre une résolution ; mais, jeté à mille lieues du commerce, sur la mer des sentiments, et sans boussole, il flotta irrésolu devant un événement si original, se disait-il. Entraîné par sa bonté naturelle, il battit un peu la campagne.
— Et, diantre, Joseph, tu n’es pas sans savoir que j’ai eu mes deux enfants à dix ans de distance ! Mademoiselle Chevrel n’était pas belle, elle n’a cependant pas à se plaindre de moi. Fais donc comme moi. Enfin, ne pleure pas, es-tu bête ? Que veux-tu ? cela s’arrangera peut-être, nous verrons. Il y a toujours moyen de se tirer d’affaire. Nous autres hommes nous ne sommes pas toujours comme des Céladons pour nos femmes. Tu m’entends ? Madame Guillaume est dévote, et… Allons, sarpejeu, mon enfant, donne ce matin le bras à Augustine pour aller à la messe.
Telles furent les phrases jetées à l’aventure par Guillaume. La conclusion qui les terminait ravit l’amoureux commis : il songeait déjà pour mademoiselle Virginie à l’un de ses amis, quand il sortit du cabinet enfumé en serrant la main de son futur beau-père, après lui avoir dit, d’un petit air entendu, que tout s’arrangerait au mieux.
— Que va penser madame Guillaume ? Cette idée tourmenta prodigieusement le brave négociant quand il fut seul.
Au déjeuner, madame Guillaume et Virginie, auxquelles le marchand-drapier avait laissé provisoirement ignorer son désappointement, regardèrent assez malicieusement Joseph Lebas qui resta grandement embarrassé. La pudeur du commis lui concilia l’amitié de sa belle-mère. La matrone redevint si gaie qu’elle regarda monsieur Guillaume en souriant, et se permit quelques petites plaisanteries d’un usage immémorial dans ces innocentes familles. Elle mit en question la conformité de la taille de Virginie et de celle de Joseph, pour leur demander de se mesurer. Ces niaiseries préparatoires attirèrent quelques nuages sur le front du chef de famille, et il afficha même un tel amour pour le décorum, qu’il ordonna à Augustine de prendre le bras du premier commis en allant à Saint-Leu. Madame Guillaume, étonnée de cette délicatesse masculine, honora son mari d’un signe de tête d’approbation. Le cortège partit donc de la maison dans un ordre qui ne pouvait suggérer aucune interprétation malicieuse aux voisins.
— Ne trouvez-vous pas, mademoiselle Augustine, disait le commis en tremblant, que la femme d’un négociant qui a un bon crédit, comme monsieur Guillaume, par exemple, pourrait s’amuser un peu plus que ne s’amuse madame votre mère, pourrait porter des diamants, aller en voiture ? Oh ! moi, d’abord, si je me mariais, je voudrais avoir toute la peine, et voir ma femme heureuse. Je ne la mettrais pas dans mon comptoir. Voyez-vous, dans la draperie, les femmes n’y sont plus aussi nécessaires qu’elles l’étaient autrefois. Monsieur Guillaume a eu raison d’agir comme il a fait, et d’ailleurs c’était le goût de son épouse. Mais qu’une femme sache donner un coup de main à la comptabilité, à la correspondance, au détail, aux commandes, à son ménage, afin de ne pas rester oisive, c’est tout. À sept heures, quand la boutique serait fermée, moi je m’amuserais, j’irais au spectacle et dans le monde. Mais vous ne m’écoutez pas.
— Si fait, monsieur Joseph. Que dites-vous de la peinture ? C’est là un bel état.
— Oui, je connais un maître peintre en bâtiment, monsieur Lourdois, qui a des écus.
En devisant ainsi, la famille atteignit l’église de Saint-Leu. Là, madame Guillaume retrouva ses droits, et fit mettre, pour la première fois, Augustine à côté d’elle. Virginie prit place sur la quatrième chaise à côté de Lebas. Pendant le prône, tout alla bien entre Augustine et Théodore qui, debout derrière un pilier, priait sa madone avec ferveur ; mais au lever-Dieu, madame Guillaume s’aperçut, un peu tard, que sa fille Augustine tenait son livre de messe au rebours. Elle se disposait à la gourmander vigoureusement, quand, rabaissant son voile, elle interrompit sa lecture et se mit à regarder dans la direction qu’affectionnaient les yeux de sa fille. À l’aide de ses bésicles, elle vit le jeune artiste dont l’élégance mondaine annonçait plutôt quelque capitaine de cavalerie en congé, qu’un négociant du quartier. Il est difficile d’imaginer l’état violent dans lequel se trouva madame Guillaume, qui se flattait d’avoir parfaitement élevé ses filles, en reconnaissant dans le cœur d’Augustine un amour clandestin dont le danger lui fut exagéré par sa pruderie et par son ignorance. Elle crut sa fille gangrenée jusqu’au cœur.
— Tenez d’abord votre livre à l’endroit, mademoiselle, dit-elle à voix basse mais en tremblant de colère. Elle arracha vivement le Paroissien accusateur, et le remit de manière à ce que les lettres fussent dans leur sens naturel. — N’ayez pas le malheur de lever les yeux autre part que sur vos prières, ajouta-t-elle, autrement, vous auriez affaire à moi. Après la messe, votre père et moi nous aurons à vous parler.
Ces paroles furent comme un coup de foudre pour la pauvre Augustine. Elle se sentit défaillir ; mais combattue entre la douleur qu’elle éprouvait et la crainte de faire un esclandre dans l’église, elle eut le courage de cacher ses angoisses. Cependant, il était facile de deviner l’état violent de son âme en voyant son Paroissien trembler et des larmes tomber sur chacune des pages qu’elle tournait. Au regard enflammé que lui lança madame Guillaume, l’artiste vit le péril où tombaient ses amours, et sortit, la rage dans le cœur, décidé à tout oser.
— Allez dans votre chambre, mademoiselle ! dit madame Guillaume à sa fille en rentrant au logis ; nous vous ferons appeler ; et surtout, ne vous avisez pas d’en sortir.
La conférence que les deux époux eurent ensemble fut si secrète, que rien n’en transpira d’abord. Cependant, Virginie, qui avait encouragé sa sœur par mille douces représentations, poussa la complaisance jusqu’à se glisser auprès de la porte de la chambre à coucher de sa mère, chez laquelle la discussion avait lieu, pour y recueillir quelques phrases. Au premier voyage qu’elle fit du troisième au second étage, elle entendit son père qui s’écriait : — Madame, vous voulez donc tuer votre fille ?
— Ma pauvre enfant, dit Virginie à sa sœur éplorée, papa prend ta défense !
— Et que veulent-ils faire à Théodore ? demanda l’innocente créature.
La curieuse Virginie redescendit alors ; mais cette fois elle resta plus longtemps : elle apprit que Lebas aimait Augustine. Il était écrit que, dans cette mémorable journée, une maison ordinairement si calme serait un enfer. Monsieur Guillaume désespéra Joseph Lebas en lui confiant l’amour d’Augustine pour un étranger. Lebas, qui avait averti son ami de demander mademoiselle Virginie en mariage, vit ses espérances renversées. Mademoiselle Virginie, accablée de savoir que Joseph l’avait en quelque sorte refusée, fut prise d’une migraine. La zizanie semée entre les deux époux par l’explication que monsieur et madame Guillaume avaient eue ensemble, et où, pour la troisième fois de leur vie, ils se trouvèrent d’opinions différentes, se manifesta d’une manière terrible. Enfin, à quatre heures après midi, Augustine, pâle, tremblante et les yeux rouges, comparut devant son père et sa mère. La pauvre enfant raconta naïvement la trop courte histoire de ses amours. Rassurée par l’allocution de son père, qui lui avait promis de l’écouter en silence, elle prit un certain courage en prononçant devant ses parents le nom de son cher Théodore de Sommervieux, et en fit malicieusement sonner la particule aristocratique. En se livrant au charme inconnu de parler de ses sentiments, elle trouva assez de hardiesse pour déclarer avec une innocente fermeté qu’elle aimait monsieur de Sommervieux, qu’elle le lui avait écrit, et ajouta, les larmes aux yeux : — Ce serait faire mon malheur que de me sacrifier à un autre.
— Mais, Augustine, vous ne savez donc pas ce que c’est qu’un peintre ? s’écria sa mère avec horreur.
— Madame Guillaume ! dit le vieux père en imposant silence à sa femme. — Augustine, dit-il, les artistes sont en général des meurt-de-faim. Ils sont trop dépensiers pour ne pas être toujours de mauvais sujets. J’ai fourni feu M. Joseph Vernet, feu M. Lekain et feu M. Noverre. Ah ! si tu savais combien ce M. Noverre, M. le chevalier de Saint-Georges, et surtout M. Philidor, ont joué de tours à ce pauvre père Chevrel ! Ce sont de drôles de corps, je le sais bien. Ça vous a tous un babil, des manières… Ah ! jamais ton monsieur Sumer… Somm…
— De Sommervieux, mon père !
— Eh bien ! de Sommervieux, soit ! jamais il n’aura été aussi agréable avec toi que M. le chevalier de Saint-Georges le fut avec moi, le jour où j’obtins une sentence des consuls contre lui. Aussi était-ce des gens de qualité d’autrefois.
— Mais, mon père, monsieur Théodore est noble, et m’a écrit qu’il était riche. Son père s’appelait le chevalier de Sommervieux avant la révolution.
À ces paroles, monsieur Guillaume regarda sa terrible moitié, qui, en femme contrariée frappait le plancher du bout du pied et gardait un morne silence. Elle évitait même de jeter ses yeux courroucés sur Augustine, et semblait laisser à monsieur Guillaume toute la responsabilité d’une affaire si grave, puisque ses avis n’étaient pas écoutés. Cependant, malgré son flegme apparent, quand elle vit son mari prenant si doucement son parti sur une catastrophe qui n’avait rien de commercial, elle s’écria : — En vérité, monsieur, vous êtes d’une faiblesse avec vos filles… mais…
Le bruit d’une voiture qui s’arrêtait à la porte interrompit tout à coup la mercuriale que le vieux négociant redoutait déjà. En un moment, madame Roguin se trouva au milieu de la chambre, et, regardant les trois acteurs de cette scène domestique : — Je sais tout, ma cousine, dit-elle d’un air de protection.
Madame Roguin avait un défaut, celui de croire que la femme d’un notaire de Paris pouvait jouer le rôle d’une petite maîtresse.
— Je sais tout, répéta-t-elle, et je viens dans l’arche de Noé, comme la colombe, avec la branche d’olivier. J’ai lu cette allégorie dans le Génie du Christianisme, dit-elle en se retournant vers madame Guillaume, la comparaison doit vous plaire, ma cousine. Savez-vous, ajouta-t-elle en souriant à Augustine, que ce monsieur de Sommervieux est un homme charmant ? Il m’a donné ce matin mon portrait fait de main de maître. Cela vaut au moins six mille francs.
À ces mots, elle frappa doucement sur les bras de monsieur Guillaume. Le vieux négociant ne put s’empêcher de faire avec ses lèvres une grosse moue qui lui était particulière.
— Je connais beaucoup monsieur de Sommervieux, reprit la colombe. Depuis une quinzaine de jours il vient à mes soirées, il en fait le charme. Il m’a conté toutes ses peines et m’a prise pour avocat. Je sais de ce matin qu’il adore Augustine, et il l’aura. Ah !cousine, n’agitez pas ainsi la tête en signe de refus. Apprenez qu’il sera créé baron, et qu’il vient d’être nommé chevalier de la Légion-d’Honneur par l’empereur lui-même, au Salon. Roguin est devenu son notaire et connaît ses affaires. Eh bien ! monsieur de Sommervieux possède en bons biens au soleil douze mille livres de rente. Savez-vous que le beau-père d’un homme comme lui peut devenir quelque chose, maire de son arrondissement, par exemple ! N’avez-vous pas vu monsieur Dupont être fait comte de l’empire et sénateur pour être venu, en sa qualité de maire, complimenter l’empereur sur son entrée à Vienne. Oh ! ce mariage-là se fera. Je l’adore, moi, ce bon jeune homme. Sa conduite envers Augustine ne se voit que dans les romans. Va, ma petite, tu seras heureuse, et tout le monde voudrait être à ta place. J’ai chez moi, à mes soirées, madame la duchesse de Carigliano qui raffole de monsieur de Sommervieux. Quelques méchantes langues disent qu’elle ne vient chez moi que pour lui, comme si une duchesse d’hier était déplacée chez une Chevrel dont la famille a cent ans de bonne bourgeoisie.
— Augustine, reprit madame Roguin après une petite pause, j’ai vu le portrait. Dieu ! qu’il est beau ! Sais-tu que l’empereur a voulu le voir ? Il a dit en riant au Vice-Connétable que s’il y avait beaucoup de femmes comme celle-là à sa cour pendant qu’il y venait tant de rois, il se faisait fort de maintenir toujours la paix en Europe. Est-ce flatteur ?
Les orages par lesquels cette journée avait commencé devaient ressembler à ceux de la nature, en ramenant un temps calme et serein. Madame Roguin déploya tant de séductions dans ses discours, elle sut attaquer tant de cordes à la fois dans les cœurs secs de monsieur et de madame Guillaume, qu’elle finit par en trouver une dont elle tira parti. À cette singulière époque, le commerce et la finance avaient plus que jamais la folle manie de s’allier aux grands seigneurs, et les généraux de l’empire profitèrent assez bien de ces dispositions. Monsieur Guillaume s’élevait singulièrement contre cette déplorable passion. Ses axiomes favoris étaient que, pour trouver le bonheur, une femme devait épouser un homme de sa classe ; on était toujours tôt ou tard puni d’avoir voulu monter trop haut ; l’amour résistait si peu aux tracas du ménage, qu’il fallait trouver l’un chez l’autre des qualités bien solides pour être heureux ; il ne fallait pas que l’un des deux époux ensût plus que l’autre, parce qu’on devait avant tout se comprendre ; un mari qui parlait grec et la femme latin, risquaient de mourir de faim. Il avait inventé cette espèce de proverbe. Il comparait les mariages ainsi faits à ces anciennes étoffes de soie et de laine, dont la soie finissait toujours par couper la laine. Cependant, il se trouve tant de vanité au fond du cœur de l’homme, que la prudence du pilote qui gouvernait si bien le Chat-qui-pelote succomba sous l’agressive volubilité de madame Roguin. La sévère madame Guillaume, la première, trouva dans l’inclination de sa fille des motifs pour déroger à ces principes, et pour consentir à recevoir au logis monsieur de Sommervieux, qu’elle se promit de soumettre à un rigoureux examen.
Le vieux négociant alla trouver Joseph Lebas, et l’instruisit de l’état des choses. À six heures et demie, la salle à manger, illustrée par le peintre, réunit sous son toit de verre madame et monsieur Roguin, le jeune peintre et sa charmante Augustine, Joseph Lebas qui prenait son bonheur en patience, et mademoiselle Virginie dont la migraine avait cessé. Monsieur et Madame Guillaume virent en perspective leurs enfants établis et les destinées du Chat-qui-pelote remises en des mains habiles. Leur contentement fut au comble, quand, au dessert, Théodore leur fit présent de l’étonnant tableau qu’ils n’avaient pu voir, et qui représentait l’intérieur de cette vieille boutique, à laquelle était dû tant de bonheur.
— C’est-y gentil ! s’écria Guillaume. Dire qu’on voulait donner trente mille francs de cela.
— Mais c’est qu’on y trouve mes barbes, reprit madame Guillaume.
— Et ces étoffes dépliées, ajouta Lebas, on les prendrait avec la main.
— Les draperies font toujours très-bien, répondit le peintre. Nous serions trop heureux, nous autres artistes modernes, d’atteindre à la perfection de la draperie antique.
— Vous aimez donc la draperie, s’écria le père Guillaume. Eh bien, sarpejeu ! touchez là, mon jeune ami. Puisque vous estimez le commerce, nous nous entendrons. Eh ! pourquoi le mépriserait-on ? Le monde a commencé par là, puisque Adam a vendu le paradis pour une pomme. Ça n’a pas été une fameuse spéculation, par exemple !
Et le vieux négociant se mit à éclater d’un gros rire franc excité par le vin de Champagne qu’il faisait circuler généreusement. Le bandeau qui couvrait les yeux du jeune artiste fut si épais qu’il trouva ses futurs parents aimables. Il ne dédaigna pas de les égayer par quelques charges de bon goût. Aussi plut-il généralement. Le soir, quand le salon meublé de choses très-cossues, pour se servir de l’expression de Guillaume, fut désert : pendant que madame Guillaume s’en allait de table en cheminée, de candélabre en flambeau, soufflant avec précipitation les bougies, le brave négociant, qui savait toujours voir clair aussitôt qu’il s’agissait d’affaires ou d’argent, attira sa fille Augustine auprès de lui ; puis, après l’avoir prise sur ses genoux, il lui tint ce discours :
— Ma chère enfant, tu épouseras ton Sommervieux, puisque tu le veux ; permis à toi de risquer ton capital de bonheur. Mais je ne me laisse pas prendre à ces trente mille francs que l’on gagne à gâter de bonnes toiles. L’argent qui vient si vite s’en va de même. N’ai-je pas entendu dire ce soir à ce jeune écervelé que si l’argent était rond, c’était pour rouler ! S’il est rond pour les gens prodigues, il est plat pour les gens économes qui l’empilent et l’amassent. Or, mon enfant, ce beau garçon-là parle de te donner des voitures, des diamants ? Il a de l’argent, qu’il le dépense pour toi ! bene sit ! Je n’ai rien à y voir. Mais quant à ce que je te donne, je ne veux pas que des écus si péniblement ensachés s’en aillent en carrosses ou en colifichets. Qui dépense trop n’est jamais riche. Avec les cent mille écus de sa dot on n’achète pas encore tout Paris. Tu as beau avoir à recueillir un jour quelques centaines de mille francs, je te les ferai attendre, sarpejeu ! le plus longtemps possible. J’ai donc attiré ton prétendu dans un coin, et un homme qui a mené la faillite Lecoq n’a pas eu grande peine à faire consentir un artiste à se marier séparé de biens avec sa femme. J’aurai l’œil au contrat pour bien faire stipuler les donations qu’il se propose de te constituer. Allons, mon enfant, j’espère être grand-père, sarpejeu ! je veux m’occuper déjà de mes petits-enfants : jure-moi donc ici de ne jamais rien signer en fait d’argent que par mon conseil ; et si j’allais trouver trop tôt le père Chevrel, jure-moi de consulter le jeune Lebas, ton beau-frère. Promets-le-moi.
— Oui, mon père, je vous le jure.
À ces mots prononcés d’une voix douce, le vieillard baisa sa fille sur les deux joues. Ce soir-là, tous les amants dormirent presque aussi paisiblement que monsieur et madame Guillaume.
Quelques mois après ce mémorable dimanche, le maître-autel de Saint-Leu fut témoin de deux mariages bien différents. Augustine et Théodore s’y présentèrent dans tout l’éclat du bonheur, les yeux pleins d’amour, parés de toilettes élégantes, attendus par un brillant équipage. Venue dans un bon remise avec sa famille, Virginie, donnant le bras à son père, suivait sa jeune sœur humblement et dans de plus simples atours, comme une ombre nécessaire aux harmonies de ce tableau. Monsieur Guillaume s’était donné toutes les peines imaginables pour obtenir à l’église que Virginie fût mariée avant Augustine ; mais il eut la douleur de voir le haut et le bas clergé s’adresser en toute circonstance à la plus élégante des mariées. Il entendit quelques-uns de ses voisins approuver singulièrement le bon sens de mademoiselle Virginie, qui faisait, disaient-ils, le mariage le plus solide, et restait fidèle au quartier ; tandis qu’ils lancèrent quelques brocards suggérés par l’envie sur Augustine qui épousait un artiste, un noble ; ils ajoutèrent avec une sorte d’effroi que, si les Guillaume avaient de l’ambition, la draperie était perdue. Un vieux marchand d’éventails ayant dit que ce mange-tout-là l’aurait bientôt mise sur la paille, le père Guillaume s’applaudit in petto de la prudence qu’il avait mise dans la rédaction des conventions matrimoniales. Le soir, la famille se sépara après un bal somptueux, suivi d’un de ces soupers plantureux dont le souvenir commence à se perdre dans la génération présente. Monsieur et madame Guillaume restèrent dans leur hôtel de la rue du Colombier où la noce avait eu lieu. Monsieur et madame Lebas retournèrent dans leur remise à la vieille maison de la rue Saint-Denis, pour y diriger la nauf du Chat-qui-pelote. L’artiste, ivre de bonheur, prit entre ses bras sa chère Augustine, l’enleva vivement quand leur coupé arriva rue des Trois-Frères, et la porta dans son élégant appartement.
La fougue de passion qui possédait Théodore fit dévorer au jeune ménage près d’une année entière sans que le moindre nuage vînt altérer l’azur du ciel sous lequel ils vivaient. Pour eux, l’existence n’eut rien de pesant. Théodore répandait sur chaque journée d’incroyables fioriture de plaisirs. Il se plaisait à varier les emportements de la passion, par la molle langueur de ces repos où les âmes sont lancées si haut dans l’extase qu’elles semblent y oublier l’union corporelle. Incapable de réfléchir, l’heureuse Augustine se prêtait à l’allure onduleuse de son bonheur. Elle ne croyait pas faire encore assez en se livrant toute à l’amour permis et saint du mariage. Simple et naïve, elle ne connaissait ni la coquetterie des refus, ni l’empire qu’une jeune demoiselle du grand monde se crée sur un mari par d’adroits caprices. Elle aimait trop pour calculer l’avenir, et n’imaginait pas qu’une vie si délicieuse pût jamais cesser. Heureuse d’être alors tous les plaisirs de son mari, elle crut que cet inextinguible amour serait toujours pour elle la plus belle de toutes les parures, comme son dévouement et son obéissance seraient un éternel attrait. Enfin, la félicité de l’amour l’avait rendue si brillante, que sa beauté lui inspira de l’orgueil et lui donna la conscience de pouvoir toujours régner sur un homme aussi facile à enflammer que monsieur de Sommervieux. Ainsi son état de femme ne lui apporta d’autres enseignements que ceux de l’amour. Au sein de ce bonheur, elle resta l’ignorante petite fille qui vivait obscurément rue Saint-Denis, et ne pensa point à prendre les manières, l’instruction, le ton du monde dans lequel elle devait vivre. Ses paroles étant des paroles d’amour, elle y déployait bien une sorte de souplesse d’esprit et une certaine délicatesse d’expression ; mais elle se servait du langage commun à toutes les femmes quand elles se trouvent plongées dans une passion qui semble être leur élément. Si, par hasard, une idée discordante avec celles de Théodore était exprimée par Augustine, le jeune artiste en riait comme on rit des premières fautes que fait un étranger, mais qui finissent par fatiguer s’il ne se corrige pas.
Cependant, à l’expiration de cette année aussi charmante que rapide, Sommervieux sentit un matin la nécessité de reprendre ses travaux et ses habitudes. Sa femme était enceinte. Il revit ses amis. Pendant les longues souffrances de l’année où, pour la première fois, une jeune femme nourrit un enfant, il travailla sans doute avec ardeur ; mais parfois il retourna chercher quelques distractions dans le grand monde. La maison où il allait le plus volontiers était celle de la duchesse de Carigliano qui avait fini par attirer chez elle le célèbre artiste. Quand Augustine fut rétablie, quand son fils ne réclama plus ces soins assidus qui interdisent à une mère les plaisirs du monde, Théodore en était arrivé à vouloir éprouver cette jouissance d’amour-propre que nous donne la société quand nous y apparaissons avec une belle femme, objet d’envie et d’admiration. Parcourir les salons en s’y montrant avec l’éclat emprunté de la gloire de son mari, se voir jalousée par toutes les femmes, fut pour Augustine une nouvelle moisson de plaisirs ; mais ce fut le dernier reflet que devait jeter son bonheur conjugal. Elle commença par offenser la vanité de son mari, quand, malgré de vains efforts, elle laissa percer son ignorance, l’impropriété de son langage et l’étroitesse de ses idées. Le caractère de Sommervieux, dompté pendant près de deux ans et demi par les premiers emportements de l’amour, reprit, avec la tranquillité d’une possession moins jeune, sa pente et ses habitudes un moment détournées de leur cours. La poésie, la peinture et les exquises jouissances de l’imagination possèdent sur les esprits élevés des droits imprescriptibles. Ces besoins d’une âme forte n’avaient pas été trompés chez Théodore pendant ces deux années, ils avaient trouvé seulement une pâture nouvelle. Quand les champs de l’amour furent parcourus, quand l’artiste eut, comme les enfants, cueilli des roses et des bluets avec une telle avidité qu’il ne s’apercevait pas que ses mains ne pouvaient plus les tenir, la scène changea. Si le peintre montrait à sa femme les croquis de ses plus belles compositions, il l’entendait s’écrier comme eût fait le père Guillaume : — C’est bien joli ! son admiration sans chaleur ne provenait pas d’un sentiment consciencieux, mais de la croyance sur parole de l’amour. Augustine préférait un regard au plus beau tableau. Le seul sublime qu’elle connût était celui du cœur. Enfin, Théodore ne put se refuser à l’évidence d’une vérité cruelle : sa femme n’était pas sensible à la poésie, elle n’habitait pas sa sphère, elle ne le suivait pas dans tous ses caprices, dans ses improvisations, dans ses joies, dans ses douleurs ; elle marchait terre à terre dans le monde réel, tandis qu’il avait la tête dans les cieux. Les esprits ordinaires ne peuvent pas apprécier les souffrances renaissantes de l’être qui, uni à un autre par le plus intime de tous les sentiments, est obligé de refouler sans cesse les plus chères expansions de sa pensée, et de faire rentrer dans le néant les images qu’une puissance magique le force à créer. Pour lui, ce supplice est d’autant plus cruel, que le sentiment qu’il porte à son compagnon ordonne, par sa première loi, de ne jamais rien se dérober l’un à l’autre, et de confondre les effusions de la pensée aussi bien que les épanchements de l’âme. On ne trompe pas impunément les volontés de la nature : elle est inexorable comme la Nécessité, qui, certes, est une sorte de nature sociale. Sommervieux se réfugia dans le calme et le silence de son atelier, en espérant que l’habitude de vivre avec des artistes pourrait former sa femme, et développerait en elle les germes de haute intelligence engourdis que quelques esprits supérieurs croient préexistants chez tous les êtres ; mais Augustine était trop sincèrement religieuse pour ne pas être effrayée du ton des artistes. Au premier dîner que donna Théodore, elle entendit un jeune peintre disant avec cette enfantine légèreté qu’elle ne sut pas reconnaître et qui absout une plaisanterie de toute irréligion : — Mais, madame, votre paradis n’est pas plus beau que la Transfiguration de Raphaël ? Eh ! bien, je me suis lassé de la regarder. Augustine apporta donc dans cette société spirituelle un esprit de défiance qui n’échappait à personne. Elle gêna. Les artistes gênés sont impitoyables : ils fuient ou se moquent. Madame Guillaume avait, entre autres ridicules, celui d’outrer la dignité qui lui semblait l’apanage d’une femme mariée ; et quoiqu’elle s’en fût souvent moquée, Augustine ne sut pas se défendre d’une légère imitation de la pruderie maternelle. Cette exagération de pudeur, que n’évitent pas toujours les femmes vertueuses, suggéra quelques épigrammes à coups de crayon dont l’innocent badinage était de trop bon goût pour que Sommervieux pût s’en fâcher. Ces plaisanteries eussent été même plus cruelles, elles n’étaient après tout que des représailles exercées sur lui par ses amis. Mais rien ne pouvait être léger pour une âme qui recevait aussi facilement que celle de Théodore des impressions étrangères. Aussi éprouva-t-il insensiblement une froideur qui ne pouvait aller qu’en croissant. Pour arriver au bonheur conjugal, il faut gravir une montagne dont l’étroit plateau est bien près d’un revers aussi rapide que glissant, et l’amour du peintre le descendait. Il jugea sa femme incapable d’apprécier les considérations morales qui justifiaient, à ses propres yeux, la singularité de ses manières envers elle, et se crut fort innocent en lui cachant des pensées qu’elle ne comprenait pas et des écarts peu justifiables au tribunal d’une conscience bourgeoise. Augustine se renferma dans une douleur morne et silencieuse. Ces sentiments secrets mirent entre les deux époux un voile qui devait s’épaissir de jour en jour. Sans que son mari manquât d’égards envers elle, Augustine ne pouvait s’empêcher de trembler en le voyant réserver pour le monde les trésors d’esprit et de grâce qu’il venait jadis mettre à ses pieds. Bientôt, elle interpréta fatalement les discours spirituels qui se tiennent dans le monde sur l’inconstance des hommes. Elle ne se plaignit pas, mais son attitude équivalait à des reproches. Trois ans après son mariage, cette femme jeune et jolie qui passait si brillante dans son brillant équipage, qui vivait dans une sphère de gloire et de richesse enviée de tant de gens insouciants et incapables d’apprécier justement les situations de la vie, fut en proie à de violents chagrins. Ses couleurs pâlirent. Elle réfléchit, elle compara ; puis, le malheur lui déroula les premiers textes de l’expérience. Elle résolut de rester courageusement dans le cercle de ses devoirs, en espérant que cette conduite généreuse lui ferait recouvrer tôt ou tard l’amour de son mari ; mais il n’en fut pas ainsi. Quand Sommervieux, fatigué de travail, sortait de son atelier, Augustine ne cachait pas si promptement son ouvrage, que le peintre ne pût apercevoir sa femme raccommodant avec toute la minutie d’une bonne ménagère le linge de la maison et le sien. Elle fournissait, avec générosité, sans murmure, l’argent nécessaire aux prodigalités de son mari ; mais, dans le désir de conserver la fortune de son cher Théodore, elle se montrait économe soit pour elle, soit dans certains détails de l’administration domestique. Cette conduite est incompatible avec le laisser-aller des artistes qui, sur la fin de leur carrière, ont tant joui de la vie, qu’ils ne se demandent jamais la raison de leur ruine. Il est inutile de marquer chacune des dégradations de couleur par lesquelles la teinte brillante de leur lune de miel atteignit à une profonde obscurité. Un soir, la triste Augustine, qui depuis longtemps entendait son mari parler avec enthousiasme de madame la duchesse de Carigliano, reçut d’une amie quelques avis méchamment charitables sur la nature de l’attachement qu’avait conçu Sommervieux pour cette célèbre coquette qui donnait le ton à la cour impériale. À vingt et un ans, dans tout l’éclat de la jeunesse et de la beauté, Augustine se vit trahie pour une femme de trente-six ans. En se sentant malheureuse au milieu du monde et de ses fêtes désertes pour elle, la pauvre petite ne comprit plus rien à l’admiration qu’elle y excitait, ni à l’envie qu’elle inspirait. Sa figure prit une nouvelle expression. La mélancolie versa dans ses traits la douceur de la résignation et la pâleur d’un amour dédaigné. Elle ne tarda pas à être courtisée par les hommes les plus séduisants ; mais elle resta solitaire et vertueuse. Quelques paroles de dédain, échappées à son mari, lui donnèrent un incroyable désespoir. Une lueur fatale lui fit entrevoir les défauts de contact qui, par suite des mesquineries de son éducation, empêchaient l’union complète de son âme avec celle de Théodore : elle eut assez d’amour pour l’absoudre et pour se condamner. Elle pleura des larmes de sang, et reconnut trop tard qu’il est des mésalliances d’esprits aussi bien que des mésalliances de mœurs et de rang. En songeant aux délices printanières de son union, elle comprit l’étendue du bonheur passé, et convint en elle-même qu’une si riche moisson d’amour était une vie entière qui ne pouvait se payer que par du malheur. Cependant elle aimait trop sincèrement pour perdre toute espérance. Aussi osa-t-elle entreprendre à vingt et un ans de s’instruire et de rendre son imagination au moins digne de celle qu’elle admirait.
— Si je ne suis pas poëte, se disait-elle, au moins je comprendrai la poésie.
Et déployant alors cette force de volonté, cette énergie que les femmes possèdent toutes quand elles aiment, madame de Sommervieux tenta de changer son caractère, ses mœurs et ses habitudes ; mais en dévorant des volumes, en apprenant avec courage, elle ne réussit qu’à devenir moins ignorante. La légèreté de l’esprit et les grâces de la conversation sont un don de la nature ou le fruit d’une éducation commencée au berceau. Elle pouvait apprécier la musique, en jouir, mais non chanter avec goût. Elle comprit la littérature et les beautés de la poésie, mais il était trop tard pour en orner sa rebelle mémoire. Elle entendait avec plaisir les entretiens du monde, mais elle n’y fournissait rien de brillant. Ses idées religieuses et ses préjugés d’enfance s’opposèrent à la complète émancipation de son intelligence. Enfin, il s’était glissé contre elle, dans l’âme de Théodore, une prévention qu’elle ne put vaincre. L’artiste se moquait de ceux qui lui vantaient sa femme, et ses plaisanteries étaient assez fondées : il imposait tellement à cette jeune et touchante créature, qu’en sa présence, ou en tête-à-tête, elle tremblait. Embarrassée par son trop grand désir de plaire, elle sentait son esprit et ses connaissances s’évanouir dans un seul sentiment. La fidélité d’Augustine déplut même à cet infidèle mari, qui semblait l’engager à commettre des fautes en taxant sa vertu d’insensibilité. Augustine s’efforça en vain d’abdiquer sa raison, de se plier aux caprices, aux fantaisies de son mari, et de se vouer à l’égoïsme de sa vanité ; elle ne recueillit point le fruit de ses sacrifices. Peut-être avaient-ils tous deux laissé passer le moment où les âmes peuvent se comprendre. Un jour le cœur trop sensible de la jeune épouse reçut un de ces coups qui font si fortement plier les liens du sentiment, qu’on peut les croire rompus. Elle s’isola. Mais bientôt une fatale pensée lui suggéra d’aller chercher des consolations et des conseils au sein de sa famille.
Un matin donc, elle se dirigea vers la grotesque façade de l’humble et silencieuse maison où s’était écoulée son enfance. Elle soupira en revoyant cette croisée d’où, un jour, elle avait envoyé un premier baiser à celui qui répandait aujourd’hui sur sa vie autant de gloire que de malheur. Rien n’était changé dans l’antre où se rajeunissait cependant le commerce de la draperie. La sœur d’Augustine occupait au comptoir antique la place de sa mère. La jeune affligée rencontra son beau-frère la plume derrière l’oreille. Elle fut à peine écoutée, tant il avait l’air affairé. Les redoutables signaux d’un inventaire général se faisaient autour de lui. Aussi la quitta-t-il en la priant d’excuser. Elle fut reçue assez froidement par sa sœur, qui lui manifesta quelque rancune. En effet, Augustine, brillante et descendant d’un joli équipage, n’était jamais venue voir sa sœur qu’en passant. La femme du prudent Lebas s’imagina que l’argent était la cause première de cette visite matinale, elle essaya de se maintenir sur un ton de réserve qui fit sourire plus d’une fois Augustine. La femme du peintre vit que, sauf les barbes au bonnet, sa mère avait trouvé dans Virginie un successeur qui conservait l’antique honneur du Chat-qui-pelote. Au déjeuner, elle aperçut, dans le régime de la maison, certains changements qui faisaient honneur au bon sens de Joseph Lebas : les commis ne se levèrent pas au dessert, on leur laissait la faculté de parler, et l’abondance de la table annonçait une aisance sans luxe. La jeune élégante trouva les coupons d’une loge aux Français où elle se souvint d’avoir vu sa sœur de loin en loin. Madame Lebas avait sur les épaules un cachemire dont la magnificence attestait la générosité avec laquelle son mari s’occupait d’elle. Enfin, les deux époux marchaient avec leur siècle. Augustine fut bientôt pénétrée d’attendrissement, en reconnaissant, pendant les deux tiers de cette journée, le bonheur égal, sans exaltation, il est vrai, mais aussi sans orages, que goûtait ce couple convenablement assorti. Ils avaient accepté la vie comme une entreprise commerciale où il s’agissait de faire, avant tout, honneur à ses affaires. La femme, n’ayant pas rencontré dans son mari un amour excessif, s’était appliquée à le faire naître. Insensiblement amené à estimer, à chérir Virginie, le temps que le bonheur mit à éclore, fut, pour Joseph Lebas, et pour sa femme, un gage de durée. Aussi, lorsque la plaintive Augustine exposa sa situation douloureuse, eut-elle à essuyer le déluge de lieux communs que la morale de la rue Saint-Denis fournissait à sa sœur.
— Le mal est fait, ma femme, dit Joseph Lebas, il faut chercher à donner de bons conseils à notre sœur. Puis, l’habile négociant analysa lourdement les ressources que les lois et les mœurs pouvaient offrir à Augustine pour sortir de cette crise ; il en numérota pour ainsi dire les considérations, les rangea par leur force dans des espèces de catégories, comme s’il se fût agi de marchandises de diverses qualités ; puis il les mit en balance, les pesa, et conclut en développant la nécessité où était sa belle-sœur de prendre un parti violent qui ne satisfit point l’amour qu’elle ressentait encore pour son mari. Aussi ce sentiment se réveilla-t-il dans toute sa force quand elle entendit Joseph Lebas parlant de voies judiciaires. Elle remercia ses deux amis, et revint chez elle encore plus indécise qu’elle ne l’était avant de les avoir consultés. Elle hasarda de se rendre alors à l’antique hôtel de la rue du Colombier, dans le dessein de confier ses malheurs à son père et à sa mère. La pauvre petite femme ressemblait à ces malades qui, arrivés à un état désespéré, essayent de toutes les recettes et se confient même aux remèdes de bonne femme. Les deux vieillards la reçurent avec une effusion de sentiment qui l’attendrit. Cette visite leur apportait une distraction qui, pour eux, valait un trésor. Depuis quatre ans, ils marchaient dans la vie comme des navigateurs sans but et sans boussole. Assis au coin de leur feu, ils se racontaient l’un à l’autre tous les désastres du Maximum, leurs anciennes acquisitions de draps, la manière dont ils avaient évité les banqueroutes, et surtout cette célèbre faillite Lecocq, la bataille de Marengo du père Guillaume. Puis, quand ils avaient épuisé les vieux procès, ils récapitulaient les additions de leurs inventaires les plus productifs, et se narraient encore les vieilles histoires du quartier Saint-Denis. À deux heures, le père Guillaume allait donner un coup d’œil à l’établissement du Chat-qui-pelote. En revenant il s’arrêtait à toutes les boutiques, autrefois ses rivales, et dont les jeunes propriétaires espéraient entraîner le vieux négociant dans quelque escompte aventureux, que, selon sa coutume, il ne refusait jamais positivement. Deux bons chevaux normands mouraient de gras-fondu dans l’écurie de l’hôtel ; madame Guillaume ne s’en servait que pour se faire traîner tous les dimanches à la grand’messe de sa paroisse. Trois fois par semaine ce respectable couple tenait table ouverte. Grâce à l’influence de son gendre Sommervieux, le père Guillaume avait été nommé membre du comité consultatif pour l’habillement des troupes. Depuis que son mari s’était ainsi trouvé placé haut dans l’administration, madame Guillaume avait pris la détermination de représenter. Leurs appartements étaient encombrés de tant d’ornements d’or et d’argent, et de meubles sans goût mais de valeur certaine, que la pièce la plus simple y ressemblait à une chapelle. L’économie et la prodigalité semblaient se disputer dans chacun des accessoires de cet hôtel. L’on eût dit que monsieur Guillaume avait eu en vue de faire un placement d’argent jusque dans l’acquisition d’un flambeau. Au milieu de ce bazar, dont la richesse accusait le désœuvrement des deux époux, le célèbre tableau de Sommervieux avait obtenu la place d’honneur. Il faisait la consolation de monsieur et de madame Guillaume qui tournaient vingt fois par jour leurs yeux harnachés de bésicles vers cette image de leur ancienne existence, pour eux si active et si amusante. L’aspect de cet hôtel et de ces appartements où tout avait une senteur de vieillesse et de médiocrité, le spectacle donné par ces deux êtres qui semblaient échoués sur un rocher d’or loin du monde et des idées qui font vivre, surprirent Augustine. Elle contemplait en ce moment la seconde partie du tableau dont le commencement l’avait frappée chez Joseph Lebas, celui d’une vie agitée quoique sans mouvement, espèce d’existence mécanique et instinctive semblable à celle des castors. Elle eut alors je ne sais quel orgueil de ses chagrins, en pensant qu’ils prenaient leur source dans un bonheur de dix-huit mois qui valait à ses yeux mille existences comme celle dont le vide lui semblait horrible. Cependant elle cacha ce sentiment peu charitable, et déploya pour ses vieux parents, les grâces nouvelles de son esprit, les coquetteries de tendresse que l’amour lui avait révélées, et les disposa favorablement à écouter ses doléances matrimoniales. Les vieilles gens ont un faible pour ces sortes de confidences. Madame Guillaume voulut être instruite des plus légers détails de cette vie étrange qui, pour elle, avait quelque chose de fabuleux. Les voyages du baron de La Houtan, qu’elle commençait toujours sans jamais les achever, ne lui apprirent rien de plus inouï sur les sauvages du Canada.
— Comment, mon enfant, ton mari s’enferme avec des femmes nues, et tu as la simplicité de croire qu’il les dessine ?
À cette exclamation, la grand’mère posa ses lunettes sur une petite travailleuse, secoua ses jupons et plaça ses mains jointes sur ses genoux élevés par une chaufferette, son piédestal favori.
— Mais, ma mère, tous les peintres sont obligés d’avoir des modèles.
— Il s’est bien gardé de nous dire tout cela quand il t’a demandée en mariage. Si je l’avais su, je n’aurais pas donné ma fille à un homme qui fait un pareil métier. La religion défend ces horreurs-là, ça n’est pas moral. À quelle heure nous disais-tu donc qu’il rentre chez lui ?
— Mais à une heure, deux heures…
Les deux époux se regardèrent dans un profond étonnement.
— Il joue donc ? dit monsieur Guillaume. Il n’y avait que les joueurs qui, de mon temps, rentrassent si tard.
Augustine fit une petite moue qui repoussait cette accusation.
— Il doit te faire passer de cruelles nuits à l’attendre, reprit madame Guillaume. Mais, non, tu te couches, n’est-ce pas ? Et quand il a perdu, le monstre te réveille.
— Non, ma mère, il est au contraire quelquefois très-gai. Assez souvent même, quand il fait beau, il me propose de me lever pour aller dans les bois.
— Dans les bois, à ces heures-là ? Tu as donc un bien petit appartement qu’il n’a pas assez de sa chambre, de ses salons, et qu’il lui faille ainsi courir pour… Mais c’est pour t’enrhumer, que le scélérat te propose ces parties-là. Il veut se débarrasser de toi. A-t-on jamais vu un homme établi, qui a un commerce tranquille, galoper comme un loup-garou ?
— Mais, ma mère, vous ne comprenez donc pas que, pour développer son talent, il a besoin d’exaltation. Il aime beaucoup les scènes qui…
— Ah ! je lui en ferais de belles, des scènes, moi, s’écria madame Guillaume en interrompant sa fille. Comment peux-tu garder des ménagements avec un homme pareil ? D’abord, je n’aime pas qu’il ne boive que de l’eau. Ça n’est pas sain. Pourquoi montre-t-il de la répugnance à voir les femmes quand elles mangent ? Quel singulier genre ! Mais c’est un fou. Tout ce que tu nous en as dit n’est pas possible, Un homme ne peut pas partir de sa maison sans souffler mot et ne revenir que dix jours après. Il te dit qu’il a été à Dieppe pour peindre la mer. Est-ce qu’on peint la mer ? Il te fait des contes à dormir debout.
Augustine ouvrit la bouche pour défendre son mari ; mais madame Guillaume lui imposa silence par un geste de main auquel un reste d’habitude la fit obéir, et sa mère s’écria d’un ton sec : — Tiens, ne me parle pas de cet homme-là ! il n’a jamais mis le pied dans une église que pour te voir et t’épouser. Les gens sans religion sont capables de tout. Est-ce que Guillaume s’est jamais avisé de me cacher quelque chose, de rester des trois jours sans me dire ouf, et de babiller ensuite comme une pie borgne ?
— Ma chère mère, vous jugez trop sévèrement les gens supérieurs. S’ils avaient des idées semblables à celles des autres, ce ne seraient plus des gens à talent.
— Eh bien ! que les gens à talent restent chez eux et ne se marient pas. Comment ! un homme à talent rendra sa femme malheureuse ! et parce qu’il a du talent ce sera bien ? Talent, talent ! Il n’y a pas tant de talent à dire comme lui blanc et noir à toute minute, à couper la parole aux gens, à battre du tambour chez soi, à ne jamais vous laisser savoir sur quel pied danser, à forcer une femme de ne pas s’amuser avant que les idées de monsieur ne soient gaies ; d’être triste, dès qu’il est triste.
— Mais, ma mère, le propre de ces imaginations-là…
— Qu’est-ce que c’est que ces imaginations-là ? reprit madame Guillaume en interrompant encore sa fille. Il en a de belles, ma foi ! Qu’est-ce qu’un homme auquel il prend tout à coup, sans consulter de médecin, la fantaisie de ne manger que des légumes ? Encore, si c’était par religion, sa diète lui servirait à quelque chose ; mais il n’en a pas plus qu’un huguenot. A-t-on jamais vu un homme aimer, comme lui, les chevaux plus qu’il n’aime son prochain, se faire friser les cheveux comme un païen, coucher des statues sous de la mousseline, faire fermer ses fenêtres le jour pour travailler à la lampe ? Tiens, laisse-moi, s’il n’était pas si grossièrement immoral, il serait bon à mettre aux Petites-Maisons. Consulte monsieur Loraux, le vicaire de Saint-Sulpice, demande-lui son avis sur tout cela, il te dira que ton mari ne se conduit pas comme un chrétien…
— Oh ! ma mère ! pouvez-vous croire…
— Oui, je le crois ! Tu l’as aimé, tu n’aperçois rien de ces choses-là. Mais, moi, vers les premiers temps de son mariage, je me souviens de l’avoir rencontré dans les Champs-Elysées. Il était à cheval. Eh bien ! il galopait par moment ventre à terre, et puis il s’arrêtait pour aller pas à pas. Je me suis dit alors : — Voilà un homme qui n’a pas de jugement.
— Ah ! s’écria monsieur Guillaume en se frottant les mains, comme j’ai bien fait de t’avoir mariée séparée de biens avec cet original-là !
Quand Augustine eut l’imprudence de raconter les griefs véritables qu’elle avait à exposer contre son mari, les deux vieillards restèrent muets d’indignation. Le mot de divorce fut bientôt prononcé par madame Guillaume. Au mot de divorce, l’inactif négociant fut comme réveillé. Stimulé par l’amour qu’il avait pour sa fille, et aussi par l’agitation qu’un procès allait donner à sa vie sans événements, le père Guillaume prit la parole. Il se mit à la tête de la demande en divorce, la dirigea, plaida presque, il offrit à sa fille de se charger de tous les frais, de voir les juges, les avoués, les avocats, de remuer ciel et terre. Madame de Sommervieux, effrayée, refusa les services de son père, dit qu’elle ne voulait pas se séparer de son mari, dût-elle être dix fois plus malheureuse encore, et ne parla plus de ses chagrins. Après avoir été accablée par ses parents de tous ces petits soins muets et consolateurs par lesquels les deux vieillards essayèrent de la dédommager, mais en vain, de ses peines de cœur, Augustine se retira en sentant l’impossibilité de parvenir à faire bien juger les hommes supérieurs par des esprits faibles. Elle apprit qu’une femme devait cacher à tout le monde, même à ses parents, des malheurs pour lesquels on rencontre si difficilement des sympathies. Les orages et les souffrances des sphères élevées ne peuvent être appréciés que par les nobles esprits qui les habitent. En toute chose, nous ne pouvons être jugés que par nos pairs.
La pauvre Augustine se retrouva donc dans la froide atmosphère de son ménage, livrée à l’horreur de ses méditations. L’étude n’était plus rien pour elle, puisque l’étude ne lui avait pas rendu le cœur de son mari. Initiée aux secrets de ces âmes de feu mais privée de leurs ressources, elle participait avec force à leurs peines sans partager leurs plaisirs. Elle s’était dégoûtée du monde, qui lui semblait mesquin et petit devant les événements des passions. Enfin, sa vie était manquée. Un soir, elle fut frappée d’une pensée qui vint illuminer ses ténébreux chagrins comme un rayon céleste. Cette idée ne pouvait sourire qu’à un cœur aussi pur, aussi vertueux que l’était le sien. Elle résolut d’aller chez la duchesse de Carigliano, non pas pour lui redemander le cœur de son mari, mais pour s’y instruire des artifices qui le lui avaient enlevé ; mais pour intéresser à la mère des enfants de son ami cette orgueilleuse femme du monde ; mais pour la fléchir et la rendre complice de son bonheur à venir comme elle était l’instrument de son malheur présent.
Un jour donc, la timide Augustine, armée d’un courage surnaturel, monta en voiture, à deux heures après midi, pour essayer de pénétrer jusqu’au boudoir de la célèbre coquette, qui n’était jamais visible avant cette heure-là. Madame de Sommervieux ne connaissait pas encore les antiques et somptueux hôtels du faubourg Saint-Germain. Quand elle parcourut ces vestibules majestueux, ces escaliers grandioses, ces salons immenses ornés de fleurs malgré les rigueurs de l’hiver, et décorés avec ce goût particulier aux femmes qui sont nées dans l’opulence ou avec les habitudes distinguées de l’aristocratie, Augustine eut un affreux serrement de cœur. Elle envia les secrets de cette élégance de laquelle elle n’avait jamais eu l’idée. Elle respira un air de grandeur qui lui expliqua l’attrait de cette maison pour son mari. Quand elle parvint aux petits appartements de la duchesse, elle éprouva de la jalousie et une sorte de désespoir, en y admirant la voluptueuse disposition des meubles, des draperies et des étoffes tendues. Là le désordre était une grâce, là le luxe affectait une espèce de dédain pour la richesse. Les parfums répandus dans cette douce atmosphère flattaient l’odorat sans l’offenser. Les accessoires de l’appartement s’harmoniaient avec une vue ménagée par des glaces sans tain sur les pelouses d’un jardin planté d’arbres verts. Tout était séduction, et le calcul ne s’y sentait point. Le génie de la maîtresse de ces appartements respirait tout entier dans le salon où attendait Augustine. Elle tâcha d’y deviner le caractère de sa rivale par l’aspect des objets épars ; mais il y avait là quelque chose d’impénétrable dans le désordre comme dans la symétrie, et pour la simple Augustine ce fut lettres closes. Tout ce qu’elle put y voir, c’est que la duchesse était une femme supérieure en tant que femme. Elle eut alors une pensée douloureuse.
— Hélas ! serait-il vrai, se dit-elle, qu’un cœur aimant et simple ne suffit pas à un artiste ; et pour balancer le poids de ces âmes fortes, faut-il les unir à des âmes féminines dont la puissance soit pareille à la leur ? Si j’avais été élevée comme cette sirène, au moins nos armes eussent été égales au moment de la lutte.
— Mais je n’y suis pas ! Ces mots secs et brefs, quoique prononcés à voix basse dans le boudoir voisin, furent entendus par Augustine, dont le cœur palpita.
— Cette dame est là, répliqua la femme de chambre.
— Vous êtes folle, faites donc entrer ! répondit la duchesse dont la voix devenue douce avait pris l’accent affectueux de la politesse. Évidemment, elle désirait alors être entendue.
Augustine s’avança timidement. Au fond de ce frais boudoir elle vit la duchesse voluptueusement couchée sur une ottomane en velours vert placée au centre d’une espèce de demi-cercle dessiné par les plis moelleux d’une mousseline tendue sur un fond jaune. Des ornements de bronze doré, disposés avec un goût exquis, rehaussaient encore cette espèce de dais sous lequel la duchesse était posée comme une statue antique. La couleur foncée du velours ne lui laissait perdre aucun moyen de séduction. Un demi-jour, ami de sa beauté, semblait être plutôt un reflet qu’une lumière. Quelques fleurs rares élevaient leurs têtes embaumées au-dessus des vases de Sèvres les plus riches. Au moment où ce tableau s’offrit aux yeux d’Augustine étonnée, elle avait marché si doucement, qu’elle put surprendre un regard de l’enchanteresse. Ce regard semblait dire à une personne que la femme du peintre n’aperçut pas d’abord : — Restez, vous allez voir une jolie femme, et vous me rendrez sa visite moins ennuyeuse.
À l’aspect d’Augustine, la duchesse se leva et la fit asseoir auprès d’elle.
— À quoi dois-je le bonheur de cette visite, madame ? dit-elle avec un sourire plein de grâces.
— Pourquoi tant de fausseté ? pensa Augustine, qui ne répondit que par une inclination de tête.
Ce silence était commandé. La jeune femme voyait devant elle un témoin de trop à cette scène. Ce personnage était, de tous les colonels de l’armée, le plus jeune, le plus élégant et le mieux fait. Son costume demi-bourgeois faisait ressortir les grâces de sa personne. Sa figure pleine de vie, de jeunesse, et déjà fort expressive, était encore animée par de petites moustaches relevées en pointe et noires comme du jais, par une impériale bien fournie, par des favoris soigneusement peignés et par une forêt de cheveux noirs assez en désordre. Il badinait avec une cravache, en manifestant une aisance et une liberté qui séyaient à l’air satisfait de sa physionomie ainsi qu’à la recherche de sa toilette. Les rubans attachés à sa boutonnière étaient noués avec dédain, et il paraissait bien plus vain de sa jolie tournure que de son courage. Augustine regarda la duchesse de Carigliano en lui montrant le colonel par un coup d’œil dont toutes les prières furent comprises.
— Eh bien, adieu, monsieur d’Aiglemont, nous nous retrouverons au bois de Boulogne.
Ces mots furent prononcés par la sirène comme s’ils étaient le résultat d’une stipulation antérieure à l’arrivée d’Augustine ; elle les accompagna d’un regard menaçant que l’officier méritait peut-être pour l’admiration qu’il témoignait en contemplant la modeste fleur qui contrastait si bien avec l’orgueilleuse duchesse. Le jeune fat s’inclina en silence, tourna sur les talons de ses bottes, et s’élança gracieusement hors du boudoir. En ce moment, Augustine, épiant sa rivale qui semblait suivre des yeux le brillant officier, surprit dans ce regard un sentiment dont les fugitives expressions sont connues de toutes les femmes. Elle songea avec la douleur la plus profonde que sa visite allait être inutile : cette artificieuse duchesse était trop avide d’hommages pour ne pas avoir le cœur sans pitié.
— Madame, dit Augustine d’une voix entrecoupée, la démarche que je fais en ce moment auprès de vous va vous sembler bien singulière ; mais le désespoir a sa folie, et doit faire tout excuser. Je m’explique trop bien pourquoi Théodore préfère votre maison à toute autre, et pourquoi votre esprit exerce tant d’empire sur lui. Hélas ! je n’ai qu’à rentrer en moi-même pour en trouver des raisons plus que suffisantes. Mais j’adore mon mari, madame. Deux ans de larmes n’ont point effacé son image de mon cœur, quoique j’aie perdu le sien. Dans ma folie, j’ai osé concevoir l’idée de lutter avec vous ; et je viens à vous, vous demander par quels moyens je puis triompher de vous-même. Oh, madame ! s’écria la jeune femme en saisissant avec ardeur la main de sa rivale, qui la lui laissa prendre, je ne prierai jamais Dieu pour mon propre bonheur avec autant de ferveur que je l’implorerais pour le vôtre, si vous m’aidiez à reconquérir, je ne dirai pas l’amour, mais la tendresse de Sommervieux. Je n’ai plus d’espoir qu’en vous. Ah ! dites-moi comment vous avez pu lui plaire et lui faire oublier les premiers jours de…
À ces mots, Augustine, suffoquée par des sanglots mal contenus, fut obligée de s’arrêter. Honteuse de sa faiblesse, elle cacha son visage dans un mouchoir qu’elle inonda de ses larmes.
— Êtes-vous donc enfant, ma chère petite belle ! dit la duchesse, qui, séduite par la nouveauté de cette scène et attendrie malgré elle en recevant l’hommage que lui rendait la plus parfaite vertu qui fût peut-être à Paris, prit le mouchoir de la jeune femme et se mit à lui essuyer elle-même les yeux en la flattant par quelques monosyllabes murmurés avec une gracieuse pitié.
Après un moment de silence, la coquette, emprisonnant les jolies mains de la pauvre Augustine entre les siennes qui avaient un rare caractère de beauté noble et de puissance, lui dit d’une voix douce et affectueuse : — Pour premier avis, je vous conseillerai de ne pas pleurer ainsi, les larmes enlaidissent. Il faut savoir prendre son parti sur les chagrins ; ils rendent malade, et l’amour ne reste pas longtemps sur un lit de douleur. La mélancolie donne bien d’abord une certaine grâce qui plaît, mais elle finit par allonger les traits et flétrir la plus ravissante de toutes les figures. Ensuite, nos tyrans ont l’amour-propre de vouloir que leurs esclaves soient toujours gaies.
— Ah, madame ! il ne dépend pas de moi de ne pas sentir ! Comment peut-on, sans éprouver mille morts, voir terne, décolorée, indifférente, une figure qui jadis rayonnait d’amour et de joie ? Ah ! je ne sais pas commander à mon cœur.
— Tant pis, chère belle ; mais je crois déjà savoir toute votre histoire. D’abord, imaginez-vous bien que si votre mari vous a été infidèle, je ne suis pas sa complice. Si j’ai tenu à l’avoir dans mon salon, c’est, je l’avouerai, par amour-propre : il était célèbre et n’allait nulle part. Je vous aime déjà trop pour vous dire toutes les folies qu’il a faites pour moi. Je ne vous en révélerai qu’une seule, parce qu’elle nous servira peut-être à vous le ramener et à le punir de l’audace qu’il met dans ses procédés avec moi. Il finirait par me compromettre. Je connais trop le monde, ma chère, pour vouloir me mettre à la discrétion d’un homme trop supérieur. Sachez qu’il faut se laisser faire la cour par eux, mais les épouser !c’est une faute. Nous autres femmes, nous devons admirer les hommes de génie, en jouir comme d’un spectacle, mais vivre avec eux ! jamais. Fi donc ! c’est vouloir prendre plaisir à regarder les machines de l’Opéra, au lieu de rester dans une loge, à y savourer ses brillantes illusions. Mais chez vous, ma pauvre enfant, le mal est arrivé, n’est-ce pas ? Eh bien ! il faut essayer de vous armer contre la tyrannie.
— Ah, madame ! avant d’entrer ici, en vous y voyant, j’ai déjà reconnu quelques artifices que je ne soupçonnais pas.
— Eh bien, venez me voir quelquefois, et vous ne serez pas long-temps sans posséder la science de ces bagatelles, d’ailleurs assez importantes. Les choses extérieures sont, pour les sots, la moitié de la vie ; et pour cela, plus d’un homme de talent se trouve un sot malgré tout son esprit. Mais je gage que vous n’avez jamais rien su refuser à Théodore ?
— Le moyen, madame, de refuser quelque chose à celui qu’on aime !
— Pauvre innocente, je vous adorerais pour votre niaiserie. Sachez donc que plus nous aimons, moins nous devons laisser apercevoir à un homme, surtout à un mari, l’étendue de notre passion. C’est celui qui aime le plus qui est tyrannisé, et, qui pis est, délaissé tôt ou tard. Celui qui veut régner, doit…
— Comment, madame ! faudra-t-il donc dissimuler, calculer, devenir fausse, se faire un caractère artificiel et pour toujours ? Oh ! comment peut-on vivre ainsi ? Est-ce que vous pouvez…
Elle hésita, la duchesse sourit.
— Ma chère, reprit la grande dame d’une voix grave, le bonheur conjugal a été de tout temps une spéculation, une affaire qui demande une attention particulière. Si vous continuez à parler passion quand je vous parle mariage, nous ne nous entendrons bientôt plus. Écoutez-moi, continua-t-elle en prenant le ton d’une confidence. J’ai été à même de voir quelques-uns des hommes supérieurs de notre époque. Ceux qui se sont mariés ont, à quelques exceptions près, épousé des femmes nulles. Eh bien ! ces femmes-là les gouvernaient, comme l’empereur nous gouverne, et étaient, sinon aimées, du moins respectées par eux. J’aime assez les secrets, surtout ceux qui nous concernent, pour m’être amusée à chercher le mot de cette énigme. Eh bien, mon ange ! ces bonnes femmes avaient le talent d’analyser le caractère de leurs maris. Sans s’épouvanter comme vous de leurs supériorités, elles avaient adroitement remarqué les qualités qui leur manquaient. Soit qu’elles possédassent ces qualités, ou qu’elles feignissent de les avoir, elles trouvaient moyen d’en faire un si grand étalage aux yeux de leurs maris qu’elles finissaient par leur imposer. Enfin, apprenez encore que ces âmes qui paraissent si grandes ont toutes un petit grain de folie que nous devons savoir exploiter. En prenant la ferme volonté de les dominer, en ne s’écartant jamais de ce but, en y rapportant toutes nos actions, nos idées, nos coquetteries, nous maîtrisons ces esprits éminemment capricieux qui, par la mobilité même de leurs pensées, nous donnent les moyens de les influencer.
— Oh ciel ! s’écria la jeune femme épouvantée, voilà donc la vie. C’est un combat…
— Où il faut toujours menacer, reprit la duchesse en riant. Notre pouvoir est tout factice. Aussi ne faut-il jamais se laisser mépriser par un homme ; on ne se relève d’une pareille chute que par des manœuvres odieuses. Venez, ajouta-t-elle, je vais vous donner un moyen de mettre votre mari à la chaîne.
Elle se leva, pour guider en souriant la jeune et innocente apprentie des ruses conjugales à travers le dédale de son petit palais. Elles arrivèrent toutes deux à un escalier dérobé qui communiquait aux appartements de réception. Quand la duchesse tourna le secret de la porte, elle s’arrêta, regarda Augustine avec un air inimitable de finesse et de grâce : — Tenez, le duc de Carigliano m’adore ! eh bien, il n’ose pas entrer par cette porte sans ma permission. Et c’est un homme qui a l’habitude de commander à des milliers de soldats. Il sait affronter les batteries, mais devant moi ! il a peur.
Augustine soupira. Elles parvinrent à une somptueuse galerie où la femme du peintre fut amenée par la duchesse devant le portrait que Théodore avait fait de mademoiselle Guillaume. À cet aspect, Augustine jeta un cri.
— Je savais bien qu’il n’était plus chez moi, dit-elle, mais… ici !
— Ma chère, je ne l’ai exigé que pour voir jusqu’à quel degré de bêtise un homme de génie peut atteindre. Tôt ou tard, il vous aurait été rendu par moi ; mais je ne m’attendais pas au plaisir de voir ici l’original devant la copie. Pendant que nous allons achever notre conversation, je le ferai porter dans votre voiture. Si, armée de ce talisman, vous n’êtes pas maîtresse de votre mari pendant cent ans, vous n’êtes pas une femme, et vous méritez votre sort !
Augustine baisa la main de la duchesse, qui la pressa sur son cœur et l’embrassa avec une tendresse d’autant plus vive qu’elle devait être oubliée le lendemain. Cette scène aurait peut-être à jamais ruiné la candeur et la pureté d’une femme moins vertueuse qu’Augustine, à qui les secrets révélés par la duchesse pouvaient être également salutaires et funestes. La politique astucieuse des hautes sphères sociales ne convenait pas plus à Augustine que l’étroite raison de Joseph Lebas, ou que la niaise morale de madame Guillaume. Étrange effet des fausses positions où nous jettent les moindres contresens commis dans la vie ! Augustine ressemblait alors à un pâtre des Alpes surpris par une avalanche : s’il hésite, ou s’il veut écouter les cris de ses compagnons, le plus souvent il périt. Dans ces grandes crises, le cœur se brise ou se bronze.
Madame de Sommervieux revint chez elle en proie à une agitation qu’il serait difficile de décrire. Sa conversation avec la duchesse de Carigliano éveillait une foule d’idées contradictoires dans son esprit. Elle était comme les moutons de la fable, pleine de courage en l’absence du loup. Elle se haranguait elle-même et se traçait d’admirables plans de conduite ; elle concevait mille stratagèmes de coquetterie ; elle parlait même à son mari, retrouvant, loin de lui, toutes les ressources de cette éloquence vraie qui n’abandonne jamais les femmes ; puis, en songeant au regard fixe et clair de Théodore, elle tremblait déjà. Quand elle demanda si monsieur était chez lui, la voix lui manqua. En apprenant qu’il ne reviendrait pas dîner, elle éprouva un mouvement de joie inexplicable. Semblable au criminel qui se pourvoit en cassation contre son arrêt de mort, un délai, quelque court qu’il pût être, lui semblait une vie entière. Elle plaça le portrait dans sa chambre, et attendit son mari en se livrant à toutes les angoisses de l’espérance Elle pressentait trop bien que cette tentative allait décider de tout son avenir, pour ne pas frissonner à toute espèce de bruit, même au murmure de sa pendule qui semblait appesantir ses terreurs en les lui mesurant. Elle tâcha de tromper le temps par mille artifices. Elle eut l’idée de faire une toilette qui la rendit semblable en tout point au portrait. Puis, connaissant le caractère inquiet de son mari, elle fit éclairer son appartement d’une manière inusitée, certaine qu’en rentrant la curiosité l’amènerait chez elle. Minuit sonna, quand, au cri du jockei, la porte de l’hôtel s’ouvrit. La voiture du peintre roula sur le pavé de la cour silencieuse.
— Que signifie cette illumination ? demanda Théodore d’une voix joyeuse en entrant dans la chambre de sa femme.
Augustine saisit avec adresse un moment si favorable, elle s’élança au cou de son mari et lui montra le portrait. L’artiste resta immobile comme un rocher. Ses yeux se dirigèrent alternativement sur Augustine et sur la toile accusatrice. La timide épouse, demi-morte, épiait le front changeant, le front terrible de son mari. Elle en vit par degrés les rides expressives s’amonceler comme des nuages ; puis, elle crut sentir son sang se figer dans ses veines, quand, par un regard flamboyant et d’une voix profondément sourde, elle fut interrogée.
— Où avez-vous trouvé ce tableau ?
— La duchesse de Carigliano me l’a rendu.
— Vous le lui avez demandé ?
— Je ne savais pas qu’il fût chez elle.
La douceur ou plutôt la mélodie enchanteresse de la voix de cet ange eût attendri des Cannibales, mais non un artiste en proie aux tortures de la vanité blessée.
— Cela est digne d’elle, s’écria l’artiste d’une voix tonnante. Je me vengerai ! dit-il en se promenant à grands pas. Elle en mourra de honte : je la peindrai ! oui, je la représenterai sous les traits de Messaline sortant à la nuit du palais de Claude.
— Théodore ! dit une voix mourante.
— Je la tuerai.
— Mon ami !
— Elle aime ce petit colonel de cavalerie, parce qu’il monte bien à cheval…
— Théodore !
— Eh ! laissez-moi, dit le peintre à sa femme avec un son de voix qui ressemblait presque à un rugissement.
Il serait odieux de peindre toute cette scène à la fin de laquelle l’ivresse de la colère suggéra à l’artiste des paroles et des actes qu’une femme, moins jeune qu’Augustine, aurait attribués à la démence.
Sur les huit heures du matin, le lendemain, madame Guillaume surprit sa fille pâle, les yeux rouges, la coiffure en désordre, tenant à la main un mouchoir trempé de pleurs, contemplant sur le parquet les fragments épars d’une toilette déchirée et les morceaux d’un grand cadre doré mis en pièce. Augustine, que la douleur rendait presque insensible, montra ces débris par un geste empreint de désespoir.
— Et voilà peut-être une grande perte, s’écria la vieille régente du Chat-qui-pelote. Il était ressemblant, c’est vrai ; mais j’ai appris qu’il y a sur le boulevard un homme qui fait des portraits charmants pour cinquante écus.
— Ah, ma mère !
— Pauvre petite, tu as bien raison ! répondit madame Guillaume qui méconnut l’expression du regard que lui jeta sa fille. Va, mon enfant, l’on n’est jamais si tendrement aimé que par sa mère. Ma mignonne, je devine tout ; mais viens me confier tes chagrins, je te consolerai. Ne t’ai-je pas déjà dit que cet homme-là était un fou ! Ta femme de chambre m’a conté de belles choses… Mais c’est donc un véritable monstre !
Augustine mit un doigt sur ses lèvres pâlies, comme pour implorer de sa mère un moment de silence. Pendant cette terrible nuit, le malheur lui avait fait trouver cette patiente résignation qui, chez les mères et chez les femmes aimantes, surpasse, dans ses effets, l’énergie humaine et révèle peut-être dans le cœur des femmes l’existence de certaines cordes que Dieu a refusées à l’homme.
Une inscription gravée sur un cippe du cimetière Montmartre indiquait que madame de Sommervieux était morte à vingt-sept ans. Un poëte, ami de cette timide créature, voyait, dans les simples lignes de son épitaphe, la dernière scène d’un drame. Chaque année, au jour solennel du 2 novembre, il ne passait jamais devant ce jeune marbre sans se demander s’il ne fallait pas des femmes plus fortes que ne l’était Augustine pour les puissantes étreintes du génie.
— Les humbles et modestes fleurs, écloses dans les vallées, meurent peut-être, se disait-il, quand elles sont transplantées trop près des cieux, aux régions où se forment les orages, où le soleil est brûlant.
07:35 Publié dans Ecrits, Films français, Les mots des films, Littérature, Thèse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : balzac
mercredi, 30 janvier 2013
La maison du Chat-qui-pelote - Balzac - le film

Téléfilm : La maison du Chat-qui-pelote (2009, durée 1h)
Réalisateur : Jean-Daniel Verhaeghe
Scénariste : Anne Andréi
D'après Balzac.
Monsieur Guillaume, drapier à Paris qui tient l'enseigne du Chat-qui-pelote (Régis Laspalès), madame Guillaume son épouse (Marie Vincent), Virginie Guillaume leur fille aînée, légèrement disgracieuse (Françoise Gillard), Augustine Guillaume la cadette aux deux prétendants (Mélanie Bernier)
Théodore de Sommervieux aristocrate et peintre à ses heures (Raphaël Personnaz), Joseph Lebas le commis de monsieur Guillaume
Madame Roguin (Evelyne Bouix), la duchesse de Carigliano (Arielle Dombasle)
¤ ¤ ¤
> Le téléfilm dans son intégralité :
> A consulter également, Balzac et le cinéma :
http://balzac.pagesperso-orange.fr/cinema.htm
07:35 Publié dans Ecrits, Films français, Les mots des films, Littérature, Thèse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : balzac
mardi, 29 janvier 2013
Considérations sur la littérature - Balzac
Vous ne vous figurez pas ce que c’est que la Comédie humaine ; c’est plus vaste, littérairement parlant, que la cathédrale de Bourges architecturalement.
(Lettre à Zulma Carraud, janvier 1845)
> Pour diverses analyses et autres anecdotes :
http://debalzac.wordpress.com/tag/comedie-humaine/
> Pour des extraits illustrés : http://milema.canalblog.com/archives/la_comedie_humaine__...
Auto-préface de La Comédie humaine, 1842, Honoré de Balzac :
En donnant à une oeuvre entreprise depuis bientôt treize ans, le titre de la Comédie humaine, il est nécessaire d'en dire la pensée, d'en raconter l'origine, d'en expliquer brièvement le plan, en essayant de parler de ces choses comme si je n'y étais pas intéressé. Ceci n'est pas aussi difficile que le public pourrait le penser. Peu d'oeuvres donne beaucoup d'amour-propre, beaucoup de travail donne infiniment de modestie. Cette observation rend compte des examens que Corneille, Molière et autres grands auteurs faisaient de leurs ouvrages : s'il est impossible de les égaler dans leurs belles conceptions, on peut vouloir leur ressembler en ce sentiment.
L'idée première de la Comédie humaine fut d'abord chez moi comme un rêve, comme un de ces projets impossibles que l'on caresse et qu'on laisse s'envoler ; une chimère qui sourit, qui montre son visage de femme et qui déploie aussitôt ses ailes en remontant dans un ciel fantastique. Mais la chimère, comme beaucoup de chimères, se change en réalité, elle a ses commandements et sa tyrannie auxquels il faut céder.
Cette idée vint d'une comparaison entre l'Humanité et l'Animalité.
Ce serait une erreur de croire que la grande querelle qui, dans ces derniers temps, s'est émue entre Cuvier et Geoffroi Saint-Hilaire, reposait sur une innovation scientifique. L'unité de composition occupait déjà sous d'autres termes les plus grands esprits des deux siècles précédents. En relisant les oeuvres si extraordinaires des écrivains mystiques qui se sont occupés des sciences dans leurs relations avec l'infini, tels que Swedenborg, Saint-Martin, etc., et les écrits des plus beaux génies en histoire naturelle, tels que Leibnitz, Buffon, Charles Bonnet, etc., on trouve dans les monades de Leibnitz, dans les molécules organiques de Buffon, dans la force végétatrice de Needham, dans l'emboîtement des parties similaires de Charles Bonnet, assez hardi pour écrire en 1760 : L'animal végète comme la plante ; on trouve, dis-je, les rudiments de la belle loi du soi pour soi sur laquelle repose l' unité de composition. Il n'y a qu'un animal. Le créateur ne s'est servi que d'un seul et même patron pour tous les êtres organisés. L'animal est un principe qui prend sa forme extérieure, ou, pour parler plus exactement, les différences de sa forme, dans les milieux où il est appelé à se développer. Les Espèces Zoologiques résultent de ces différences. La proclamation et le soutien de ce système, en harmonie d'ailleurs avec les idées que nous nous faisons de la puissance divine, sera l'éternel honneur de Geoffroi Saint-Hilaire, le vainqueur de Cuvier sur ce point de la haute science, et dont le triomphe a été salué par le dernier article qu'écrivit le grand Goethe.
Pénétré de ce système bien avant les débats auxquels il a donné lieu, je vis que, sous ce rapport, la Société ressemblait à la Nature. La Société ne fait-elle pas de l'homme, suivant les milieux où son action se déploie, autant d'hommes différents qu'il y a de variétés en zoologie ? Les différences entre un soldat, un ouvrier, un administrateur, un avocat, un oisif, un savant, un homme d'état, un commerçant, un marin, un poète, un pauvre, un prêtre, sont, quoique plus difficiles à saisir, aussi considérables que celles qui distinguent le loup, le lion, l'âne, le corbeau, le requin, le veau marin, la brebis, etc. Il a donc existé, il existera donc de tout temps des Espèces Sociales comme il y a des Espèces Zoologiques. Si Buffon a fait un magnifique ouvrage en essayant de représenter dans un livre l'ensemble de la zoologie, n'y avait-il pas une oeuvre de ce genre à faire pour la Société ? Mais la Nature a posé, pour les variétés animales, des bornes entre lesquelles la Société ne devait pas se tenir. Quand Buffon peignait le lion, il achevait la lionne en quelques phrases ; tandis que dans la Société la femme ne se trouve pas toujours être la femelle du mâle. Il peut y avoir deux êtres parfaitement dissemblables dans un ménage. La femme d'un marchand est quelquefois digne d'être celle d'un prince, et souvent celle d'un prince ne vaut pas celle d'un artiste. L'Etat Social a des hasards que ne se permet pas la Nature, car il est la Nature plus la Société. La description des Espèces Sociales était donc au moins double de celle des Espèces Animales, à ne considérer que les deux sexes. Enfin, entre les animaux, il y a peu de drames, la confusion ne s'y met guère ; ils courent sus les uns aux autres, voilà tout. Les hommes courent bien aussi les uns sur les autres ; mais leur plus ou moins d'intelligence rend le combat autrement compliqué. Si quelques savants n'admettent pas encore que l'Animalité se transborde dans l'Humanité par un immense courant de vie, l'épicier devient certainement pair de France, et le noble descend parfois au dernier rang social. Puis, Buffon a trouvé la vie excessivement simple chez les animaux. L'animal a peu de mobilier, il n'a ni arts ni sciences ; tandis que l'homme, par une loi qui est à rechercher, tend à représenter ses moeurs, sa pensée et sa vie dans tout ce qu'il approprie à ses besoins. Quoique Leuwenhoëk, Swammerdam, Spallanzani, Réaumur, Charles Bonnet, Muller, Haller et autres patients zoographes aient démontré combien les moeurs des animaux étaient intéressantes ; les habitudes de chaque animal sont, à nos yeux du moins, constamment semblables en tout temps ; tandis que les habitudes, les vêtements, les paroles, les demeures d'un prince, d'un banquier, d'un artiste, d'un bourgeois, d'un prêtre et d'un pauvre sont entièrement dissemblables et changent au gré des civilisations.
Ainsi l'oeuvre à faire devait avoir une triple forme : les hommes, les femmes et les choses, c'est-à-dire les personnes et la représentation matérielle qu'ils donnent de leur pensée ; enfin l'homme et la vie.
En lisant les sèches et rebutantes nomenclatures de faits appelées histoires, qui ne s'est aperçu que les écrivains ont oublié, dans tous les temps, en Egypte, en Perse, en Grèce, à Rome, de nous donner l'histoire des moeurs. Le morceau de Pétrone sur la vie privée des Romains irrite plutôt qu'il ne satisfait notre curiosité. Après avoir remarqué cette immense lacune dans le champ de l'histoire, l'abbé Bartélemy consacra sa vie à refaire les moeurs grecques dans Anacharsis.
Mais comment rendre intéressant le drame à trois ou quatre mille personnages que présente une Société ? comment plaire à la fois au poète, au philosophe et aux masses qui veulent la poésie et la philosophie sous de saisissantes images ? Si je concevais l'importance et la poésie de cette histoire du coeur humain, je ne voyais aucun moyen d'exécution ; car, jusqu'à notre époque, les plus célèbres conteurs avaient dépensé leur talent à créer un ou deux personnages typiques, à peindre une face de la vie. Ce fut avec cette pensée que je lus les oeuvres de Walter Scott. Walter Scott, ce trouveur (trouvère) moderne, imprimait alors une allure gigantesque à un genre de composition injustement appelé secondaire. N'est-il pas véritablement plus difficile de faire concurrence à l'Etat-Civil avec Daphnis et Chloë, Roland, Amadis, Panurge, Don Quichotte, Manon Lescaut, Clarisse, Lovelace, Robinson Crusoë, Gilblas, Ossian, Julie d'Etanges, mon oncle Tobie, Werther, René, Corinne, Adolphe, Paul et Virginie, Jeanie Dean, Claverhouse, Ivanhoë, Manfred, Mignon, que de mettre en ordre les faits à peu près les mêmes chez toutes les nations, de rechercher l'esprit de lois tombées en désuétude, de rédiger des théories qui égarent les peuples, ou, comme certains métaphysiciens, d'expliquer ce qui est ? D'abord, presque toujours ces personnages, dont l'existence devient plus longue, plus authentique que celle des générations au milieu desquelles on les fait naître, ne vivent qu'à la condition d'être une grande image du présent. Conçus dans les entrailles de leur siècle, tout le coeur humain se remue sous leur enveloppe, il s'y cache souvent toute une philosophie. Walter Scott élevait donc à la valeur philosophique de l'histoire le roman, cette littérature qui, de siècle en siècle, incruste d'immortels diamants la couronne poétique des pays où se cultivent les lettres. Il y mettait l'esprit des anciens temps, il y réunissait à la fois le drame, le dialogue, le portrait, le paysage, la description ; il y faisait entrer le merveilleux et le vrai, ces éléments de l'épopée, il y faisait coudoyer la poésie par la familiarité des plus humbles langages. Mais, ayant moins imaginé un système que trouvé sa manière dans le feu du travail ou par la logique de ce travail, il n'avait pas songé à relier ses compositions l'une à l'autre de manière à coordonner une histoire complète, dont chaque chapitre eût été un roman, et chaque roman une époque. En apercevant ce défaut de liaison, qui d'ailleurs ne rend pas l'Ecossais moins grand, je vis à la fois le système favorable à l'exécution de mon ouvrage et la possibilité de l'exécuter. Quoique, pour ainsi dire, ébloui par la fécondité surprenante de Walter Scott, toujours semblable à lui-même et toujours original, je ne fus pas désespéré, car je trouvai la raison de ce talent dans l'infinie variété de la nature humaine. Le hasard est le plus grand romancier du monde : pour être fécond, il n'y a qu'à l'étudier. La Société française allait être l'historien, je ne devais être que le secrétaire. En dressant l'inventaire des vices et des vertus, en rassemblant les principaux faits des passions, en peignant les caractères, en choisissant les événements principaux de la Société, en composant des types par la réunion des traits de plusieurs caractères homogènes, peut-être pouvais-je arriver à écrire l'histoire oubliée par tant d'historiens, celle des moeurs. Avec beaucoup de patience et de courage, je réaliserais, sur la France au dix-neuvième siècle, ce livre que nous regrettons tous, que Rome, Athènes, Tyr, Memphis, la Perse, l'Inde ne nous ont malheureusement pas laissé sur leurs civilisations, et qu'à l'instar de l'abbé Barthélemy, le courageux et patient Monteil avait essayé pour le Moyen-Age, mais sous une forme peu attrayante.
Ce travail n'était rien encore. S'en tenant à cette reproduction rigoureuse, un écrivain pouvait devenir un peintre plus ou moins fidèle, plus ou moins heureux, patient ou courageux des types humains, le conteur des drames de la vie intime, l'archéologue du mobilier social, le nomenclateur des professions, l'enregistreur du bien et du mal ; mais, pour mériter les éloges que doit ambitionner tout artiste, ne devais-je pas étudier les raisons ou la raison de ces effets sociaux, surprendre le sens caché dans cet immense assemblage de figures, de passions et d'événements. Enfin, après avoir cherché, je ne dis pas trouvé, cette raison, ce moteur social, ne fallait-il pas méditer sur les principes naturels et voir en quoi les Sociétés s'écartent ou se rapprochent de la règle éternelle, du vrai, du beau ? Malgré l'étendue des prémisses, qui pouvaient être à elles seules un ouvrage, l'oeuvre, pour être entière, voulait une conclusion. Ainsi dépeinte, la Société devait porter avec elle la raison de son mouvement.

La loi de l'écrivain, ce qui le fait tel, ce qui, je ne crains pas de le dire, le rend égal et peut-être supérieur à l'homme d'état, est une décision quelconque sur les choses humaines, un dévouement absolu à des principes. Machiavel, Hobbes, Bossuet, Leibnitz, Kant, Montesquieu sont la science que les hommes d'état appliquent. " Un écrivain doit avoir en morale et en politique des opinions arrêtées, il doit se regarder comme un instituteur des hommes ; car les hommes n'ont pas besoin de maîtres pour douter," a dit Bonald. J'ai pris de bonne heure pour règle ces grandes paroles, qui sont la loi de l'écrivain monarchique aussi bien que celle de l'écrivain démocratique. Aussi, quand on voudra m'opposer à moi-même, se trouvera-t-il qu'on aura mal interprété quelque ironie, ou bien l'on rétorquera mal à propos contre moi le discours d'un de mes personnages, manoeuvre particulière aux calomniateurs. Quant au sens intime, à l'âme de cet ouvrage, voici les principes qui lui servent de base.
L'homme n'est ni bon ni méchant, il naît avec des instincts et des aptitudes ; la Société, loin de le dépraver, comme l'a prétendu Rousseau, le perfectionne, le rend meilleur ; mais l'intérêt développe aussi ses penchants mauvais. Le christianisme, et surtout le catholicisme, étant, comme je l'ai dit dans le Médecin de Campagne, un système complet de répression des tendances dépravées de l'homme, est le plus grand élément d'Ordre Social.
En lisant attentivement le tableau de la Société, moulée, pour ainsi dire, sur le vif avec tout son bien et tout son mal, il en résulte cet enseignement que si la pensée, ou la passion, qui comprend la pensée et le sentiment, est l'élément social, elle en est aussi l'élément destructeur. En ceci, la vie sociale ressemble à la vie humaine. On ne donne aux peuples de longévité qu'en modérant leur action vitale. L'enseignement, ou mieux, l'éducation par des Corps Religieux est donc le grand principe d'existence pour les peuples, le seul moyen de diminuer la somme du mal et d'augmenter la somme du bien dans toute Société. La pensée, principe des maux et des biens, ne peut être préparée, domptée, dirigée que par la religion. L'unique religion possible est le christianisme (voir la lettre écrite de Paris dans LOUIS LAMBERT, où le jeune philosophe mystique explique, à propos de la doctrine de Swedenborg, comment il n'y a jamais eu qu'une même religion depuis l'origine du monde). Le Christianisme a créé les peuples modernes, il les conservera. De là sans doute la nécessité du principe monarchique. Le Catholicisme et la Royauté sont deux principes jumeaux. Quant aux limites dans lesquelles ces deux principes doivent être enfermés par des Institutions afin de ne pas les laisser se développer absolument, chacun sentira qu'une préface aussi succincte que doit l'être celle-ci, ne saurait devenir un traité politique. Aussi ne dois-je entrer ni dans les dissensions religieuses ni dans les dissensions politiques du moment. J'écris à la lueur de deux Vérités éternelles : la Religion, la Monarchie, deux nécessités que les événements contemporains proclament, et vers lesquelles tout écrivain de bon sens doit essayer de ramener notre pays. Sans être l'ennemi de l'Election, principe excellent pour constituer la loi, je repousse l'Election prise comme unique moyen social, et surtout aussi mal organisée qu'elle l'est aujourd'hui, car elle ne représente pas d'imposantes minorités aux idées, aux intérêts desquelles songerait un gouvernement monarchique. L'Election, étendue à tout, nous donne le gouvernement par les masses, le seul qui ne soit point responsable, et où la tyrannie est sans bornes, car elle s'appelle la loi. Aussi regardé-je la Famille et non l'Individu comme le véritable élément social. Sous ce rapport, au risque d'être regardé comme un esprit rétrograde, je me range du côté de Bossuet et de Bonald, au lieu d'aller avec les novateurs modernes. Comme l'Election est devenue l'unique moyen social, si j'y avais recours pour moi-même, il ne faudrait pas inférer la moindre contradiction entre mes actes et ma pensée. Un ingénieur annonce que tel pont est près de crouler, qu'il y a danger pour tous à s'en servir, et il y passe lui-même quand ce pont est la seule route pour arriver à la ville. Napoléon avait merveilleusement adapté l'Election au génie de notre pays. Aussi les moindres députés de son Corps Législatif ont-ils été les plus célèbres orateurs des Chambres sous la Restauration. Aucune Chambre n'a valu le Corps législatif en les comparant homme à homme. Le système électif de l'Empire est donc incontestablement le meilleur.
Certaines personnes pourront trouver quelque chose de superbe et d'avantageux dans cette déclaration. On cherchera querelle au romancier de ce qu'il veut être historien, on lui demandera raison de sa politique. J'obéis ici à une obligation, voilà toute la réponse. L'ouvrage que j'ai entrepris aura la longueur d'une histoire, j'en devais la raison, encore cachée, les principes et la morale.
Nécessairement forcé de supprimer les préfaces publiées pour répondre à des critiques essentiellement passagères, je n'en veux conserver qu'une observation.
Les écrivains qui ont un but, fût-ce un retour aux principes qui se trouvent dans le passé par cela même qu'ils sont éternels, doivent toujours déblayer le terrain. Or, quiconque apporte sa pierre dans le domaine des idées, quiconque signale un abus, quiconque marque d'un signe le mauvais pour être retranché, celui-là passe toujours pour être immoral. Le reproche d'immoralité, qui n'a jamais failli à l'écrivain courageux, est d'ailleurs le dernier qui reste à faire quand on n'a plus rien à dire à un poète. Si vous êtes vrai dans vos peintures ; si à force de travaux diurnes et nocturnes, vous parvenez à écrire la langue la plus difficile du monde, on vous jette alors le mot immoral à la face. Socrate fut immoral, Jésus-Christ fut immoral ; tous deux ils furent poursuivis au nom des Sociétés qu'ils renversaient ou réformaient. Quand on veut tuer quelqu'un, on le taxe d'immoralité. Cette manoeuvre, familière aux partis, est la honte de tous ceux qui l'emploient. Luther et Calvin savaient bien ce qu'ils faisaient en se servant des Intérêts matériels blessés comme d'un bouclier ! Aussi ont-ils vécu toute leur vie.
En copiant toute la Société, la saisissant dans l'immensité de ses agitations, il arrive, il devait arriver que telle composition offrait plus de mal que de bien, que telle partie de la fresque représentait un groupe coupable, et la critique de crier à l'immoralité, sans faire observer la moralité de telle autre partie destinée à former un contraste parfait. Comme la critique ignorait le plan général, je lui pardonnais d'autant mieux qu'on ne peut pas plus empêcher la critique qu'on ne peut empêcher la vue, le langage et le jugement de s'exercer. Puis le temps de l'impartialité n'est pas encore venu pour moi. D'ailleurs, l'auteur qui ne sait pas se résoudre à essuyer le feu de la critique ne doit pas plus se mettre à écrire qu'un voyageur ne doit se mettre en route en comptant sur un ciel toujours serein. Sur ce point, il me reste à faire observer que les moralistes les plus consciencieux doutent fort que la Société puisse offrir autant de bonnes que de mauvaises actions, et dans le tableau que j'en fais, il se trouve plus de personnages vertueux que de personnages répréhensibles. Les actions blâmables, les fautes, les crimes, depuis les plus légers jusqu'aux plus graves, y trouvent toujours leur punition humaine ou divine, éclatante ou secrète. J'ai mieux fait que l'historien, je suis plus libre. Cromwell fut, ici-bas, sans autre châtiment que celui que lui infligeait le penseur. Encore y a-t-il eu discussion d'école à école. Bossuet lui-même a ménagé ce grand régicide. Guillaume d'Orange l'usurpateur, Hugues Capet, cet autre usurpateur, meurent pleins de jours, sans avoir eu plus de défiances ni plus de craintes qu'Henri IV et que Charles Ier. La vie de Catherine II et celle de Louis XVI, mises en regard concluraient contre toute espèce de morale à les juger au point de vue de la morale qui régit les particuliers ; car pour les Rois, pour les Hommes d'Etat, il y a, comme l'a dit Napoléon, une petite et une grande morale.
Les Scènes de la vie politique sont basées sur cette belle réflexion. L'histoire n'a pas pour loi, comme le roman, de tendre vers le beau idéal. L'histoire est ou devrait être ce qu'elle fut; tandis que le roman doit être le monde meilleur, a dit madame Necker, un des esprits les plus distingués du dernier siècle. Mais le roman ne serait rien si, dans cet auguste mensonge, il n'était pas vrai dans les détails. Obligé de se conformer aux idées d'un pays essentiellement hypocrite, Walter Scott a été faux, relativement à l'humanité, dans la peinture de la femme parce que ses modèles étaient des schismatiques. La femme protestante n'a pas d'idéal. Elle peut être chaste, pure, vertueuse ; mais son amour sans expansion sera toujours calme et rangé comme un devoir accompli. Il semblerait que la Vierge Marie ait refroidi le coeur des sophistes qui la bannissaient du ciel, elle et ses trésors de miséricorde. Dans le protestantisme, il n'y a plus rien de possible pour la femme après la faute ; tandis que dans l'Eglise catholique l'espoir du pardon la rend sublime. Aussi n'existe-t-il qu'une seule femme pour l'écrivain protestant, tandis que l'écrivain catholique trouve une femme nouvelle, dans chaque nouvelle situation. Si Walter Scott eût été catholique, s'il se fût donné pour tâche la description vraie des différentes Sociétés qui se sont succédé en Ecosse, peut-être le peintre d'Effie et d'Alice (les deux figures qu'il se reprocha dans ses vieux jours d'avoir dessinées) eût-il admis les passions avec leurs fautes et leurs châtiments, avec les vertus que le repentir leur indique. La passion est toute l'humanité. Sans elle, la religion, l'histoire, le roman, l'art seraient inutiles.
En me voyant amasser tant de faits et les peindre comme ils sont, avec la passion pour élément, quelques personnes ont imaginé, bien à tort, que j'appartenais à l'école sensualiste et matérialiste, deux faces du même fait, le panthéisme. Mais peut-être pouvait-on, devait-on s'y tromper. Je ne partage point la croyance à un progrès indéfini, quant aux Sociétés ; je crois aux progrès de l'homme sur lui-même. Ceux qui veulent apercevoir chez moi l'intention de considérer l'homme comme une créature finie se trompent donc étrangement. Séraphita, la doctrine en action du Bouddha chrétien, me semble une réponse suffisante à cette accusation assez légèrement avancée d'ailleurs.
Dans certains fragments de ce long ouvrage, j'ai tenté de populariser les faits étonnants, je puis dire les prodiges de l'électricité qui se métamorphose chez l'homme en une puissance incalculée ; mais en quoi les phénomènes cérébraux et nerveux qui démontrent l'existence d'un nouveau monde moral dérangent-ils les rapports certains et nécessaires entre les mondes et Dieu ? en quoi les dogmes catholiques en seraient-ils ébranlés ? Si, par des faits incontestables, la pensée est rangée un jour parmi les fluides qui ne se révèlent que par leurs effets et dont la substance échappe à nos sens même agrandis par tant de moyens mécaniques, il en sera de ceci comme de la sphéricité de la terre observée par Christophe Colomb, comme de sa rotation démontrée par Galilée. Notre avenir restera le même. Le magnétisme animal, aux miracles duquel je me suis familiarisé depuis 1820 ; les belles recherches de Gall, le continuateur de Lavater ; tous ceux qui, depuis cinquante ans, ont travaillé la pensée comme les opticiens ont travaillé la lumière, deux choses quasi semblables, concluent et pour les mystiques, ces disciples de l'apôtre saint Jean, et pour tous les grands penseurs qui ont établi le monde spirituel, cette sphère où se révèlent les rapports entre l'homme et Dieu.
En saisissant bien le sens de cette composition, on reconnaîtra que j'accorde aux faits constants, quotidiens, secrets ou patents, aux actes de la vie individuelle, à leurs causes et à leurs principes autant d'importance que jusqu'alors les historiens en ont attaché aux événements de la vie publique des nations. La bataille inconnue qui se livre dans une vallée de l'Indre entre madame de Mortsauf et la passion est peut-être aussi grande que la plus illustre des batailles connues (Le Lys dans la vallée). Dans celle-ci, la gloire d'un conquérant est en jeu ; dans l'autre, il s'agit du ciel. Les infortunes des Birotteau, le prêtre et le parfumeur, sont pour moi celles de l'humanité. La Fosseuse (Médecin de campagne), et madame Graslin (Curé de village) sont presque toute la femme. Nous souffrons tous les jours ainsi. J'ai eu cent fois à faire ce que Richardson n'a fait qu'une seule fois. Lovelace a mille formes, car la corruption sociale prend les couleurs de tous les milieux où elle se développe. Au contraire, Clarisse, cette belle image de la vertu passionnée, a des lignes d'une pureté désespérante. Pour créer beaucoup de vierges, il faut être Raphaël. La littérature est peut-être, sous ce rapport, au-dessous de la peinture. Aussi peut-il m'être permis de faire remarquer combien il se trouve de figures irréprochables (comme vertu) dans les portions publiées de cet ouvrage : Pierrette Lorrain, Ursule Mirouët, Constance Birotteau, la Fosseuse, Eugénie Grandet, Marguerite Claës, Pauline de Villenoix, madame Jules, madame de La Chanterie, Eve Chardon, mademoiselle d'Esgrignon, madame Firmiani, Agathe Rouget, Renée de Maucombe ; enfin bien des figures du second plan, qui pour être moins en relief que celles-ci, n'en offrent pas moins au lecteur la pratique des vertus domestiques, Joseph Lebas, Genestas, Benassis, le curé Bonnet, le médecin Minoret, Pillerault, David Séchard, les deux Birotteau, le curé Chaperon, le juge Popinot, Bourgeat, les Sauviat, les Tascheron, et bien d'autres ne résolvent-ils pas le difficile problème littéraire qui consiste à rendre intéressant un personnage vertueux.
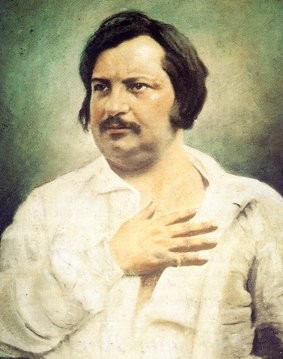
Honoré de Balzac (1799-1850)
Ce n'était pas une petite tâche que de peindre les deux ou trois mille figures saillantes d'une époque, car telle est, en définitif, la somme des types que présente chaque génération et que La Comédie humaine comportera. Ce nombre de figures, de caractères, cette multitude d'existences exigeaient des cadres, et, qu'on me pardonne cette expression, des galeries. De là, les divisions si naturelles, déjà connues, de mon ouvrage en Scènes de la vie privée, de province, parisienne, politique, militaire et de campagne. Dans ces six livres sont classées toutes les Etudes de moeurs qui forment l'histoire générale de la Société, la collection de tous ses faits et gestes, eussent dit nos ancêtres. Ces six livres répondent d'ailleurs à des idées générales. Chacun d'eux a son sens, sa signification, et formule une époque de la vie humaine. Je répéterai là, mais succinctement, ce qu'écrivit, après s'être enquis de mon plan, Félix Davin, jeune talent ravi aux lettres par une mort prématurée. Les Scènes de la vie privée représentent l'enfance, l'adolescence et leurs fautes, comme les Scènes de la vie de province représentent l'âge des passions, des calculs, des intérêts et de l'ambition. Puis les Scènes de la vie parisienne offrent le tableau des goûts, des vices et de toutes les choses effrénées qu'excitent les moeurs particulières aux capitales où se rencontrent à la fois l'extrême bien et l'extrême mal. Chacune de ces trois parties a sa couleur locale : Paris et la province, cette antithèse sociale a fourni ses immenses ressources. Non-seulement les hommes, mais encore les événements principaux de la vie, se formulent par des types. Il y a des situations qui se représentent dans toutes les existences, des phases typiques, et c'est là l'une des exactitudes que j'ai le plus cherchées. J'ai tâché de donner une idée des différentes contrées de notre beau pays. Mon ouvrage a sa géographie comme il a sa généalogie et ses familles, ses lieux et ses choses, ses personnes et ses faits ; comme il a son armorial, ses nobles et ses bourgeois, ses artisans et ses paysans, ses politiques et ses dandies, son armée, tout son monde enfin !
Après avoir peint dans ces trois livres la vie sociale, il restait à montrer les existences d'exception qui résument les intérêts de plusieurs ou de tous, qui sont en quelque sorte hors la loi commune : de là les Scènes de la vie politique. Cette vaste peinture de la société finie et achevée, ne fallait-il pas la montrer dans son état le plus violent, se portant hors de chez elle, soit pour la défense, soit pour la conquête ? De là les Scènes de la vie militaire, la portion la moins complète encore de mon ouvrage, mais dont la place sera laissée dans cette édition, afin qu'elle en fasse partie quand je l'aurai terminée. Enfin, les Scènes de la vie de campagne sont en quelque sorte le soir de cette longue journée, s'il m'est permis de nommer ainsi le drame social. Dans ce livre, se trouvent les plus purs caractères et l'application des grands principes d'ordre, de politique, de moralité.
Telle est l'assise pleine de figures, pleine de comédies et de tragédies sur laquelle s'élèvent les Etudes philosophiques, Seconde Partie de l'ouvrage, où le moyen social de tous les effets se trouve démontré, où les ravages de la pensée sont peints, sentiment à sentiment, et dont le premier ouvrage, La Peau de chagrin, relie en quelque sorte les Etudes de moeurs aux Etudes philosophiques par l'anneau d'une fantaisie presque orientale où la Vie elle-même est peinte aux prises avec le Désir, principe de toute Passion.
Au-dessus, se trouveront les Etudes analytiques, desquelles je ne dirai rien, car il n'en a été publié qu'une seule, La Physiologie du mariage. D'ici à quelque temps, je dois donner deux autres ouvrages de ce genre. D'abord la Pathologie de la vie sociale, puis l'Anatomie des corps enseignants et la Monographie de la vertu.
En voyant tout ce qui reste à faire, peut-être dira-t-on de moi ce qu'ont dit mes éditeurs : Que Dieu vous prête vie ! Je souhaite seulement de n'être pas aussi tourmenté par les hommes et par les choses que je le suis depuis que j'ai entrepris cet effroyable labeur. J'ai eu ceci pour moi, dont je rends grâce à Dieu, que les plus grands talents de cette époque, que les plus beaux caractères, que de sincères amis, aussi grands dans la vie privée que ceux-ci le sont dans la vie publique, m'ont serré la main en me disant : - Courage ! Et pourquoi n'avouerais-je pas que ces amitiés, que des témoignages donnés çà et là par des inconnus, m'ont soutenu dans la carrière et contre moi-même et contre d'injustes attaques, contre la calomnie qui m'a si souvent poursuivi, contre le découragement et contre cette trop vive espérance dont les paroles sont prises pour celles d'un amour-propre excessif ? J'avais résolu d'opposer une impassibilité stoïque aux attaques et aux injures ; mais, en deux occasions, de lâches calomnies ont rendu la défense nécessaire. Si les partisans du pardon des injures regrettent que j'aie montré mon savoir en fait d'escrime littéraire, plusieurs chrétiens pensent que nous vivons dans un temps où il est bon de faire voir que le silence a sa générosité.
A ce propos, je dois faire observer que je ne reconnais pour mes ouvrages que ceux qui portent mon nom. En dehors de La Comédie humaine, il n'y a de moi que les Cent contes drôlatiques, deux pièces de théâtre et des articles isolés qui d'ailleurs sont signés. J'use ici d'un droit incontestable. Mais ce désaveu, quand même il atteindrait des ouvrages auxquels j'aurais collaboré, m'est commandé moins par l'amour-propre que par la vérité. Si l'on persistait à m'attribuer des livres que, littérairement parlant, je ne reconnais point pour miens, mais dont la propriété me fut confiée, je laisserais dire par la même raison que je laisse le champ libre aux calomnies.
L'immensité d'un plan qui embrasse à la fois l'histoire et la critique de la Société, l'analyse de ses maux et la discussion de ses principes, m'autorise, je crois, à donner à mon ouvrage le titre sous lequel il parait aujourd'hui : La Comédie humaine. Est-ce ambitieux ? N'est-ce que juste ? C'est ce que, l'ouvrage terminé, le public décidera.
Paris, juillet 1842.
07:34 Publié dans Beaux-Arts, Ecrits, Littérature, Portraits de personnalités, Thèse | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 28 janvier 2013
Honoré

Honoré de Balzac (1799-1850)
Extrait du Larousse en ligne :
Son œuvre gigantesque aux ambitions démesurées fait de Balzac l'écrivain le plus emblématique du roman français. Si l'auteur de la Comédie humaine passe pour l'un des initiateurs du réalisme en littérature à l'époque romantique, l'ambiguïté de son œuvre va bien au-delà de cette catégorie. Il est aussi celui qui inaugure une nouvelle forme de relation de la vie à l'œuvre, celui pour qui les événements vécus et l'aventure littéraire, de revers en triomphes, sont portés par le même élan.
Famille : il est né le 20 mai 1799. Son père, Bernard-François Balzac, est d'origine paysanne (dans l'Albigeois). L'ascension sociale de ce dernier sera constante avant la Révolution puis sous l'Empire (1804-1814). Bernard-François fait accoler une particule au nom « Balzac » (1802).
Formation : Honoré étudie au collège de Vendôme (1807-1813), avant de devenir pensionnaire de l'institution Ganser à Paris (1813). Il montre un intérêt certain pour la philosophie et fait des études de droit (1816-1819).
Début de carrière : en 1819, il s'essaie à la tragédie (Scylla, Cromwell) ; entre 1820 et 1825, il compose plusieurs « romans de jeunesse » sous divers pseudonymes : lord R'Hoone, Horace de Saint-Aubin. Il devient imprimeur (1826) mais fait faillite (1828) et contracte de lourdes dettes.
Premiers succès : en 1829, le Dernier Chouan est le premier roman signé « M. Honoré Balzac » (il signera « de Balzac » à partir de 1830). Il fréquente les salons à la mode. La Peau de chagrin (août 1831) et Eugénie Grandet (décembre 1833) lancent sa carrière d'écrivain. Il rencontre Mme Hanska, une comtesse polonaise admiratrice de son œuvre (septembre 1833).
La consécration : le Père Goriot (1834-1835) inaugure le principe du retour des personnages d'un roman à l'autre. Élaboration d'un vaste univers romanesque, divisé en trois axes : Études de mœurs, Études philosophiques et Études analytiques. Le Lys dans la vallée (1835) et Illusions perdues (1837-1843) finissent de consacrer Balzac comme maître du réalisme.
Dernière partie de carrière : de 1842 à 1848, il édifie la Comédie humaine : un ensemble de romans formant une fresque de la société française de la Révolution (1789) à la fin de la monarchie de Juillet (1830-1848). Plus de 2 000 personnages composent une société hantée par le pouvoir de l'argent et de la presse, livrée à des passions dévorantes. En 1845, il élabore le plan d'ensemble de la Comédie humaine, lequel prévoit 137 titres (90 romans seront achevés). Il épouse Mme Hanska (14 mars 1850).
Mort : le 18 août 1850. Balzac est inhumé le 21 août au cimetière du Père-Lachaise, où Victor Hugo prononce son éloge funèbre.
> Source et pour la suite : http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Honor%C3%A...

La maison de Balzac, 47, rue Raynouard, Paris XVIe
http://fichtre.hautetfort.com/archive/2012/10/08/la-maison-de-balzac.html
Le plus divertissant de tout, ce serait de se mettre à lire Balzac (si votre ami ne l’a pas lu) ou au moins tout un cycle de Balzac, car un roman ne peut se lire isolément, on s’en tire difficilement à moins d’une tétralogie et c’est quelquefois une décalogie. Quelques nouvelles, vraiment divines, peuvent se lire isolément, ce grand peintre de fresques ayant été un incomparable miniaturiste. Si vous voulez des conseils balzaciens, je vous écrirai mais ce serait toute une lettre.
(Proust, l. à Mme de Camaran-Chimay, 20/07/1907)
Contrairement à Flaubert, Marcel Proust (1871-1922) ne s’agace pas des comparaisons avec Honoré de Balzac. Il en est même flatté : « Je rougis devant cette comparaison écrasante pour moi » écrit-il en mai 1921. Chez les Proust, « lire Balzac c’est parler la langue de la famille » puisque sa mère, déjà, lui parle des livres de Balzac. Proust est un lecteur averti de l’œuvre de l’écrivain tourangeau ; on retrouve dans leurs écrits quelques points communs comme les phénomènes du sommeil...
> Source et suite : http://debalzac.wordpress.com/2012/10/25/balzac-et-proust/
A l'angle du boulevard du Montparnasse et du boulevard Raspail
« Je viens de lire la Correspondance de Balzac. Il en résulte que : c’était un très brave homme. Et qu’on l’aurait aimé. Mais quelle préoccupation de l’Argent ! et quel peu d’amour de l’Art° ! Avez-vous remarqué qu’il n’en parle pas, une fois ? Il cherchait la gloire mais non le Beau°. Et il était catholique, légitimiste, propriétaire, ambitionnait la Députation et l’Académie°. Avant tout ignorant comme une cruche, provincial jusque dans la moelle des os ; le luxe l’épate. – Sa plus grande admiration littéraire est pour Walter Scott° ! – En résumé c’est pour moi un immense bonhomme mais de second ordre. »
(G. Flaubert, l. à Edmond de Goncourt. 31 décembre [1876])
Flaubert (1821-1880) est plus jeune que Balzac. Il n’a jamais rencontré son aîné, du moins officiellement car il y a tout de même une rencontre furtive en 1839, Flaubert a 17 ans, et Balzac vient à Rouen pour le compte de la Société des gens de lettres (il a donc 40 ans et a déjà écrit la plupart des ses grandes œuvres dont La Peau de chagrin, Eugénie Grandet, Le Père Goriot, Le Lys dans la vallée, Illusions Perdues…). Le jeune Flaubert le croise et suit, de loin. Balzac est alors une personnalité littéraire de tout premier plan qu’il vient de découvrir et dont la lecture lui est décisive. Contes philosophiques, Contes fantastiques, physiologies : grâce à lui il découvre ces nouveaux genres littéraires.
> Source et suite : http://debalzac.wordpress.com/2012/10/23/balzac-et-flaube...

Source : http://debalzac.wordpress.com/2009/12/12/balzac-et-louis-...
Balzac écrit sa Comédie Humaine (ses romans presque complets, disons) en moins de 20 ans : entre 1829 et 1848). Louis-Philippe est Roi des Français entre 1830 et 1848, ce qui correspond absolument aux mêmes dates. On sait que Balzac veut être un historien des moeurs de son temps, il s'inspire donc beaucoup de cette monarchie (de juillet) dans laquelle il vit.
On retrouve, pour ne citer que les plus connus, des références à cela dans La Peau de chagrin (la crise qui a suivi l'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe) et dans Le Père Goriot (l'émergence d'une bourgeoisie d'affaire favorisée par ce Roi qu'on dit Roi-bourgeois au dépend de la noblesse). Balzac, qui est un royaliste (un légitimiste même) affirmé n'aime pourtant pas Louis-Philippe qui ne semble pas être assez royaliste à son goût (puisqu'il se compromet avec la bourgeoisie).
Au début des années 1830, comme l'art de la caricature se développe considérablement, Louis-Philippe est attaqué et représenté sous forme de poire (ici au centre de la lithographie) en référence à ses joues tombantes. En 1835, Louis Philippe interdit définitivement qu'on le représente ; les caricaturistes, plutôt que de risquer la prison, se tournent donc vers d'autres personnalités comme les écrivains... et donc Balzac.
07:34 Publié dans Ecrits, Littérature, Portraits de personnalités, Thèse | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 28 décembre 2012
Le surréaliste sommeil amoureux - Picasso, Proust

Les dormeurs, Picasso
Extrait de La Recherche du temps perdu, V "La Prisonnière", Marcel Proust :
Je pouvais mettre ma main dans sa main, sur son épaule, sur sa joue, Albertine continuait de dormir. Je pouvait prendre sa tête, la renverser, la poser contre mes lèvres, entourer mon cou de ses bras, elle continuait à dormir comme une montre qui ne s'arrête pas, comme une bête qui continue de vivre quelque position qu'on lui donne, comme une plante grimpante, un volubilis qui continue de pousser ses branches quelque appui qu'on lui donne. Seul son souffle était modifié par chacun de mes attouchements, comme si elle eût été un instrument dont j'eusse joué et à qui je faisais exécuter des modulations en tirant de l'un, puis de l'autre de ses cordes, des notes différentes.
¤ ¤ ¤
> A consulter également : http://doudou.gheerbrant.com/?cat=43
¤ ¤ ¤

Jeune femme endormie, Lovis Corinth
08:00 Publié dans Beaux-Arts, Ecrits, Littérature, Peinture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : proust, picasso, man ray, sommeil, amour
vendredi, 02 novembre 2012
Considérations sur la littérature - Jacqueline de Romilly
 Jacqueline de Romilly (1913-2010)
Jacqueline de Romilly (1913-2010)
Extraits de Le Trésor des savoirs oubliés, Jacqueline de Romilly, de l'Académie française, 1998, Ed. de Fallois
[...]
Les écrivains nous apprennent à voir. Tout simplement à voir les choses, à voir le monde. Le plus souvent je suis convaincue que notre perception des choses est superficielle, inattentive, insuffisante. Et je crois que l'observation, le choix des mots souvent attirent notre attention sur des détails présents, frappants, que nous reconnaissons et dont la vérité nous paraît évidente, alors qu'ils nous étaient inconnus. [...] On y verra par exemple Les Chats décrits par Colette, avec leur douceur et leurs griffes et leur luxe ; je n'ai jamais beaucoup observé les chats ni aimé les chats ; mais le temps de lire un tel texte je retrouve la vérité des notations, ou plutôt je les découvre et en même temps, pour un temps, j'aime les chats ; et ce n'est peut-être pas tout car, pour un temps aussi, me pénètre une sorte de sympathie pour ce genre de sensualité qui rend si présentes les beautés des bêtes, des fruits et des plantes. L'admiration se double de compréhension, et la vision liée à un texte porte avec elle des réactions affectives, et proches déjà de jugements de valeur.
Mais surtout, les écrivains nous font ressentir et comprendre les émotions et leur sens. Et à cet égard, j'aimerais raconter une impression toute récente que j'ai éprouvée il y a quelques semaines : je venais d'écouter sur cassette, c'est-à-dire lu à haute voix, l'Othello de Shakespeare. J'étais seule dans une pièce tranquille avec du loisir et j'ai laissé le texte entier passer en moi. Quand il a été fini, je suis restée comme frappée de stupeur et de désolation. J'éprouvais une pitié dévorante pour Desdémone, la si pure et tendre Desdémone, qui venait une fois de plus de mourir victime du malentendu qui dressait contre elle un époux bien-aimé. J'étais déchirée de pitié pour Othello, le Maure, qui venait dans sa folie et son imprudence de tuer celle pour qui il éprouvait une si puissante passion. Les deux pitiés ne se contredisaient pas, elles se complétaient. Il me semblait, depuis l'accablement où je me trouvais, comprendre mieux que jamais comment les êtres humains se font souffrir sans le vouloir, l'un par l'autre, alors qu'ils s'aiment et voudraient tout faire pour se le prouver. Il me semblait atteindre à un niveau de compréhension plus grand que dans toutes les années passées ; peut-être s'ajoutait-il vaguement la condamnation de la perfidie du traître, le regret de l'imprudence d'Othello qui n'avait pas mieux vérifié, l'étonnement devant l'ensemble de petits indices qui finissaient par aboutir à cette fin tragique d'une façon qui semblait presque inévitable. La pitié et la compréhension m'écrasaient. J'ai mis longtemps à me reprendre.
[...]
Le regard du connaisseur est un regard entraîné et qu'on ne trompe pas aisément. Mais, à côté de cet entraînement pratique, le rôle de la littérature est infiniment plus important. Car, dans les textes, nous trouvons, décrits avec des mots, la présence d'objets, d'êtres ou de sensations que nous pouvons avoir rencontrés, mais sans percevoir tous les aspects qu'un écrivain, entraîné à observer et à traduire cette observation par des mots, peut, d'un seul coup, nous communiquer. Parfois, ce sera une découverte et il nous fera voir des réalités de nous inconnues, des pays lointains, des êtres monstrueux, des présences surprenants, des émotions hors de notre portées. D'autres fois ce seront des réalités familières mais que nous n'avions pas remarquées.
Chose étrange : le plus souvent nous reconnaîtrons avec la même certitude un objet que nous ignorons ou un objet que nous connaissons. L'imagination nous présente les choses avec suffisamment de force pour que nous ayons le sentiment de déjà les connaître.
En tout cas, nombreuses sont les descriptions dans les œuvres littéraires qui nous donnent cette impression ; et, par la suite, que le souvenir en soit présent ou bien oublié, cette description nous aide à mieux voir ce qui se présence sous nos yeux.
Je lisais, pas plus tard qu'hier, un texte de Colette relatif à son chat ou sa chatte. Je vois tout. Je vois, comme elle dit, "ces pattes armées de brèves griffes en cimeterres qui savent se fondre, confiantes, dans la main amie". Quand je lis cela, moi qui n'ai pas beaucoup l'habitude, aussitôt je vois ce chat ! Puis, dans la page de Colette, les adjectifs, bientôt se multiplient : "facile..., rêveuse..., passionnée..., gourmande..., caressante..., autoritaire". L'enfant qui poursuit un chat sur le trottoir ne voit pas tout cela ; quand il aura lu ce texte, puis d'autres, peut-être le verra-t-il un peu mieux ; ses yeux se seront ouverts à la présence de ce qui l'entoure.
Ce chat-là, faisant l'arbitre, dévore tranquillement les deux adversaires. Lui aussi, l'enfant, dès lors, le verra mieux.
Ou bien quand un auteur nous décrit la buée légère qui subsiste sur un fruit que l'on vient de cueillir, tout à coup cette description nous rappelle une impression fugitive que nous n'avons pas notée, que nous n'avons pas retenue, mais que, la prochaine fois, nous saluerons avec plus d'amitié et de lucidité.
De même, si la chaleur est quelque chose que l'on perçoit immédiatement et sans qu'il soit besoin pour cela d'aucune aide, je crois qu'une description de l'été algérien dans Camus aide à comprendre ce que cette chaleur a de redoutable et à sentir dans notre corps la splendeur de cette végétation, du soleil et de tout ce qui renaît avec la fraîcheur du soir. On vit, on perçoit, on voit, on entend par la littérature ou du moins on le fait mieux grâce à la littérature.
Et même s'il ne s'agit pas de détails mieux perçus, l'évocation littéraire - soit sur le moment, quand nous sommes confrontés à elle, soit après coup, quand il s'agit de souvenirs oubliés - ajoute une présence et une richesse plus grandes à tout ce que nous voyons, même aux objets les plus familiers, aux circonstances, aux mots connus.
[...] Quand vient la fin du jour, les ombres s'allongent. Nous le voyons, bien entendu - du moins, si nous sommes uin peu attentifs. Mais si un jour a chanté en nous la formule de Virgile disant que le soir les ombres tombent plus longues du haut des monts, avec ces sonorités sourdes que l'on remarque aussitôt dans la langue latine et dont le français garde quelque chose, en l'alourdissant, cette présence nous trouvera plus attentifs ; nous la remarquerons ; et là aussi elle prendra pour nous, parce qu'elle vient de si loin, une richesse accrue. Et voit-on, en contrepartie, le lever du jour ? Je le regarde, je l'avoue, assez rarement. Mais quand je vois le petit matin et les taches roses qui apparaissent partout, délicates et prometteuses, je crois qu'un vague souvenir de l'expression homérique "l'Aurore aux doigts roses" est quelque part dans mon esprit et donne du prix, de la présence, de la force à ce que je perçois.
Au reste, on le constate : ce n'est pas seulement parce qu'un écrivain a su observer la réalité qu'il nous aide à la reconnaître ; ce n'est même pas seulement parce qu'il a su trouver les mots justes pour la décrire : c'est parce que, usant de la valeur poétique des mots et aussi des métaphores et de leurs possibilités de suggestion, il ajoute à l'observation stricte des évocation multiples, presque infinies.
Je sais bien qu'en ce sens, c'est à la peinture que l'on penserait tout d'abord, car elle aussi montre les objets et en même temps, par la composition, les valeurs, l'interprétation, ajoute un sentiment personnel à la simple présente de l'objet. Il est juste de le rappeler, et je suis la première à admettre que l'on voit beaucoup mieux des pommes lorsque l'on a regardé des tableaux de Cézanne représentant des pommes. [...]
Mais si j'insiste sur la littérature et sur son rôle quand il s'agit de nous apprendre à voir, c'est parce que le jeu sur les mots, sur leur longueur, sur leurs sonorités, accompagné du recours aux métaphores, permet par sa précision d'aller plus loin encore.
Citons par exemple deux images d'échassiers. On pourrait avoir des planches d'histoire naturelle les représentant avec une parfaite exactitude ; et déjà cela nous aiderait à les voir. Mais deux évocations me viennent à l'esprit. La première est le héron de La Fontaine ; l'animal, tout en longueur, est présenté en deux vers où l'adjectif "long" se répète plaisamment avec une insistance qui est proche de l'ironie :
L'image est là en quelques vers nets et secs qui font comme une petite vignette ; mais le procédé même de la répétition et de la simplification aide à le percevoir et permet de s'en amuser.
Le second échassier auquel je pense est plus petit ; il est aussi plus moderne ; aussi se colore-t-il des subtilités de la psychologie évoquées par une image et un changement de registre. C'est le pluvier d'Hector Bianciotti. Il nous le montre "droit sur une patte au milieu du sillon, au bord d'un sentier, l'air de considérer les propositions de l'horizon". Cette brève description, qui appartient au livre Ce que la nuit raconte au jour, m'enchante parce qu'elle me fait d'abord voir l'oiseau dressé sur une patte, tout seul, attentif, mais qu'aussitôt elle évoque son regard en se référant à des sentiments humains qui rendent l'impression plus présente. Il considère les propositions. On voit ce regard rond, attentif, un peu hautain qu'aurait un personnage dans sa situation et aussitôt l'image prend vie, grâce à la comparaison. D'autre part, ces propositions viennent, non pas de quelque partenaire dans un débat humain, mais de l'horizon : ceci confirme l'impression de hauteur qu'il y a dans ce regard de la tête dressée, l'arrogance même de l'expression avec cette façon de tenir le regard au loin ; et ainsi nous est rendue cette attitude de l'oiseau qui est en réalité faite d'attention et de méfiance.
La notation est ici originale ; elle semble aussi à ce point vraie, que l'on est tenté de rire de satisfaction devant cette réussite. Je crois bien n'avoir jamais vu de pluvier ; je suis sûre en tout cas de n'en avoir jamais observé ; et pourtant je reconnais celui-là parce que la littérature nous a dit quelque chose qui dépasse de beaucoup la description et qui n'est plus du tout réel. Il est amusant de penser que cela aura été mon premier pluvier et que je l'aurai vu dans cette pampa de l'Argentine que je ne connais pas et ne connaîtrai jamais. La réalité, en somme, nous atteint à travers une évocation irréelle et une métaphore plus irréelle encore. A chaque page des livres, à chaque vers des poèmes se présentent ainsi des notations, ou fugitives ou insistantes, qui, je le répète, nous apprennent à voir. Et, sauf exception, ces phrases qui nous auront touchés jusqu'au cœur, ces textes sont ensuite presque toujours oubliés : nous rejoignons ainsi le sujet de ce livre. Mais avant d'être oubliés, ils ont comme affiné notre regard et jeté sur les choses une lumière qui nous révèle leur existence. [...]
On n'est pas obligé de vivre parmi les métaphores des poètes et de s'en faire un univers toujours plus ou moins présent. Mais il reste ce fait important que chaque phrase écrite est un effort pour rendre présent quelque chose et nous habitue ainsi à voir non pas par le regard direct qui n'est pas encore suffisamment entraîné, mais par le regard indirect des œuvres.
[...]
> A consulter également : http://www.magazine-litteraire.com/content/rss/article?id=18057
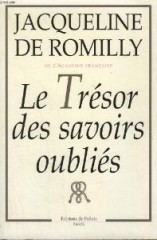 Se procurer l'ouvrage :
Se procurer l'ouvrage :
Le Trésor des savoirs oubliés
Jacqueline de Romilly
1998
De Fallois
220 pages
http://www.amazon.fr/tresor-savoirs-oublies-ROMILLY-JACQU...
En poche : http://www.amazon.fr/tr%C3%A9sor-savoirs-oubli%C3%A9s-J-R...
08:00 Publié dans Ecrits, Littérature, Réflexions, philosophie, Thèse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jaqueline de romilly, le trésor des savoirs oubliés
lundi, 29 octobre 2012
Bibliothèque érotique
08:00 Publié dans Ecrits, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)










